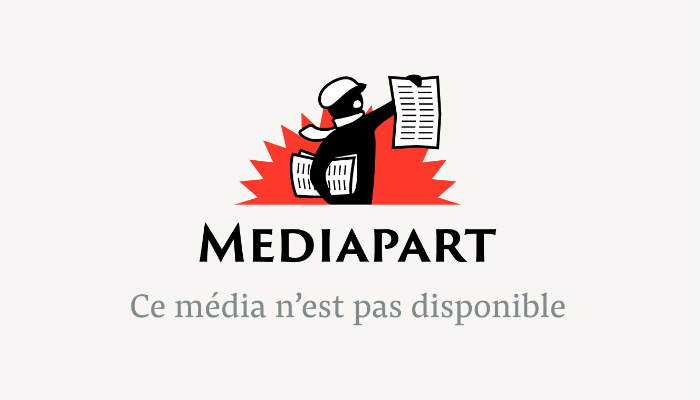-
La déclaration de l’antisémitisme, proposée par l’IHRA, est en passe d’être adoptée par de nombreux pays et certains, dont Macron, en tirent prétexte pour assimiler antisionisme et antisémitisme. Contre cette dérive dangereuse, la Déclaration de Jérusalem, signée par plus de 200 académiques, rappelle que si l’antisémitisme est un crime, l'antisionisme n’est qu’une opinion. Par Vincent Engel
-
L’inflation carcérale est une réalité tangible en Belgique. Si la formation des magistrats peut en partie expliquer l’existence d’une culture du « tout à la prison », elle ne peut oblitérer les sources d’un « populisme pénal » largement lié aux interactions du triangle média - politique - opinion publique. Par Yves Cartuyvels.
-
L’utilisation des algorithmes au sein des administrations publiques est grandissante. Derrière les promesses d’efficacité que les algorithmes sont censés fournir se cachent des enjeux majeurs. Si les algorithmes participent à la gouvernance lorsqu’ils aident à la prise de décision, des garanties efficaces doivent être établies pour protéger les citoyen.nes. Par Benjamin Jan
-
Le racisme dans le football va bien au-delà des insultes et agressions à l’égard de joueurs africains. Il comprend trois autres dimensions : les préjugés raciaux, les idéologies raciales et un racisme structurel et institutionnel. Dès lors, la lutte contre ce phénomène doit se décliner à quatre niveaux et ne pas se contenter de campagnes de communication (Respect, etc.). Par Marco Martiniello
-
Les pays en développement demandent à l’OMC la suspension des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid-19, mais les pays occidentaux y mettent leur veto. Si elle ne règlerait pas tous les problèmes à court terme, cette mesure favoriserait pourtant la lutte contre la pandémie en faisant des vaccins un bien public mondial. Par Arnaud Zacharie.
-
Paris, 1871 : Babette, cheffe renommée du Café Anglais, s’exile au Danemark suite à la répression de la Commune. Son histoire, celle d’une passionnée dépossédée de sa vie par un gouvernement à tout le moins décevant, résonne étrangement en 2021. Nos restaurateurs et artistes, défaits par les mesures sanitaires puis oubliés, seraient-ils ses nouveaux compagnons d’infortune ? Par Iris Derzelle
-
La précarité, et non pas l'inégalité, est ce qui afflige tous ceux qui ne font pas partie des 1% les plus riches. C'est la grande injustice sociale de notre temps. La précarité généralisée est à l'origine de la montée du populisme. Elle explique aussi l'incapacité de nos sociétés à faire face à la pandémie de Covid-19. Par Albena Azmanova.
-
La situation sanitaire agit révèle et aggrave une double crise préexistante qui touche le secteur culturel et créatif : une crise de la rémunération du travail artistique et une crise de la liberté de création. Les pouvoirs publics disposent de leviers permettant d’aller plus loin qu’une réponse à l’urgence, mais qui impliquent de sortir le secteur des logiques marchandes. Par Renaud Maes
-
Plutôt que de se laisser prendre de vitesse par les lobbies de la libéralisation des («nouveaux») OGM il est grand temps de dire fermement «Stop!» et de réfléchir à une façon acceptable d’agencer des politiques agricoles et alimentaires dignes de répondre aux problèmes de notre époque. Par Serge Gutwirth, Isabelle Stengers, Niels Van Dijk et Marjolein Visser.
-
La crise économique en cours confronte nos sociétés à un triple défi. Tout d’abord, une augmentation des inégalités. Ensuite, des indices boursiers qui font planer la menace d’une crise financière. Enfin, d’importants niveaux d’endettement. Face à ce péril, il faut redécouvrir les vertus de politiques fiscales redistributives. Par Xavier Dupret professeur d’Économie politique.