« Soigner les malades sans soigner l’hôpital, c'est de la folie » Jean Oury

Agrandissement : Illustration 1

On l’aura bien compris, dans les représentations collectives dominantes, les institutions soignantes constituent intrinsèquement des lieux de relégation, de discrimination et de violence. Ainsi, la désinstitutionnalisation et l’inclusion systématiques seraient les conditions nécessaires et suffisantes pour contrer toute forme de maltraitance… Moins d’institutions = moins de violence et émancipation garantie. Voilà donc l’équation libératrice indiscutable de notre modernité néolibérale.
La naïveté de ces affirmations pourrait prêter à rire, pour peu que l’on néglige les conséquences concrètes de ces slogans…
Cependant, au-delà des répercussions et des intérêts manifestes servis par ce discours hégémonique, certains enjeux fondamentaux restent absolument occultés. A savoir, la question de la violence, de ses soubassements, de ses déclinaisons, de ses manifestations, de sa médiatisation ou de son invisibilisation. Quelles sont les formes de la violence ? Quels sont ses rapports avec les dynamiques institutionnelles ? Est-il envisageable de circonscrire des courants profonds et systémiques à la source de certaines expressions violentes ?
Revenons tout d’abord sur la dimension de violence dans le soin. De plus en plus, la maltraitance du système de santé est dénoncée, ciblant notamment les « violences médicales ». Des tribunes récentes rapportent ainsi que « les biais de la société sont reproduits très fort dans le système médical avec des micro-agressions ou de vraies agressions qui sont sexistes, homophobes, racistes, transphobes ». Le monde médical est ainsi décrit comme un « système oppressif, discriminatoire, et patriarcal » et comme un lieu de « discriminations sexistes omniprésentes ». « Les maltraitances médicales sont courantes, et affectent tout particulièrement les femmes, premières usagères du système de soin. Parmi elles, les personnes et femmes notamment handicapées, racisées, trans, migrantes, usagères de drogues, sont d’autant plus surexposées aux violences sexistes du corps médical qu'elles sont vulnérabilisées et essentialisées par des discriminations et des systèmes d'oppressions hétéro-patriarcaux croisés renforcés en milieu médical comme le validisme, le racisme, les LGBTQI+phobie, la sérophobie, la psychophobie, la grossophobie… »
Et ces violences systémiques sont analysées comme relevant d’une « culture carabine », d’une complicité institutionnalisée avec un « corporatisme, omniprésent dans ce milieu qui constitue un levier de silenciation des éventuel·le·s témoins. Sous couvert du principe de « confraternité », les responsables sont soutenus et couverts par leurs collègues, ce qui leur permet de continuer d’exercer en toute impunité ».
A l’évidence, on ne peut que souscrire à cette indignation, à ces dénonciations et à ces luttes. Sans aucune ambiguïté, il faut dénoncer, condamner, interdire, punir, mettre fin à l’omerta, à l’impunité, etc. Et, à ce titre, la duplicité du Conseil de l’Ordre reste absolument scandaleuse. Rappelons tout de même que, dans le cas d’abus caractérisés et répétés, il conviendrait également de dénoncer l’insupportable « inertie de la hiérarchie hospitalière et universitaire », qui, à un tel niveau, s’apparente à de la couverture voire à de la complicité…Rappelons également les limites de cette "confraternité" complice : certains praticiens s'insurgent, dénoncent, mais sont tout simplement désavoués par leur tutelle. Certaines pratiques abusives sont même tacitement encouragées au niveau politique - ainsi, comme le dénonce le CLE-Autistes, Claire Compagnon, déléguée interministérielle en charge de la stratégie nationale Autisme, a-telle pu justifier "les recherches de « traitements curatifs » tous azimuts, tout en fournissant des excuses aux parents maltraitants (qu’ils le soient volontairement, ou malgré eux)". Par ailleurs, elle n'aurait "condamné ni le recours à la chélation, ni le protocole Chronimed, se contentant de réagir (légèrement) aux « traitements » MMS, assimilables à l’absorption pure et simple d’eau de javel" - ces protocoles potentiellement dangereux n'ont pourtant aucune preuve de scientificité ni d'efficacité. Où se situe la violence ?
Il me semble donc que ces légitimes accusations à l'égard du corps médical omettent néanmoins de nombreuses dimensions de la violence, pour n’en retenir que certains aspects, en rapport avec certains présupposés militants – à savoir, une institution médicale patriarcale, validiste, culturellement "autorisée" à des abus ou à des discriminations systématiques envers certaines « minorités » (de fait, les médecins infusent dans un écosystème institutionnel élargi, sont donc exposés aux mêmes "colonisations" psychiques, et peuvent d'autant plus les exercer qu'ils occupent une position de pouvoir...).
Dès lors, il s’agirait surtout d’une question de « traditions », de « regards », de domination culturelle inhérente à la fonction médicale, voire au soin. Et, sans aucun doute, il s’agit là d’une réalité indéniable et fondamentale ; mais qui ne doit pas conduire à négliger d’autres dimensions en imposant des œillères idéologiques. Déjà, au-delà de ces discriminations "culturelles et identitaires", on ne peut faire l’impasse sur les enjeux sociaux, avec en corollaire un mépris de classe tout à fait tangible. De fait, les médecins proviennent majoritairement des catégories sociales favorisées, pour ne pas dire bourgeoises, ce qui supposent un certain « alignement » avec des intérêts de classe spécifiques, des biais de représentation, certains préjugés ou certaines représentations dépassant largement les aspects purement corporatistes. D’ailleurs, au-delà de l’interaction usager / médecin, ces antagonismes socio-politiques se déploient aussi à travers la hiérarchie des soignants dans les services. Rappelons-le, les institutions sont aussi des espaces collectifs au sein desquels les contradictions sociales, les luttes, les inégalités, peuvent se mettre en scène et s’incarner au quotidien…Là s’exprime aussi la violence du Social et de ces inégalités structurelles.
Par ailleurs, dénoncer la « culture médicale » comme seule causalité de la maltraitance du système de santé tend également à occulter la violence induite par l’emprise gestionnaire, bureaucratique et managériale, ainsi que par les impératifs de rentabilité imposés via la gouvernance néolibérale. Dès lors, on rend les acteurs et les institutions responsables, on dénonce les dérives individuelles, sans pour autant analyser les conditions réelles de démantèlement des pratiques, les injonctions paradoxales, les contraintes organisationnelles, les protocoles normatifs, qui sécrètent leur lot de déshumanisation, d’épuisement, d’agressions, etc.
Voici par exemple ce que dénonce Georges-André à propos de la situation tragique de l'hôpital public : "les revendications sans cesse répétées pour un budget, des postes, des lits et des salaires décents pour ces indispensables personnels et établissements et nos sociétés vieillissantes, de malades chroniques, de populations entières usées à vitesse accélérée sont devenus inaudibles à ces sourdes oreilles qui ne regardent que les courbes de chiffres et des économies, maître-mots de la bêtise du pouvoir au service de riches rapaces qui en veulent toujours plus, craignant pour leurs fortunes colossales, les manants qui se plaignent quand ils ne crèvent pas de faim (pas encore, pas tous...) ou de froid (faut traverser la route mon gars et la nuit, rentrer dans sa passoire thermique !)". Où se situe la violence ?
Comme le soulignent Déborah Ridel et Ivan Sainsaulieu, le travail soignant est de plus en plus empêché par des fonctionnements hiérarchiques qui entravent la coopération et les dynamiques collectives, en individualisant ou en déléguant les tâches les plus éprouvantes. Par ailleurs, "la gestionnarisation désincarnée se présente comme un flux de tâches dématérialisées top-down qui peut aller jusqu’à nier le besoin d’encadrement local". Dès lors, "les soignant-e-s ont l’impression que leur travail est dévoyé au profit d’un système managérial n’apportant pas les solutions aux problèmes qu’ils et elles rencontrent. Le « nez dans le guidon », les soignant-e-s ne parviennent plus à prendre le recul nécessaire que permet une « régulation autonome ». Ainsi, la désorganisation du travail collectif a pour conséquence une forme de démobilisation au travail". Au nom d'une "qualité de soin abstraite, codifiée dans un ailleurs a-topique (l’ars), et d’un management par projets supposé participatif", les collectifs voient donc leurs espace de sociabilité et d'entraide se réduire comme pot de chagrin. Outre la démobilisation, le ras-le-bol, l'épuisement ou la fuite, on constate également que le "local est sanctuarisé sur un plan sécuritaire", avec tous les effets de violence que cela peut induire, tant pour les professionnels que pour les usagers. Où se situe la violence ?
Quid des patients délaissés, des situations réelles de privation de soin, ou des conditions d’exercice rendues indignes ? Quid de la iatrogénie, des prescriptions massives et systématiques en dépit des effets potentiellement délétères, des personnes qui meurent sur des brancards, à l'abandon, ou de ceux qui sont obligés de renoncer à consulter, faute de droits, ou faute d'accès réel à des soignants ? Quid des patients uniquement "pris en charge" sur des Centres Experts afin d'extraire leurs données, de les inclure dans des cohortes, et de pouvoir publier des résultats ? Quid de l'abandon des services publics, de la transformation de la santé en filière lucrative, de l'institutionnalisation d'une médecine à plusieurs vitesses ? Où se situe la violence ?
Un étrange revirement est en train de s'opérer dans nos sociétés contemporaines : en effet, être sujet de soins est de plus en plus perçu comme une tare ou une discrimination. En conséquence, il faudrait évacuer toute reconnaissance de souffrance, de vulnérabilité ou d'affection. Et quiconque oserait pouvoir appréhender ces dimensions inhérentes à notre condition humaine serait désormais perçu comme suspect de vouloir exercer une forme de violence. Car en lieu et place du soin, il est dorénavant exigé prioritairement la validation d'une "condition identitaire" associé à la revendication exclusive de Droits en rapport avec un état, pour ne pas dire une essence. Il faut donc diagnostiquer, à la pelle, catégoriser, officialiser, créer du flux d'informations, mais ne surtout pas envisager du Soin, insupportable ingérence.
En tout cas, les soignants se trouvent de plus en plus exposés à des injonctions paradoxales, pris en étau et écartelés entre des "recommandations" autoritaires de la part des tutelles, entre des protocoles gestionnaires émanant des administratifs, entre des contraintes médico-légales de plus en plus serrées, entre des attentes consuméristes et inassouvissables venant des usagers, le tout avec des conditions de pratiques tout à fait dégradées.
Dans une étude publiée en 2017 sur « l’expérience de la violence dans le secteur de la santé », Cécile Carra et Déborah Ridel rapportent ainsi des chiffres très élevés de « victimation » chez les soignants –jusqu’à 57%. Ce vécu s’inscrit notamment dans les interactions avec les usagers, l’expérience de la violence s’actualisant « en multiples incidents émaillant un quotidien professionnel se révélant sous tension ».
Par ailleurs, l’enquête fait « émerger le poids des normes professionnelles dans la lecture de la violence ». « L’écart à ces normes, visible dans les interactions à travers des divergences de perspectives et d’intérêts, tend à révéler une dynamique de « tensions confrontationnelles » ».
Ainsi, « cette expérience se construit dans un contexte marqué par une reconfiguration des relations entre usagers et soignants et un contexte de confrontation entre logiques de soin et logiques managériales mettant à mal le soin relationnel et donc le fondement même de la légitimité des soignants. La légitimité est liée au pouvoir, pouvoir de définir son territoire et ses prérogatives, ce pouvoir se réduisant d’un côté avec les nouveaux droits des usagers et de l’autre avec le nouveau management public et les exigences de performance. L’expression victimaire apparaît alors à la fois manifestation d’une identité professionnelle meurtrie et tentative de peser sur les rapports sociaux de travail dans une revendication identitaire ou, pour le moins, dans une quête de reconnaissance professionnelle ».
Les soignants, comme les usagers, pourraient ainsi être « victimes » de stratégies managériales autoritaires ?
Dans Mediapart, Clotilde de Gastines enquête par exemple sur les maltraitances institutionnelles dans un Centre Spécialisé accueillant des enfants sourds et polyhandicapés. Or, il apparaît que ces dérives sont très en rapport avec la gestion administrative, les modalités de gouvernance et la souffrance professionnelle induite. Le pédopsychiatre Jean-Michel Delaroche l'affirme sans ambages : « les maltraitances sur les enfants sont en général indissociables de la souffrance des professionnels, or cette dernière est devenue insoutenable. ». Dans le cas particulier de cet établissement, la situation semble s'être dégradée suite à l'arrivée d'une nouvelle direction, ayant induit une dégradation de l'accompagnement et des prises en charge, au nom d'impératifs gestionnaires ou idéologiques. Depuis, "des familles aussi sont inquiètes face aux ruptures d’accompagnement, à la dégradation de la qualité des soins et du travail éducatif. ». Et, "l’inspection et la médecine du travail s’inquiètent, de leur côté, pour la santé mentale des équipes", du fait notamment d'une "surcharge de travail liée au manque de personnel (départs, arrêt maladie sans remplacement selon eux) ou à l’organisation du travail (déplacement de personnel, activités connexes prenant sur le cœur de métier) ". Alors que les professionnels en souffrance décrivent un "climat social fait d’éclats de voix, d’avertissements et de menaces de procédures disciplinaires", la directrice estime que ces alertes sont le fait d'un « groupuscule de quelques personnes qui font part de difficultés imaginaires »....Où se situe la violence ?
A l’hôpital psychiatrique également, les abus semblent se multiplier, à mesure que s’étend la mainmise d’une administration de plus en plus hypertrophiée et décomplexée. Dans « le Parisien », plusieurs soignants ont ainsi pu témoigner du fait qu’« en dénonçant des dérives comme l’isolement et la contention, ils se retrouvent « harcelés », « placardisés », « mis à pied » par leur direction ». Où se situe la violence ?
La situation du Dr Bellahsen, psychiatre, est à ce titre exemplaire : ayant constaté que, sous le prétexte de la menace épidémique, l’administration de son Établissement Psychiatrique de Secteur avait décidé unilatéralement de cloîtrer des patients pris en charge en unité ouverte, il décide d’alerter la Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté, une autorité indépendante. Sur place, celle-ci découvre des patients « enfermés à clé 24 heures sur 24 sans que leur état clinique psychiatrique le justifie, sans décision médicale écrite émanant d’un psychiatre ni traçabilité et, au surplus, dans des espaces dangereux et non aménagés à cet effet ». Outre la « confusion absolue entre les notions de confinement sanitaire et d’isolement psychiatrique » ainsi que les « violations graves des libertés fondamentales », il est également insisté sur des « conditions indignes » de cet isolement absolument illégal…
Conséquences logiques, le Dr Bellahsen se voit remercié de son poste de Chef de Pôle, l’équipe soignante est démembrée, le service remanié selon des impératifs gestionnaires, et la directrice de l’établissement se voit décorée de la médaille de chevalier de l’ordre national du mérite…
Où se situe la violence ?
Comme le souligne justement Mathieu Bellahsen, « l’hôpital public est à l’image de ce que deviennent les institutions, des lieux où les abus sont à la fois masqués et encouragés. Un lieu où celles et ceux qui s’élèvent contre ces perversions généralisées sont sévèrement réprimés ».
Et, s’il existe effectivement « une mécanique de la répression », « elle doit certainement être expliquée dans les précis de management qui servent de bibles à celles et ceux qui ont le pouvoir ». De fait, la perversité managériale consiste notamment à faire « endosser » par les praticiens l’irresponsabilité voire la maltraitance des dirigeants. Ainsi, « la désagrégation des collectifs de travail renvoie chacun à sa responsabilité individuelle et exonère le système (et donc les dirigeants) de sa responsabilité globale ». Dès lors, les professionnels se voient accablés, désignés, dénigrés, culpabilisés, alors même que l’implication des managers et autres experts bureaucrates hors-sol est d’emblée évacuée. Ainsi, retranchés dans leur forteresse de l’ARS, un Michel Laforcade ou un Saïd Acef ont-ils pu, en toute impunité, démanteler le secteur médico-social de la pédopsychiatrie en région Nouvelle-Aquitaine, avant d’être promus sur des postes nationaux sans même avoir à assumer les conséquences de leurs saccages...Où se situe la violence ?

Agrandissement : Illustration 2

Et voilà encore ce dont s'indigne le Pr Pierre Delion : "la psychiatrie est dans cet état déplorable depuis des lustres malgré les efforts des soignants qui font ce qu’ils peuvent pour sauver le soin psychique de la barbarie annoncée. Pourtant, les multiples dénonciations émises par les perchés du Havre, les grévistes de la faim de Rouen, les CMPP d’Aquitaine, les soignants d’Asnières, et de très nombreux services sectorisés réduits à l’impuissance s’accumulent depuis des années sans rien déclencher de significatif de la part des pouvoirs publiques.La psychiatrie se meurt et nos dirigeants regardent ailleurs, vers les résultats attendus de promesses lointaines des neurosciences et des techniques comportementales"...Où se situe la violence ?
Sans chercher à hiérarchiser les violences en fonction de leur « (il)légitimité sociale » et de leur « (in)acceptabilité collective », force est de reconnaitre la complexité de phénomènes multiples, plus ou moins intriqués ou contradictoires, dépassant largement les enjeux interpersonnels.
Le risque des discours simplificateurs serait alors d’en venir à associer systématiquement le soin à la violence, de façon intrinsèque et univoque. Alors certes, on peut reconnaitre que tout acte de soin est porteur d’une forme de violence, ne serait-ce qu’en reconnaissant la nécessité d’une intervention par rapport à une « souffrance ». Que ce soit un geste chirurgical, une prescription médicamenteuse, une hospitalisation sous contrainte, un signalement, des séances de kinésithérapie, une interprétation psychanalytique, etc., la dimension thérapeutique peut effectivement nécessiter une forme d’effraction, de bousculement, voire d’intrusion ou d’ingérence. Cependant, ce qui peut permettre de tolérer cette « violence » ponctuelle, c’est non seulement la finalité recherchée vis-à-vis d’une situation singulière – à savoir la restauration maximale de l’autonomie et du bien-être d’un sujet incarné -, mais aussi le recueil de l’adhésion et du consentement, sans pression ni intimidation – même si des situations limites existent : inconscience, très jeunes enfants, patients délirants ou déments, etc., et même si les injonctions collectives à la norme seront toujours présentes en arrière-plan. Au passage, notons à nouveau que les situations des marges concernant les personnes dont la faculté de jugement est altérée, ou immature, ou empêchée sont systématiquement scotomisées. On postule toujours une capacité a priori de décider, de choisir, en pleine conscience, en déniant du même mouvement tous les phénomènes d'aliénation, d'influence voire d'instrumentalisation ou d'emprise...Évidemment, ces réalités viennent mettre à mal la fable néolibérale du consommateur éclairé et rationnel, affirmant ses droits à participer librement à la logique du marché....Par un coup de force, il faut donc contraindre la réalité à s'inscrire dans l'idéologie. Tant pis pour les sujets les plus vulnérables et les plus susceptibles d'être "sous influence", puisqu'on vous dit que c'est forcément pour leur bien...
En tout cas, s'extraire de ces montages fictionnels et de ses présupposés rhétoriques suppose à chaque fois une évaluation spécifique, une rencontre, une écoute, une attention, bien au-delà de l’application standardisée de protocoles et de procédures formelles. Dès lors, tout ce qui serait la norme, le systématique, l’automatique devrait être suspect, car potentiellement vecteur d’une violence allant au-delà de l’impératif déontologique du soin.
Par exemple, que penser de cette affirmation de François Ruffin, qui, par ailleurs, est pourtant un homme politique véritablement engagé auprès des personnes vulnérables et précaires : « la règle, pour moi, c’est plutôt l’inclusion » ? De fait, répétons-le, il ne devrait pas y avoir de règle, et encore moins de « pour moi » - sinon, il s’agit tout simplement de projeter ses propres convictions idéologiques en les imposant à la complexité du réel.
Cependant, le député Insoumis fait aussi preuve de réalisme et tempère aussitôt son propos concernant ce « dogme qui reviendrait à dire : tous à l’école et tous, également, une fois adultes, dans le monde du travail. Cette doctrine aujourd’hui ne rend pas tout le monde heureux. Elle interdit que des solutions, adaptées à chaque personne, à chaque parcours, soient recherchées, trouvées. Alors que oui, des parents témoignent que leurs enfants se sont épanouis dans des « institutions », et je ne veux pas les diaboliser ». C’est sympa, merci pour eux !
Il faut dire qu'on n'en est plus à une contre-vérité près concernant la stigmatisation systématique des institutions soignantes, diabolisées, dénigrées, sans même faire l'effort de savoir ce qui s'y fait concrètement. Combien de fois ai-je entendu l'accusation que "sur un Institut Médico-Educatif, il n'y aurait pas d'éducations ni d'apprentissages" - les enseignants spécialisés et les éducateur apprécieront... ? Que ces institutions violeraient donc le droit fondamental à l'éducation ? Voilà encore les effets d'affirmations hors-sol, faisant violence au réel, à l'engagement des professionnels comme à la confiance des familles...
Cependant, il est toujours aussi essentiel d’en revenir aux pratiques, aux vécus des personnes concernées et à leurs témoignages, à l’instar de l’association Autis’Mob qui nous rappelle que « l’école – l’Education Nationale – est une institution, avec ses codes, ses normes parfois rigides, sa propre toxicité actuelle de fonctionnement vis-à-vis de certains élèves et certains enseignants. Opposer « l’école ordinaire » et « les institutions » est artificiel. La « désinstitutionalisation » devient un mot d’ordre vide de sens s’il s’agit, comme c’est le cas avec les politiques contemporaines, de supprimer les lieux spécialisés dans l’accueil des enfants en situation de handicap au profit d’un accueil en école ordinaire sans pédagogie différenciée ».
Et que, « à l’heure actuelle, nous estimons que le secrétariat d’Etat du handicap récupère de façon opportuniste le mot d’ordre de désinstitutionalisation de certains militants anti-validistes (du combat desquels nous nous réclamons), pour instaurer une « inclusion » de façade, qui consiste, toute simplement, à faire des économies en supprimant les lieux de soin du service public ou subventionnés, sans déployer de moyens suffisants pour une scolarisation dans de bonnes conditions des élèves en situation de handicap. Cette pseudo-inclusion est profondément validiste – le validisme étant l’idéologie selon laquelle la norme de l’existence humaine est l’absence de maladie ou d’infirmité ».
De fait, comme le souligne Julia Slan dans « Marianne », « d’un côté, des économies budgétaires sont réalisées sur le dos de l’école où le coût de la scolarité (6 300 €/ an / élève en primaire) est 6 à 11 fois moins élevé qu’en institut spécialisé (entre 39 000€ et 72 000€/an/élève) de l’autre, l’obtention rapide d’une place à l’école permet d’éviter les années d’attente, très impopulaires, sur les listes des Instituts (1 à 10 ans) ». En outre, « plusieurs enquêtes menées auprès des élèves en situation de handicap ont pu mettre en évidence leur mal-être en classe ordinaire et une meilleure estime d’eux-mêmes dans des structures spécialisées, plus adaptées à leurs besoins spécifiques ».
Ainsi, pour J.-C. Maleval, “l’inclusion scolaire pour tous, il faut y insister, est un rêve bureaucratique, qui conduira à alourdir la charge des parents d’enfants autistes présentant des troubles sévères, faute de lieux pour les accueillir."
Et Valérie Gay-Corajoud de dénoncer l’inclusion « obligatoire », « comme si le mot en lui seul était porteur de solutions. Comme s’il suffisait de le clamer publiquement pour que tout s’arrange. Comme s’il était une vérité absolue, tel un coup de force philosophique ».
Dès lors, ne faut-il pas considérer que la violence, comme le diable, peut se situer dans les détails, et que l’enfer est manifestement pavé de bonnes intentions. A ne s’appesantir que sur les principes, sans considérer la réalité des situations, on en arrive à exercer une forme de violence tout à fait insidieuse, car non seulement elle est méconnue, mais en plus elle se drape de toutes les vertus, renvoyant immédiatement ses éventuels dénonciateurs dans le rang du Mal.
Pourtant, l’école aujourd’hui est « déjà infoutue de recevoir nos enfants sans handicaps. En l’état actuel, elle n’est qu’une machine à broyer, à écorner, à étouffer, à maltraiter ».
Sous couvert d’ouverture et d’accueil, les normes scolaires sont indéniablement omniprésentes, oppressantes. Et si ce n’est le cas, ce sont alors les illusions et les faux-semblants qui règnent en maître. Et la violence. Car, qu’est-ce d’autre que ce forçage, cette injonction à composer avec « la vie majoritaire et grouillante » (Clara Dupont-Monod S'adapter). « Leur pays voulait du solide, du bon rouage. Il n'aimait pas les différents. Il n'avait rien prévu pour eux » - en dehors des discours, des slogans ou des diktats.
Plutôt que de clamer, de prôner, d’édicter, d’imposer, il serait donc souhaitable que nos responsables politiques daignent se pencher sur la réalité des parcours, sur le calvaire des familles, sur la violence d’une administration sourdre et absconse….
« Dans les mairies, les services sociaux, les instances prétendument dédiées à l'aide des familles, les ministères, on leur enfonçait la tête sous l'eau, multipliant les difficultés. Le parcours était glacial, inhumain, jalonné d'acronymes, MDPH, ITEP, IME, IEM, CDAPH. Les interlocuteurs se montraient absurdement tatillons ou d'une odieuse nonchalance, cela dépendait ».
« On leur demanda aussi de dessiner un "projet de vie" alors que, de celle d'avant, il restait si peu. Les parents en croisèrent d'autres, brisés, à court d'argent, car les aides tardaient à tomber, ou ahuris parce qu'un département ne transmettait pas le dossier à un autre département, et qu'en cas de déménagement il fallait tout reprendre à zéro. Ils découvrirent l'obligation, tous les trois ans, de prouver que l'enfant était toujours handicapé (...). Entendirent un couple craquer car, visiblement, leur enfant n'était pas assez inadapté pour bénéficier d'aide, mais trop pour espérer être inséré ».
« Les parents découvrirent le grand no man's land des marges, peuplées d'êtres sans soin ni projet ni ami. Ils apprirent que la maladie mentale, handicap invisible, ajoutait une difficulté supplémentaire, "il faudrait que ma fille soit amochée physiquement pour que vous bougiez votre cul?" grinça un père à l'accueil d'un centre médico-social, ouvert seulement le matin » (Clara Dupont-Monod, S'adapter).
La voilà cette violence diffuse, insidieuse, invisible, loin, bien loin des prises de parole auto-satisfaites et calomnieuses.
Dès lors, comme le revendique Valérie Gay-Corajoud, « ce n’est pas l’inclusion à tout prix qu’il faut réclamer, mais des propositions pérennes qui placent en premier lieu le respect de la diversité, l’aide au cas par cas, le soutien de la différence, des projets de chacun et surtout, qui s’appuient sur la réalité et non sur un mirage politico-financier que d’aucuns font miroiter sans jamais agir une fois les urnes remplies puis remisées ».
Le regretté David Graeber insistait sur ce point dans son dernier ouvrage co-écrit avec David Wengrow : « toute philosophie égalitaire peut s’exprimer de deux façons : soit elle nie en bloc l’existence de spécificités individuelles, postulant que tous les êtres sont parfaitement identiques ou devraient être regardés comme tels ; soit au contraire elle insiste sur les bizarreries de chacun, décrétant l’impossibilité d’établir des classements généraux sur quelque fondement que ce soit tant nous sommes radicalement différents ».
De fait, cette alternative traverse actuellement les débats autour de l'institution et de l'inclusion. Faut-il défendre des Droits abstraits, formels, revendiqués par certains au nom de ceux qui ne pourront ni les formuler, ni s'en saisir ? Ou, au contraire, faut-il s'attacher à garantir réellement, concrètement, spécifiquement, l'émancipation et l'autonomie les plus élargies possibles de personne singulières, incarnées, en prise avec leurs entraves, leur histoire, leurs liens, leur contexte, leurs contraintes, etc. ? Faut-il reconnaitre et valoriser les différences, ou chercher à les abraser au sein de catégorisations désubjectivantes ? Faut-il affirmer la dignité inconditionnelle de toute modalité d'existence, ou faut-il imposer des normes et des gradients de valeurs ? A vous de voir où se situe la violence...
"D'une certaine manière, le travail de soin est l'exact opposé du travail mécanique. Il implique d'identifier et de comprendre les qualités, les besoins, les spécificités de l'être vivant dont on s'occupe -enfant, adulte, animal ou plante - afin de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour son épanouissement. En somme, il se distingue par son attention aux particularités" (Graeber et Wengrow). Or, l'organisation bureaucratique tend à "diriger cette pulsion de soin vers des abstractions", à détourner l'attention soignante vers l'entretien de la machinerie sociale, vers le renforcement des intérêts et des rapports de domination...De fait, "les pires inégalités naissent souvent de fictions d'égalité juridique", d'une conception de "l'égalité qui rend les gens (et les choses) interchangeables, permettant ainsi aux dirigeants ou à leurs partisans de formuler des exigences impersonnelles qui ne tiennent aucun compte des situations particulières". Dès lors, "les mécanismes bureaucratiques ne deviennent réellement monstrueux que lorsque le pouvoir souverain confère aux instances exécutives locales la capacité de déclarer : " Je ne veux pas le savoir : les règles sont les règles"". Voici donc la question que se posent l'anthropologue et l'archéologue par rapport à l'histoire des institutions : "Comment la liberté de promettre, de s'engager et de nouer des relations, a-t-elle pu être renversée en son exact contraire : le péonage, la servitude, et l'esclavage à vie ? Selon nous, c'est ce qui se produit lorsque les promesses deviennent impersonnelles et tranférables - en un mot lorsqu'elle se bureaucratisent". Ainsi, "on pourrait dire que l'argent est aux promesses ce que la bureaucratie est au principe de soin. Dans les deux cas, une composante de base de la vie sociale se voit corrompu par l'alliance des mathématiques et de la violence".
Dès lors, réaffirmer l'impératif du Soin véritable, c'est à dire d'une attention à la singularité et aux particularités, n'est autre qu'un acte de résistance face à cette violence du pouvoir institué. A bon entendeur.
"Penser un service comme instrument thérapeutique, c’est le structurer, c’est l’amener à être vécu par le malade comme ce qui « enfin comprend » et non comme ce qui ampute, ce qui châtre" Franz Fanon
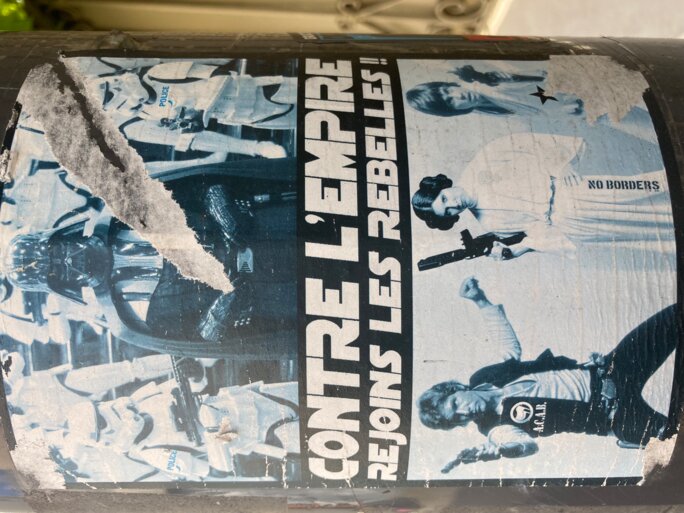
Agrandissement : Illustration 3




