N.B. Nous empruntons l’expression d’une ligne « au milieu de la pampa » à Jean-Marc Jancovici pour caractériser la situation du plateau de Saclay traversé par la ligne 18 [1]. Ce qui semble une absurdité est pourtant défendu par une majorité d’élus et d’institutions publiques, théoriquement chargés de défendre l’intérêt général et de veiller à la bonne utilisation des deniers publics.
Précisons que cet article porte uniquement sur les hypothèses de fréquentation du métro en projet 17 Nord par la population résidente et les actifs occupant les emplois situés dans le périmètre de proximité des gares. Un autre article suivra, consacré cette fois à l’utilité socio-économique de la 17 Nord, exprimée par la VAN (Valeur Actualisée Nette) qui compare les « avantages » fournis par la ligne (exprimés en euros), aux coûts de l’infrastructure.
I. Un transport en commun de TRANSIT ne peut assurer une fonction de DESSERTE
C’est l’argument massue utilisé par les dysménageurs : « Vous galérez dans les transports ? Nous avons la solution : le métro ! » Le métro ? Mais lequel ? Car « l’outil transport » n’est pas bon « en soi ». Un marteau peut aussi bien servir à écraser les doigts dans une salle de torture qu'à planter un clou pour accrocher un magnifique tableau. Qu’on en juge.
Tout le monde comprend qu’un TGV n’est pas assimilable à un train de banlieue. On a l’exemple cuisant de la gare dite « des betteraves » - située en Haute Picardie entre Amiens et Saint-Quentin en pleine campagne – qui n’a généré aucun développement économique. Pourtant, la même erreur a été récidivée avec d'autres gares, comme en témoigne cet extraordinaire "Voyage dans les gares TGV perdues en rase campagne" sur le site de France-info, avec cette photo au milieu de nulle part (figure 1) de la « Gare Meuse » du TGV Paris-Strasbourg qui a choisi un tracé direct évitant les villes. Ce reportage pourrait présager la fréquentation de la future gare du Triangle de Gonesse, si les promoteurs continuent à s’entêter. Car ces derniers n’ont tiré aucune conséquence de ces mauvais exemples.

Agrandissement : Illustration 1

I.1./ Rappelons quelques évidences trop oubliées. Un « transport de TRANSIT » sert à relier rapidement deux pôles distants, situés aux extrémités.
Cet objectif suppose une infrastructure lourde, déployée sur un vaste espace, destinée à transporter d’importantes masses de populations, nécessitant en zone urbaine des tunnels ou des viaducs. Pour que la traversée soit rapide - fonction de TRANSIT - il doit être direct ou semi-direct avec peu d’arrêts. Il est censé répondre à des besoins d’aménagement du territoire, c’est pourquoi il est dit « structurant ». Mais dans la pratique, ces besoins sont rarement démontrés, on se dispense de les évaluer en partant de l'idée absurde que toute nouvelle offre de transport est toujours bonne à prendre et qu'elle va générer sa propre demande. Comme l'a démontré l'urbaniste Jean-Marc Offner, l'effet structurant des transports « en soi » n'existe guère, c'est « un mythe politique et une mystification scientifique ».
Le Grand Paris Express (GPE) illustre ces contradictions. C'est une infrastructure lourde, conçue par le ministre Christian Blanc pour relier entre eux rapidement ( d'où le qualificatif « express ») des grands pôles de développement, représentatifs de "l'excellence métropolitaine" et accélérateurs de performance de "Paris-Ville monde". Un objectif dont l'utilité socio-économique n'a été interrogée que par un groupe d'experts (essentiellement des économistes des transports, aucun ne couvrant le champ social), dont les avis n'ont d'ailleurs guère été pris en compte. Le GPE s'étendant sur le vaste espace de la Métropole du Grand Paris ne peut desservir les populations locales - fonction de DESSERTE -. Les gares du GPE sont distantes de 2-3 km ; il est même programmé une section à travers champs de 7 km sur le tronçon Saclay-Versailles de la ligne 18, du jamais vu pour un métro (comment lui laisser un tel qualificatif ?) Rappelons que dans Paris, les stations de métro sont distantes en moyenne de 570 m. Ceci n’est rentable qu’en zone agglomérée dense. En dessous d’un trafic de 200 000 flux/ jour, un tramway de type « Boulevard des Maréchaux » suffit.
Les millions de touristes qui débarquent à Roissy-CDG n’ont qu’une hâte : se retrouver au pied de la tour Eiffel. Pas question de leur proposer de musarder avec un trajet omnibus : ils prendront le CDG Express direct ou les taxis, s’ils sont plusieurs. Citons encore les centaines de milliers de personnes qui vont transiter à Saint-Denis/Pleyel, quand l’ensemble de ce « hub de transports » en étoile sera totalement opérationnel. La plupart ne fera que traverser le territoire et cet évitement démontrera une fois encore l’erreur manifeste de jugement de Christian Blanc : les gares sont rarement des lieux de DESTINATION (pouvant accueillir un programme de logements et de bureaux conséquent), notamment celles du GPE situées en zone-dortoir ou en périphérie qui constituent principalement, voire exclusivement des lieux de passage. On peut citer l'exemple de la gare la plus fréquentée de France hors Paris, celle de Juvisy-sur-Orge, au cœur de la Vallée de l'Orge, une zone record de pénurie d'emplois en Ile-de-France, qui n'a jamais pu constituer un pôle de développement économique, malgré plusieurs tentatives avortées. C'est bien aussi le cas de la gare du Triangle de Gonesse, localisée au milieu de la pampa ! De tels exemples mettent en évidence qu'une infrastructure de transport n'est pas mécaniquement créatrice d'emplois, postulat central dans la « vision » de la Société des Grands Projets (SGP, anciennement Société du Grand Paris).
Pourtant, la majorité des élus du Val d’Oise et les institutions régionales continuent de répéter à l’envi que la ligne 17 Nord représente la chance unique de « désenclaver le territoire de l’Est-95 », ce qui est absurde. Comment peut-on qualifier d’« enclavé » un espace aussi ouvert que la plaine de France, traversée dès l’époque gallo-romaine par l’axe millénaire de la « route des Flandres » ? Celle-ci a généré un important trafic marchand dont les fameuses « foires du Lendit » à St Denis dès l’an 800 de notre ère. Et cet openfield accueille aujourd’hui l’axe le plus fréquenté d’Europe : l’autoroute A1, avec un nombre de véhicules/ jour (dont 1/4 de poids lourds) entre 120 000 et 170 000. Il faut ajouter des axes routiers majeurs comme l’autoroute A16, les nationales 1, 16 et 17 rebaptisées RD 301, 316 et 317, la RN 2 et RN 3. Et deux RER parmi les plus fréquentés de France : un million de passagers/ jour pour le RER B et 600 000 pour le RER D. Sans compter le 10ème aéroport mondial et le 2ème européen, Roissy avec ses 60 à 70 millions de passagers ; et le premier aéroport d’affaires d’Europe, Le Bourget, avec ses 57 000 mouvements d’avions/an. On fait plus « enclavé » ! Par contre, il est vrai que le territoire est « segmenté » par les servitudes de ces grands axes métropolitains qui le traversent et le découpent sans desservir le territoire local.
I.2 / A l’opposé d’un transport de transit, focalisons-nous cette fois sur un transport en commun qui assure une fonction de DESSERTE.
Celui-ci relie successivement différents lieux d’un bassin d’habitat local ou de plusieurs bassins. Il ne nécessite qu’une infrastructure légère, en aérien, avec ou sans chaussées séparées. Le trajet est lent, avec beaucoup d’arrêts qui déterminent son caractère « omnibus » (étymologiquement = « pour tous »). Ses nombreuses stations faiblement distantes permettent de faire du cabotage » de ville en ville, drainant ainsi une multitude de passagers locaux, dans un renouvellement rapide de trajets courts. Ce transport de desserte doit se combiner avec des bus de rabattement, des pistes cyclables ou encore des chemins piétons, pour former un véritable maillage des territoires locaux habités, à la différence d’un transport de transit qui est linéaire et peut traverser des espaces peu denses. A cet égard, les 3 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) prévus dans l'Est du Val d'Oise pour aboutir au Triangle de Gonesse, en pleine pampa ne peuvent tricoter aucun maillage territorial ! Bien entendu, le coût d’un transport de desserte est beaucoup moins élevé que celui d’un transport de transit. Un exemple : un tramway requiert environ 25 millions/€ le km ; le prolongement de la ligne 14 revient à environ 250 millions/€ le km.
Pour toutes les raisons évoquées plus haut, un transport de desserte n’est utile au territoire que s’il répond au principal besoin de déplacements de celui-ci : relier des pôles d’habitat (donc de main-d’œuvre) à des pôles d’emploi (voir explications en encadré). C’est le cas de la ligne 15 Sud du GPE, du Pont de Sèvres jusqu’à Créteil. Ce n’est pas le cas pour le tronçon de la ligne 16 allant vers l’Est de Champigny-sur-Marne - une commune-dortoir du Val de Marne – à Noisy-Champ, un des secteurs de Marne-la-Vallée qui n’a pas assez d’emplois pour ses propres habitants. Ou encore vers le Nord-Ouest le segment reliant Clichy-Montfermeil à Sevran, qui devrait disposer de deux nouvelles gares du GPE s’additionnant aux deux gares existantes du RER B !! Qu’on nous explique comment, en aggravant le caractère centrifuge de ces communes-dortoirs par une nouvelle offre de transport, on les rendrait plus attractives… Malgré la nécessité de construire des réponses pertinentes, aucune réflexion n’a été conduite sur les possibilités de « transport évité » qui auraient été obtenues, en réorientant les budgets vers un programme de développement d’activités de proximité qui recruteraient sur place, supprimant ainsi à la source le besoin de déplacement.
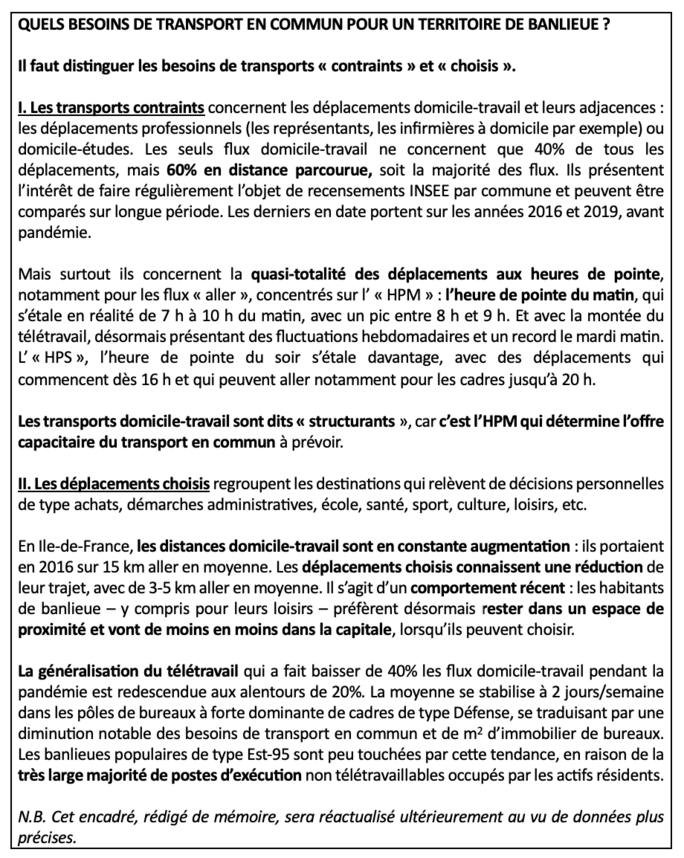
Agrandissement : Illustration 2
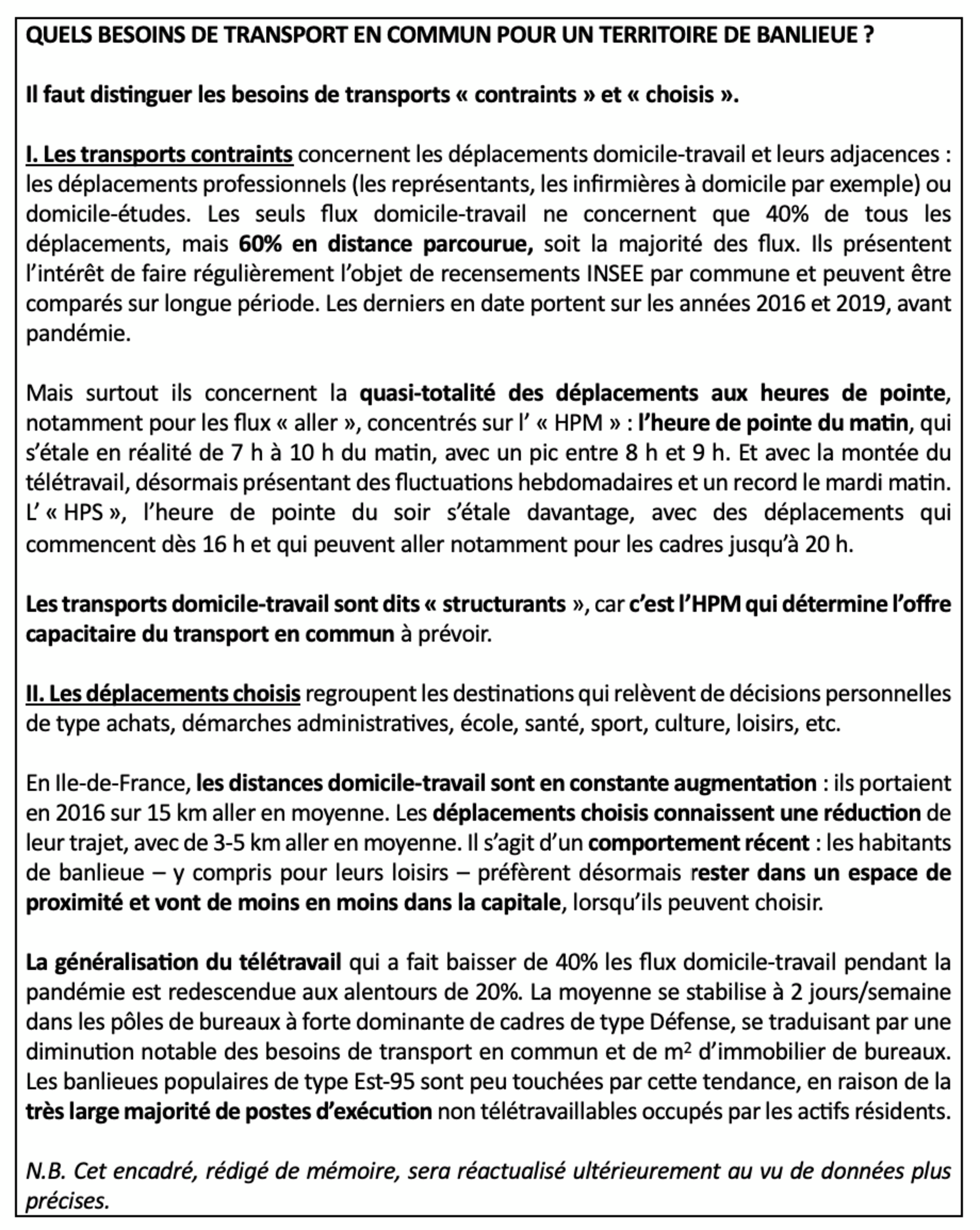
Pour conclure, la ligne 17 Nord est un transport de transit et non de desserte, comme toutes les lignes du GPE. Mais elle cumule deux handicaps supplémentaires qui la rendent particulièrement inapte à desservir le territoire de l’Est-95 :
- son tracé est en radiale (liaison entre le centre de l’agglomération et la périphérie, à l’instar du rayon d’un cercle) et non en rocade (liaison des banlieues entre elles en contournant le centre de l’agglomération, sous forme d’un anneau circulaire), alors qu'un des objectifs du GPE est de fournir une offre alternative aux RER ;
- elle se situe en territoire périurbain, comme la ligne 18.
C’est la seule ligne du Grand Paris Express pénalisée par ces deux caractéristiques : c’est pourquoi le rapport avantages/ coûts de cette offre de transport lourd au regard des populations locales desservies serait largement négatif, si des manipulations statistiques portant à la fois sur les hypothèses de fréquentation et sur l’utilité socio-économique de la ligne, n’avaient été effectuées par ses promoteurs. Nous analysons ici le premier point – la surestimation des usagers - dans les pages qui suivent.
II A la recherche désespérée d’USAGERS pour justifier les gares
Précisons au départ qu’au niveau international, on justifie un transport lourd en comptabilisant ce qu’on appelle la « densité humaine » (qui additionne les habitants et/ou les emplois par hectare) calculée dans un périmètre de proximité de 800 m de rayon autour des gares (soit au maximum à 10 mn de marche à pied). Une distance majorée à 1000 m par la SGP, par une décision unilatérale appliquée aux 68 gares, rajoutant une surface de 20% de foncier, sans aucune explication. D’après l’expert des transports Jean Vivier [2], la densité humaine requise doit être de 100 par hectare (populations + emplois) pour justifier une gare de métro. Dans l’étude intitulée « Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris » effectuée par l’Atelier d’Urbanisme APUR [3] et citée dans un autre article de ce blog, il est indiqué pour la ligne 17 Nord une densité humaine moyenne de 6/ ha (cf. points I.2 et II du texte et graphique de la figure 3 de l’article). Certes, cette évaluation a été établie en 2012, mais toutes les manipulations statistiques pour majorer la fréquentation des gares de la 17 Nord ne sauraient effacer un tel écart !
II.1/ Le Bourget : la « gare des milliardaires », une gare de trop
Faciliter la liaison entre deux aéroports qui par définition interdisent l’habitat ne rend qu’exceptionnellement service aux populations locales, tout au plus aux passagers, à condition qu’ils partagent les mêmes motifs de déplacements. Mais relier Le Bourget avec Roissy-CDG semble un bien mauvais mariage. En effet, Le Bourget se classe au premier rang européen des « aéroports d’affaires », d’où sa fréquentation par des V.I.P. Franciliens grands utilisateurs de jets privés. Si la première gare « Le Bourget-RER » remplit une fonction utile d’interconnexion comme son nom l’indique, on s’interroge sur la nécessité d’une deuxième gare sur la commune – « Le Bourget-Aéroport » – fréquentée pour l’essentiel par une jet-set qui ne prend jamais le métro ! Pour se rendre à l’aérogare, elle utilise le plus souvent des voitures avec chauffeur, ou des taxis. Et on ne voit pas l'intérêt de relier les deux aéroports, fréquentés par deux catégories d'usagers radicalement différentes. On n'imagine guère nos V.I.P. emprunter un métro pour se mêler au « vulgum pecus » du pôle aéroportuaire de Roissy. Dans une enquête effectuée par Reporterre sur l’aéroport du Bourget, on découvre même que certains « ultra-riches » n’hésitent pas à utiliser leur jet privé pour se rendre à Roissy, 13 km !!
Apparemment, les promoteurs de la gare des milliardaires ont anticipé les critiques de fréquentation, puisque dans les prévisions établies par la SGP, on relève une drôle d’entourloupe statistique, destinée à majorer significativement l’utilité socio-économique de deux arrêts sur la même commune. Sur le site de l'organisme, il est indiqué que chacune des deux gares desservirait une population de 19 000 personnes. Pourtant, la ville du Bourget ne compte que 14 800 habitants (INSEE 2020) : ils seraient donc comptés deux fois. Déjà, affecter 100% d’une population à l’utilisation d’un métro, du nourrisson au vieillard apparaît hautement discutable. Mais d’où sortent ces deux lots supplémentaires de 4000 habitants ? Sur une carte du quartier de gare Le Bourget-Aéroport (figure 6 d’un autre article de ce blog), on constate que le périmètre de proximité couvre pour l’essentiel la plateforme aéroportuaire sans habitants située sur les communes du Bourget et de Dugny. La partie habitée concerne le quartier de l’Aviation, dans la ville de Blanc-Mesnil, mais celle-ci est déjà prise en compte pour la ligne 16. Et en tout cas, rien ne justifie de multiplier la population du Bourget par 2…
Par ailleurs, la SGP raisonne en occultant la part qui continuerait d'être assurée par l'offre de transports en commun existante qui est conséquente, notamment le RER B, sans compter la rocade en tram-train T11, dont pour le moment seul un tronçon fonctionne sur le trajet Épinay-sur-Seine / Le Bourget.
--> Au lieu de l’affichage de 38.000 personnes desservies, j’arrive au mieux à 12 ou 13000 usagers potentiels à répartir entre les deux gares dans la proportion de 2/3 au sud, 1/3 au nord, sans oublier les flux assurés par le RER B… Et il faut rajouter 3500 emplois liés au pôle d'activités du Bourget. Un chiffre de fréquentation qui nécessiterait tout au plus un BHNS.
II.2. Triangle de Gonesse : la « gare des vers de terre » ?
Nous avons déjà amplement couvert la question de l’inutilité de cette gare en plein champ, nous vous renvoyons notamment à un autre article de ce blog « les vers de terre ne prennent pas le métro ». Focalisons-nous sur le projet de Cité scolaire, une tentative désespérée portée par ses promoteurs pour tenter de justifier la gare du Triangle.
Un projet en décalage complet avec la réalité, cumulant les inadéquations :
- a/ Comment justifier une ligne de métro 17 Nord au service des usagers, alors que 5 gares sur 6 sont situées à l’écart des zones d’habitat?
- b/ Comment concevoir un « service public», comme la Cité scolaire du Triangle de Gonesse, dans un site sans habitants ? Par définition, un service public a besoin de « public » !
- Comment les « dysménageurs » pourraient-ils passer outre la règlementation, interdisant l’habitat permanent sur le site du Triangle de Gonesse, frappé par deux Plans d’Exposition au Bruit (PEB) ? Un tel site ne saurait accueillir un internat pour les jeunes et des logements de fonction pour les enseignants et le personnel !
- Comment garantir de bonnes conditions d’apprentissage aux futurs élèves, dans un cumul de nuisances sonores liées au trafic aérien de deux aéroports ? C’est la question posée par une tribune de professionnels du monde médical et éducatif.
- Comment choisir une localisation en totale périphérie Est des deux immenses bassins d’éducation de Gonesse et de Sarcelles (voir carte figure 3 de l’article), pour un équipement scolaire ? Celui-ci devrait être au cœur du territoire urbanisé, accessible pour les élèves en « transports doux ». C’est bien la preuve que cette offre n’a absolument pas été pensée au service des populations locales, malgré les affirmations.
- Comment drainer une population d’élèves dépendant de l’Académie de Versailles, en proposant une ligne de métro dont 4 gares sur 6 sont situées en Seine-St-Denis et une en Seine-et-Marne dans le périmètre de l’Académie de Créteil ?
- Comment choisir un site aussi inadapté pour la Cité scolaire, alors qu’une meilleure localisation à Villiers-le-Bel serait possible ? Une modification d’autant plus aisée que Grand Paris Aménagement (GPA) est à la fois l’aménageur du Triangle de Gonesse et d’une friche hospitalière à Villiers-le-Bel [5] beaucoup plus appropriée : située en plein cœur de l’Est-95, à côté de la gare Arnouville/Gonesse/Villiers-le-Bel du RER D, principale infrastructure de desserte du territoire.
Malgré ce cumul de questions sans réponses, la SGP, GPA et les élus du Val d’Oise - qui partagent la charge de défendre l’intérêt général des populations - persistent à promouvoir ce projet de gare parfaitement inutile, au milieu de la pampa, alors que d'autres sites seraient bien meilleurs... Et ce n’est pas le fait de remplacer l’intitulé de celle-ci, en troquant le vocable « Triangle de Gonesse » par « Gonesse » tout court, qui réduirait miraculeusement la distance entre l’emplacement pressenti pour la gare et les premières habitations de la ville, à 2,2 km, encore moins avec les quartiers les plus éloignés (dont La Fauconnière, qui abrite 28% des Gonessiens) à 4 ou 5 km (voir la carte de la figure 3 dans un autre article de ce blog).
--> Pour le moment, la gare du Triangle de Gonesse ne dessert aucune activité économique, ni aucun habitant dans un périmètre d’un km.
II.3. Parc International des Expositions (PIEX) : la gare du « virtuel »
Le site bénéficie déjà d’un arrêt du RER B, qui permet aux usagers de Villepinte de rejoindre directement Roissy. Ici encore, la gare du métro du GPE se situe au cœur de deux zones d’activités, sans habitants alentours. L’étude de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Aménagement (DRIEA) Ile-de-France [4] a identifié 11 000 salariés desservis (réactualisés à 15 000 en 2018) par cette gare de métro, sans préciser dans cet effectif l’importante proportion de travail saisonnier et sans déduire la part d’usagers qui continueraient d’emprunter le RER B.
Par ailleurs, la pandémie a affecté très durement la filière « congrès, séminaires » qui positionnait la France au premier rang mondial. Pendant le confinement, les entreprises ont découvert l’intérêt des « salons virtuels » qui permettent de réduire très fortement les coûts en frais de déplacement-hébergement de leur personnel… Une aubaine qui a fait chuter drastiquement la demande. Qu’on en juge : en 2019, l’IDF avait organisé 434 salons en présentiel, en 2022 on n’en compte plus que 212 ; ces salons ont accueilli 7,9 millions de visiteurs en 2019, ils ne sont plus que 2,1 millions en 2021. Dans ces conditions, l’essentiel de l’offre se repositionne sur le Parc d’exposition de Versailles et le projet d’extension du PIEX a beau être conservé dans le tableau d’affichage des projets du Grand Roissy, il n’est de fait pas à l’ordre du jour pour le moment. Il faudra attendre les prochaines années pour vérifier la confirmation de cette tendance [6].
--> Dans l’étude de la DRIEA réactualisée, il a été calculé 15 000 emplois desservis pour la gare du PIEX, un chiffre largement surestimé (part du RER B ?) et qui risque d'être révisé à la baisse dans l’avenir.
II.4. Gares CDG 2 et CDG 4 : quand les comptables voient double
Dans le SCOT de Roissy-Pays de France, nous relevons cette phrase qui précise l’objectif général du schéma d’aménagement : « consolider le moteur économique du Grand Roissy autour de l’écosystème aéroportuaire ». Un projet insoutenable au regard de l’urgence climatique. D’autant plus que l’argument « emploi » qui servait de prétexte à la croissance du trafic aérien n’est plus crédible : depuis 2008, il y a découplage entre la hausse du trafic aérien et la croissance des emplois (voir figure 1 d’un autre article de ce blog). Il est impossible de conserver longtemps l’exception dont bénéficie le trafic aérien : la non-taxation du kérosène. L’Europe en général et la France en particulier se révèlent d’une grande vulnérabilité par rapport au dérèglement climatique. Et on assiste à une accélération du processus qui ne permet plus de temporiser des décisions qui seront d’autant plus douloureuses qu’on les diffère.
Ici encore, la majoration des chiffres vient à la rescousse pour défendre ce 3ème transport lourd pour desservir le pôle aéroportuaire, qui bénéficie déjà du RER B, sans compter le CDG Express en construction. Il est indiqué sur le site de la SGP que la gare de Roissy-CDG 2 desservirait 92 000 emplois, mais ce même chiffre est indiqué également pour justifier Roissy-CDG 4 !! A nouveau, il s’agit d’un double compte. Le Terminal 4 étant repoussé aux calendes grecques, on suppose que CDG 4 est reporté d’autant. Reste donc la gare Roissy-CDG 2. Élément important du calcul : il ne faut pas oublier que la plateforme aéroportuaire est gigantesque : 3200 ha - l’équivalent de 10 arrondissements de Paris - nécessitant ½ h en transport en commun pour la traverser. On se reportera à un autre article de ce blog (cf. figure 3) qui remet les pendules à l'heure sur les soi-disant "gains de temps perdus" et qui pose la question qui fâche : si vous débarquez gare du Nord, êtes-vous arrivés si vous travaillez porte Maillot ?
Ainsi, comptabiliser la totalité des emplois de l’ensemble de la plateforme pour estimer la fréquentation de la gare CDG 2 est ici totalement exagéré. La DRIEA avait indiqué 35 500 emplois salariés dans l’aire d’attraction de la gare CDG 2 ; quand à la station CDG 4, il convient de mettre zéro. Par ailleurs, remettons en lumière deux autres questions cruciales évacuées :
1/ quelle est la part respective de flux qui serait assurée par ailleurs par les RER B et le CDG Express ?
2/ Les emplois une fois répartis, quel serait le report modal escompté de la voiture vers le métro ? Il serait sans doute très faible pour des raisons spécifiques au pôle aéroportuaire, comme on le verra au point III. Nous n’avons aucune réponse à ces deux questions.
--> Rien ne saurait justifier cette surestimation de près de 150 000 emplois ! Et le chiffre de 35 000 emplois doit être fortement redimensionné, pour tenir compte de l'offre concurrente de deux autres transports lourds et des perspectives très limitées du report voiture/métro. Nous ne disposons d’aucune analyse à la fois sur la répartition des usagers et le transfert modal. Ce qui n’empêche pas certains dysménageurs de promouvoir dès à présent une 4ème OFFRE DE TRANSPORT LOURD ( !!) pour desservir l’aéroport (projet de ligne 19 ?)
II.5. Le Mesnil-Amelot : la gare des « pendulaires »
Encore une gare dans la pampa ! On se trouve en plein déni du réel : comment justifier la mobilisation de 250 millions/€ du km pour desservir un village de 1080 habitants (INSEE 2020) qui est d’ailleurs presque entièrement situé en dehors du périmètre de proximité de la gare (les fameux 800 m autour) ? Certes, il faut rajouter environ 3000 emplois pour une petite zone d’activités dont l’extension est envisagée, mais qui serait repoussée aux calendes grecques, compte tenu d’une pléthore d’hectares disponibles dans les zones d’activités existantes du Grand Roissy, en manque d’investisseurs. Il faut garder en mémoire le fiasco du projet International Trade Center (ITC) détaillé au point I.2 d'un autre article de ce blog.
Le scénario de l’horreur qui se profile, c’est de multiplier les distances effectuées par ce qu’on appelle les « pendulaires » : les actifs qui effectuent un déplacement domicile-travail « aller » dans un sens (ici Banlieue -Paris) et un déplacement « retour » dans l’autre sens. En implantant une gare de métro dans un village en grande périphérie, se créé fatalement un appel d’air pour accueillir les classes populaires originaires de la banlieue dense, repoussées par la surenchère du foncier liée à l’arrivée des lignes du Grand Paris Express. Un phénomène très bien décrit dans le livre récemment paru sous le titre « Les naufragés du Grand Paris Express [7] ». Ici, cet étalement urbain massacrerait la vallée de la Goële, bijou écologique, avec la multiplication de petits lotissements bétonnant l’espace, échappant à l’insuffisante protection des terres agricoles. Avec les « effets rebond » que cette redistribution démographique entraînerait : rendre les travailleurs totalement tributaires de leur véhicule pour rejoindre la gare du Mesnil-Amelot ; accroître les temps de transport, augmenter les émissions de GES, supprimer des îlots de fraîcheur et des ressources alimentaires, etc...
III. Les caractéristiques des emplois de Roissy, réduisant fortement l’utilité d’une offre de TC lourd
L’encadré ci-après précise les obstacles qui empêchent les habitants des banlieues d’utiliser les transports en commun.
Dans le cas de l’Est-95, plusieurs phénomènes se conjuguent pour aggraver encore la faible fréquentation des TC par la large majorité de salariés de l’aéroport de Roissy :
- L’importance des « emplois postés », c’est-à-dire fonctionnant en horaires décalés. L’activité de l’aéroport s’exerçant en continu, sans couvre-feu, les prises de postes s’étalent sur 24 h ; les trajets s’effectuent en dehors des heures de pointe -donc des embouteillages - et en partie hors des heures ouvrables des transports en commun. Dans ce cas, prendre sa voiture constitue la meilleure des réponses, voire la seule.
- Les entreprises offrent de larges facilités aux possesseurs de voiture : ils bénéficient d’un stationnement gratuit et d’indemnités kilométriques. Et à l’embauche, il est souvent réclamé l’utilisation d’un véhicule, afin d’échapper aux aléas des transports en commun (travaux, grèves, accidents, pannes…)
C’est pourquoi le transfert modal escompté des travailleurs de Roissy, portant sur le report de la voiture vers les TC risquerait d’être très modeste. D'ailleurs, l’évaluation globale effectuée par la DRIEA [4] Ile-de-France du report modal grâce au GPE n'est que de + 0,9%, l'épaisseur du trait...
*
* *
Comme le suggère Philippe Subra dans un article récent paru dans la revue Hérodote : « Sans Europacity, le prolongement de la ligne 17 du GPE n’a guère de sens, d’autant que le CDG Express doit desservir l’aéroport de Roissy en 2027 (…) Les solutions alternatives avancées par l’État et la région (une cité scolaire, des entrepôts logistiques) peinent à convaincre : pourquoi sacrifier des terres agricoles pour si peu d’emplois ? »
On voit bien à travers notre analyse de la 17 N gare par gare, qu'aucune d'elles ne se justifie. Il n’y a pas d’intérêt supérieur de la Métropole pour défendre la ligne 17 Nord ; il n’y a pas non plus d’intérêt local significatif pour les habitants. Seuls, les élus s’accrochent à un mirage (que j'ai dénoncé dans un article dès 2010) et s’entêtent à démontrer qu’un métro « en soi » serait bon pour le territoire. Négligeant que ce dernier traverserait une pampa déserte d’humains, mais extrêmement habitée par des milliards d’espèces animales et végétales qui y résident depuis des millénaires et pourraient contribuer utilement au bien-être de l'espèce humaine locale...
NOTES
[1]Extrait d'une intervention de Jean-Marc Jancovici, devant une commission du Sénat en 2012, à propos de la ligne 18 : « métro au milieu de la pampa », « délire complet », gaspillage d’argent public », « peut-être une bonne idée en 1930, anachronique aujourd’hui ».
[2] Jean Vivier, ancien chef des services d’études de la RATP et ancien conseiller scientifique de l’Union internationale des transports publics.
[3] Atelier Parisien d’Urbanisme de Paris (APUR) chargé des études d’aménagement de la Métropole du Grand Paris, voir Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris, Monographie de la ligne 17, 2016.
[4] La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Aménagement (DRIEA), organisme rattaché à la Préfecture de Région est devenue depuis DRIEAT, avec l’ajout de la compétence Transports.
[5] La friche hospitalière de Villiers-le-Bel accueillait autrefois un équipement public au service du territoire. Grand Paris Aménagement (GPA) veut y faire un lotissement de 400 logements supplémentaires ajoutant encore plus d’habitants dans une zone couverte par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Roissy, dans laquelle il faut limiter l’accroissement des populations impactées. Les opposants considèrent que cette friche devrait accueillir en priorité un équipement au service des habitants qui subissent déjà les nuisances aériennes. C’est l’endroit idéal pour accueillir le projet de Cité scolaire, proche de ses futurs élèves.
[6] il faudra attendre l’été 2025 pour la parution du recensement 2022 et les années suivantes, pour vérifier s’il s’agit d’une tendance durable, comme on a tout lieu de le présager.
[7] Clerval Anne, Wojcik Laura, Les Naufragés du Grand Paris Express, Zones, 2024.



