acamh.onlinelibrary.wiley.com Traduction de " Editorial Perspective: How Sir Michael Rutter revolutionised our understanding of human development: An introduction to a systematic Digest of his life’s work"
Editorial : Comment Sir Michael Rutter a révolutionné notre compréhension du développement humain : Une introduction à un résumé systématique de l'œuvre de sa vie
.
Jim Stevenson - 27 décembre 2021
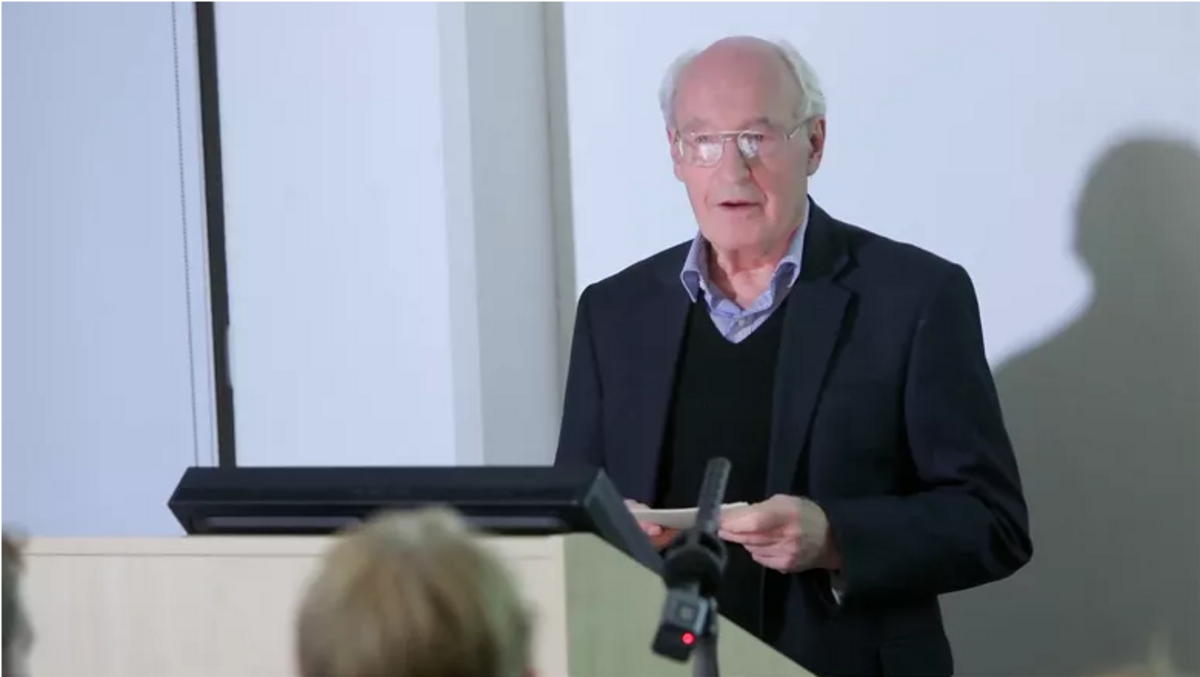
Agrandissement : Illustration 1
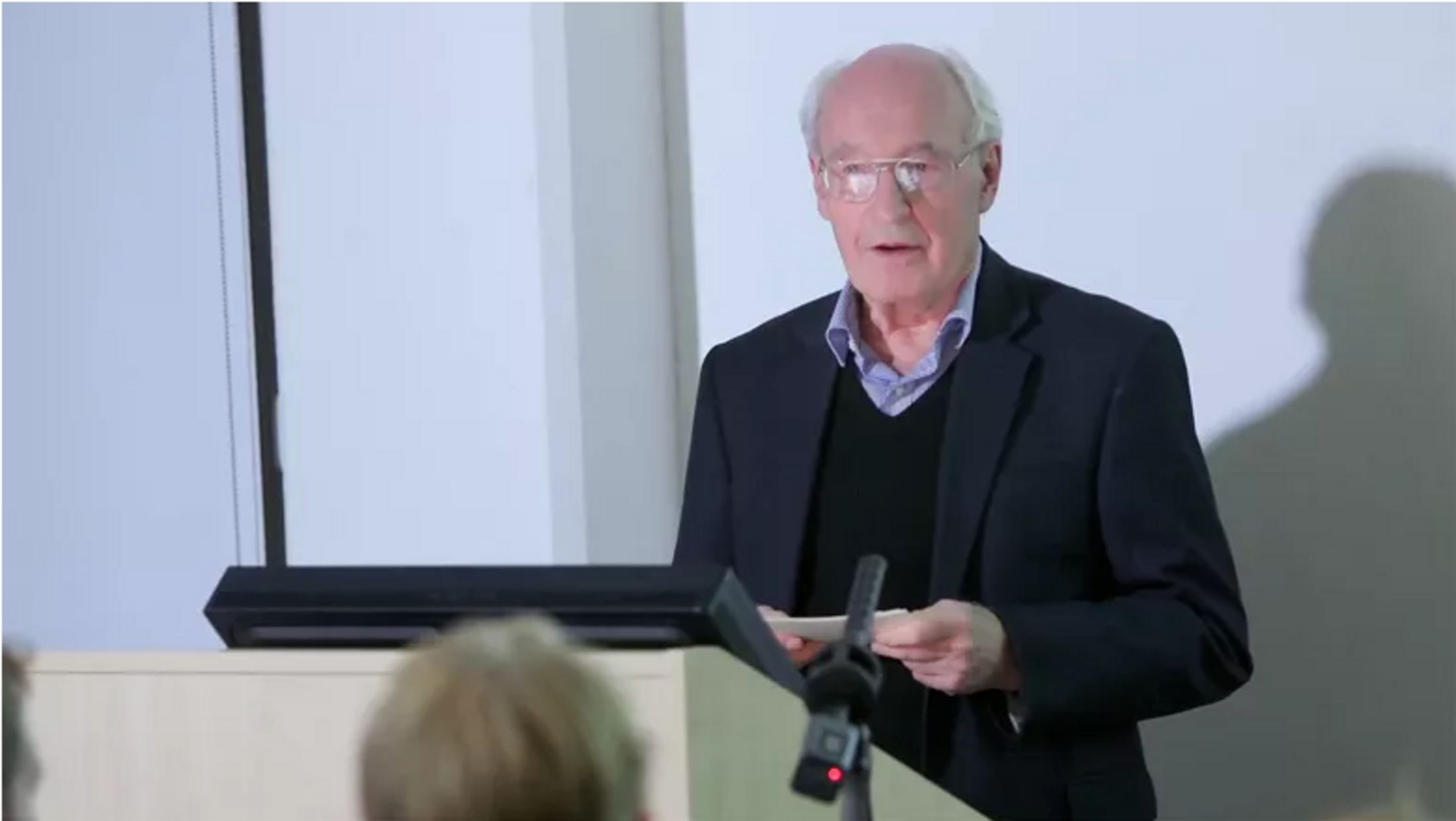
Le professeur Sir Michael Rutter est décédé le 23 octobre 2021. Il avait apporté une contribution inégalée et profonde à la science qui sous-tend notre compréhension des origines et du développement de la psychopathologie chez les enfants et les jeunes. La combinaison unique de motivations réformatrices, de curiosité intellectuelle et d'engagement en faveur d'une science fondée sur des hypothèses qui a rendu cela possible est abordée dans l'éditorial de ce numéro (Sonuga-Barke, Fearon, & Scott, 2022). J'ai récemment compilé un résumé systématique et complet de l'œuvre de sa vie - 546 articles de journaux et 52 livres publiés [https://doi.org/10.13056/acamh.13072]. Cette perspective éditoriale résume quelques points saillants des principaux domaines de ses nombreuses réalisations scientifiques.
Les recherches de MR couvraient les principaux domaines suivants (par ordre alphabétique) : adolescence ; trouble du déficit de l'attention/hyperactivité ; comportement antisocial/troubles du comportement/criminalité ; évaluation des états et des troubles mentaux ; autisme - 121 de ses 546 articles portaient sur ce sujet ; troubles de l'enfance et de l'âge adulte ; classification des troubles psychiatriques de l'enfant ; dépression ; épidémiologie ; génétique, en particulier l'interaction gène-environnement ; traumatisme crânien/dysfonctionnement cérébral ; les soins en institution - en particulier l'étude sur l'adoption en Angleterre et en Roumanie ; le développement du langage ; la privation maternelle ; l'impact de la maladie mentale des parents sur les enfants ; les conditions de santé physique ; la capacité de lecture ; les méthodes de recherche et les modèles de recherche - en particulier les "expériences naturelles" ; la résilience, le risque et les expériences négatives ; l'efficacité scolaire ; le tempérament ; le traitement des troubles psychiatriques de l'enfant.
Bien qu'un travail de cette ampleur et de cette qualité ne puisse être que très partiellement commenté dans un court éditorial, j'espère faire ressortir certains des principaux thèmes et approches de recherche et identifier certaines des principales découvertes/réalisations. Je renvoie les lecteurs intéressés au recueil complet pour obtenir de plus amples informations.
Premières indications sur le travail à venir : Il y a une forte continuité de thèmes dans les recherches de MR depuis les premières publications. Par exemple, un certain nombre de sujets ont émergé de sa première monographie de recherche sur le bien-être psychologique des enfants de parents malades (Rutter, 1966). Cette monographie était basée sur les thèses de doctorat de MR soumises à l'Université de Birmingham. Elle cherchait à savoir si les effets négatifs observés chez les enfants de ces parents étaient dus à leur expérience de la maladie parentale ou provenaient de facteurs génétiques. MR a abordé à plusieurs reprises cette question de l'action conjointe de la génétique et de l'environnement sur les troubles de l'enfance. Dans cette première monographie, il a examiné le rôle des facteurs de caractère qui influencent la réaction de l'enfant à l'expérience de la maladie parentale. L'impact sur l'enfant de l'expérience de la séparation d'avec le parent et d'un "foyer brisé" a également été abordé. Ces questions d'interaction gène-environnement, de susceptibilité tempéramentale aux expériences négatives et de privation de soins parentaux sont toutes des thèmes majeurs qui ont préoccupé MR tout au long de sa carrière et que je vais explorer ci-dessous.
Comprendre la nécessité d'aller au-delà de la clinique : Nombre des intérêts de recherche de MR trouvent leur origine dans l'étude de l'île de Wight (Rutter, Tizard et Whitmore, 1970). Il s'agissait d'une enquête épidémiologique révolutionnaire à grande échelle sur le bien-être physique et psychologique et le niveau d'instruction des enfants de 9 à 10 ans vivant sur l'île de Wight. L'étude de l'île de Wight a été suivie, plus tard dans les années 1970, par l'étude Inner London Study, où bon nombre des mêmes questions concernant la prévalence des problèmes ont été répétées dans un cadre urbain. La valeur particulière de cette étude épidémiologique dans le centre de Londres était qu'elle fournissait un contexte social contrastant avec celui de l'île de Wight. Les taux de troubles émotionnels, de troubles du comportement et de retard de lecture spécifique se sont avérés sensiblement plus élevés dans ce milieu urbain.
On voit le pouvoir des données longitudinales : ce travail dans le centre de Londres a démontré des différences marquées entre les établissements scolaires en matière de taux de mauvais comportement. Cependant, il s'agissait de comparaisons transversales qui ne permettaient pas de déterminer si les différences étaient dues aux effets de l'école ou aux caractéristiques des enfants à l'admission. Cela a conduit MR à concevoir et à mener une étude longitudinale pour vérifier si les différences entre les écoles pouvaient entraîner des changements dans le comportement et les résultats scolaires des élèves. Le livre Fifteen thousand hours : secondary schools and their effects on children (Rutter, Maughan, Mortimer, & Ouston, 1979) rapporte les résultats de cette étude historique. L'étude a montré que les écoles secondaires présentaient effectivement des différences marquées en matière de comportement, de fréquentation scolaire et de résultats des élèves. Ces résultats étaient fortement associés aux caractéristiques des écoles en tant qu'institutions sociales.
Il s'agit notamment du degré d'importance accordée à l'enseignement, des actions des enseignants en classe, de la disponibilité des récompenses et des incitations, des bonnes conditions pour les élèves et de la mesure dans laquelle les enfants se voient confier des responsabilités. Les élèves ne sont pas seulement influencés par la manière dont ils sont traités en tant qu'individus, mais aussi par l'"éthique" de l'école. MR a affirmé que l'étude avait "la forte implication que les écoles peuvent faire beaucoup pour favoriser le bon comportement et les résultats, et que même dans une zone défavorisée, les écoles peuvent être une force pour le bien" (Rutter, 1980).
Révolutionner la façon dont l'autisme est perçu : MR a fondamentalement changé notre compréhension de l'autisme avec ses travaux à partir du milieu des années 1960. Dans une première étude, il a formulé des conclusions provisoires sur la nature et les origines de l'autisme qui se sont avérées très prémonitoires (Rutter, 1968). Il a conclu que l'autisme n'a "rien à voir avec la schizophrénie", qu'il est "peu probable que des mécanismes de conditionnement psychogènes ou défectueux soient des facteurs primaires dans l'étiologie", que "des anomalies cérébrales organiques semblent être des influences primaires dans certains cas", et qu'une approche qui "place le défaut primaire en termes de problème de langage ou de codage semble la plus prometteuse". Enfin, dans une invitation ouverte à l'étude de la génétique (ce qui est remarquable pour 1968), il déclare que "l'importance des facteurs génétiques reste inconnue". Il a ensuite étudié chacun de ces aspects de l'autisme, notamment en utilisant des études sur les jumeaux pour démontrer clairement, pour la première fois, le rôle de la génétique dans l'autisme (Folstein & Rutter, 1977).
Remettre en question les idées reçues sur l'éducation des enfants : Un livre publié en 1972, intitulé Maternal Deprivation Reassessed, destiné à un large public, est devenu un pilier des cours de psychologie du développement (Rutter, 1972). L'ouvrage conclut que "le concept de "privation maternelle" a sans aucun doute été utile pour attirer l'attention sur les conséquences, parfois graves, d'une prise en charge perturbée ou déviante au début de la vie. Cependant, il est maintenant évident que les expériences incluses sous le terme de "privation maternelle" sont trop hétérogènes et les effets trop variés pour qu'il ait une quelconque utilité. Il a atteint son but et devrait maintenant être abandonné". La dernière grande étude entreprise par MR est revenue sur la question de l'impact des privations précoces sur le développement et sur la forme extrême vécue par les enfants élevés dans leurs premières années dans des orphelinats roumains. Cette étude sur l'adoption roumaine en Angleterre a examiné le développement, maintenant à l'âge adulte, des enfants adoptés dans des familles anglaises. L'étude a révélé que la durée de la prise en charge dans les orphelinats était liée à un certain nombre de difficultés ultérieures, et de longue durée. Ils ont conclu que : " En dépit de la résilience dont ont fait preuve certains adoptés et de la rémission des troubles cognitifs à l'âge adulte, la privation précoce prolongée était associée à des effets délétères à long terme sur le bien-être qui semblent insensibles aux années de soins et de soutien dans les familles adoptives " (Sonuga-Barke et al., 2017).
Formuler le rôle des facteurs de risque et de résilience : MR avait un intérêt durable pour les processus par lesquels les expériences négatives créent une vulnérabilité aux troubles psychiatriques. Il a montré que les vulnérabilités étaient influencées par un large éventail de facteurs, notamment la biologie de la personne, la continuité des expériences négatives, la conceptualisation du stress par l'individu et l'effet écologique de la vie en ville. Il a reconnu l'importance de l'adversité psychosociale en tant qu'influence sur les troubles de l'enfant, qui doit être évaluée parallèlement au rôle des facteurs génétiques. La variation des résultats lorsque différents enfants sont exposés à un événement ou une circonstance défavorable similaire est une question récurrente dans son travail. Les facteurs de protection qui entraînent l'absence relative d'une issue défavorable produisent la résilience et comprennent les caractéristiques clés de relations affectives sûres et stables et l'expérience du succès et de la réussite (Rutter, 2012). Il a constaté que les caractéristiques de la personne, comme le tempérament, peuvent également contribuer à la résilience. MR a élaboré les façons dont les facteurs de vulnérabilité et de protection sont définis et mesurés. Il les considère comme les pôles opposés d'un même concept : les facteurs de protection réduisent l'effet négatif de l'exposition au risque ; les facteurs de vulnérabilité font le contraire. Dans les deux cas, ils n'ont aucun effet sur le résultat en l'absence de risque.
Démêler l'interaction entre les gènes et l'environnement : Au cours de ses recherches, MR a participé à des études appliquant des méthodes de génétique comportementale quantitative à l'analyse des influences génétiques et environnementales sur une série de comportements. En plus des études de jumeaux sur l'autisme mentionnées ci-dessus, MR a développé une collaboration au cours des années 1990 et 2000 avec la Virginia Twin Study of Adolescent Behavioural Development.
Un exemple du produit de cette collaboration a été la suggestion que la dépression avant et après l'âge de 14 ans pourrait être des syndromes étiologiquement distincts (Silberg, Rutter, & Eaves, 2001). MR a fait valoir avec force que les influences de la génétique et de l'environnement sur le comportement ne doivent pas être considérées isolément. Il est nécessaire de comprendre le rôle des différents types de corrélation gène-environnement. En particulier, il a affirmé l'importance des études sur l'interaction entre les gènes et l'environnement pour comprendre les façons dont la biologie et l'expérience influencent le comportement. Il a suggéré que les effets des gènes sur le comportement peuvent être compris en grande partie par leur influence sur la mesure dans laquelle l'individu est susceptible d'être exposé à un risque environnemental et comment ils affectent la susceptibilité de l'individu à ce risque. C'est dans l'interaction entre les gènes et l'environnement que l'on trouvera les processus qui sous-tendent le risque et la résilience (Rutter, 2005).
Dès ses premiers articles, MR a fait référence avec admiration à l'approche de la découverte scientifique de Peter Medawar. La citation suivante montre clairement qu'il approuvait le mode de pensée de Medawar : "Bien sûr, il serait tout à fait futile de rassembler des faits sans but. Comme Medawar l'a si bien décrit, la science consiste à la fois à découvrir et à prouver, à formuler des hypothèses, puis à procéder à des tests minutieux pour départager les différentes hypothèses" (Rutter, 1971). Le titre de l'un des livres de Medawar sur la méthode scientifique était "L'art du résolu". Personne n'a été un exposant de cet art avec plus d'effet dans les domaines de la psychiatrie et de la psychologie de l'enfant que le professeur Sir Michael Rutter.
Michael Rutter : Progrès dans la compréhension de l'autisme: 2007-2010
Un article de synthèse sur l'autisme écrit par Michaël Rutter, pédopsychiatre britannique, il y a 10 ans et présentation de ses études sur les orphelins roumains.
Autisme : En souvenir du pédopsychiatre Michael Rutter
Déboulonner les mythes : Michael Rutter a passé sa carrière à déboulonner les mythes sur l'autisme, mais en tant que clinicien et chercheur rigoureux, il s'est également efforcé de réfuter ses propres travaux passés.
Autisme et al. : Michael Rutter (1933-2021)
Uta Frith et Francesca Happé décrivent les apports de Michael Rutter à la compréhension notamment de l'autisme.
"Les épaules d'un géant" : comprendre l'impact de Michael Rutter
Impact de Michael Rutter sur la pédopsychiatrie. Par le "Journal of Child Psychology and Psychiatry"



