Les sociétés s'usent, plus on s'éloigne du moment de fondation, plus ce qui demande un “plébiscite de tous les jours” devient coutume puis habitude, puis des gauchissements deviennent lois, remplaçant les lois fondatrices. Quand on perd de vue la raison pour laquelle une “solennité” comme le jubilé est établie, quand on finit même par oublier cette règle, on finit par ne plus s'y plier, et les inégalités deviennent pérennes et légales, on sera maître ou esclave de parents à enfants, donc inégaux en devoirs et en droits.
Dire que ce que je nomme les complots ne sont en général pas des “desseins secrets” ni ne comportent une “intention de nuire” dans leurs débuts découle de cette évidence: on ne peut pas contraindre des égaux à se soumettre quand la règle ne les y oblige pas. De longue date on s'interroge sur ce tropisme qui induit une majorité à se soumettre à une minorité. Entre autres auteurs relativement récents, mais qui s'interrogent à partir de réflexions plus anciennes, et le plus souvent antiques, Nicolas Machiavel et Étienne de La Boétie. Un troisième vaut la lecture, Jean Meslier, abbé de son état. Ne pas trop croire ce que dit dans l'article de Wikipédia, les humains ont souvent une forte tendance à la téléologie donc ils cherchent des “fondateurs de moments”, si possible à domicile; écrire de Meslier, en suivant en cela la leçon du philosophe contemporain cité, qu'il fut «le premier à professer un athéisme sans concession tandis qu'il développe avant la lettre un matérialisme rigoureux et pose également en précurseur les bases d'une philosophie anarchiste, ainsi qu'une conception communiste de la société selon Michel Onfray, qui le cite comme le premier philosophe athée radical et sans concessions», est plus qu'abusif, plus qu'inexact, faux. Concernant sinon l'athéisme radical ce qui s'en rapproche, et concernant la corruption des mœurs et des sciences qui conduit à la corruption des États, Machiavel:
«Et cependant, pour fonder une république, maintenir des États, pour gouverner un royaume, organiser une armée, conduire une guerre, dispenser la justice, accroître son empire, on ne trouve ni prince, ni république, ni capitaine, ni citoyen, qui ait recours aux exemples de l'antiquité! Cette négligence est moins due encore à l'état de faiblesse où nous ont réduits les vices de notre religion actuelle, ou aux maux causés par cette paresse orgueilleuse qui règne dans la plupart des États chrétiens, qu'au défaut de véritables connaissances de l'histoire, dont on ne connaît pas le vrai sens, ou dont on ne saisit pas l'esprit».
Dans cette troisième partie je tenterai autant que possible de ne pas me laisser aller à mon propre tropisme, l'ironie facile. Pour faire bref, les projets changent, les critiques changent, le fond reste constant: “conspirations” contre “complots”, “démocratie” contre, et bien, contre le reste, contre “non démocratie” ou “anti-démocratie”, l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Simple à dire, moins simple à faire. Parce que les deux sortes d'intérêts ne s'opposent pas nécessairement et selon les cas convergent, parce que l'on ne sait jamais trop ce que peuvent être l'un et l'autre cas, parce que les deux se défendent, que certes on peut être pour l'intérêt général mais s'il contredit nos intérêt particulier ou nous semble le faire, on peut réviser son opinion. Il n'est pas évident de déterminer quoi est quoi et quoi importe le plus. Je me moque pas mal d'Emmanuel Macron et de ses partisans, mais qui a raison sur la question de ce qui vaut le plus et le mieux pour la société, lui ou ceux qui s'opposent à lui? Et si ce n'est pas lui, qui parmi ceux qui s'opposent à lui a le projet le plus valide pour la société? Parfois je me figure Macron et ses soutiens comme des personnes qui ont décidé d'agir contre la superstructure et pour partie contre l'infrastructure de la société française, ce qui me semble souhaitable, parfois je me les figure comme des combattants d'arrière-garde, ayant comme but réel celui qu'ils affichent, maintenir à tout prix la superstructure même s'il faut agir contre une partie de la population parce que, de leur propre discours, elle serait condamné par la logique des choses, et dans ce cas ça ne changera rien, l'acharnement thérapeutique ne fait rien de plus que de maintenir en un semblant de vie un cadavre, au détriment de la société qui mobilise des moyens, des ressources et des compétences en faveur d'un mort et en défaveur de vivants, ce qui ne peut durer indéfiniment, d'autant quand ce mort vivant est le “corps social”. Quel que soit le cas, pousser la logique du système à son extrême ne peut que hâter sa fin. J'entends cette chose extraordinaire ces temps derniers: après que “la gauche”, celle dite “de gouvernement” parce qu'elle a gouverné environ la moitié du temps depuis les quarante dernières années, a fini par renoncer à prétendre représenter une alternative crédible au pouvoir actuelle parce se découvre incapable de reconstituer une “majorité de gouvernement” vraisemblable, “la droite”, celle dite ”de gouvernement” parce qu'elle a gouverné environ l'autre moitié du temps, vient d'entamer le même processus mais avec deux ans de retard et avec une incroyable incompréhension de sa situation réelle, puisque malgré l'énorme défaite électorale de “la gauche de gouvernement” aux législatives de 2017, elle a elle-même subi une érosion importante à cette élection, perdant 90 sièges par rapport à la législature précédente, part sur un discours très similaire à “la gauche de gouvernement”, parlant de restructuration, de nouveau projet, etc., après une déculottée encore plus formidable aux européennes de 2019, puisqu'elle a vu son espérance de recueil de voix, pourtant déjà catastrophique par rapport aux précédentes européennes et en recul par rapport aux législatives de 2017, s'effondrer encore (8,5% effectifs contre 14% dans les derniers sondages publiés).
En ce milieu d'année 2019, les partis favorables au maintien de la superstructure, et favorables à un projet de société dépassé, vont mal. Ceci inclut le parti (qui continue à se dire “mouvement” alors qu'il est devenu un “parti de gouvernement” comme les autres) actuellement au pouvoir. Ledit parti, qui était dans le même discours “rempart contre l'extrémisme” que ses prédécesseurs est devancé par ledit “extrémisme”, mais reste dans la reconstruction (non pas de son projet mais de la réalité) en expliquant qu'il a réussi là où il a échoué à simplement maintenir son niveau de voix exprimées de 2017 et a vu s'effondrer son niveau de voix recueillies, ce qui est inquiétant quand son électorat figure parmi les classes et catégories sociales et parmi les classes d'âge les moins abstentionnistes. quand on ne veut pas voir la réalité, et bien, on ne la voit pas. Au fait, qu'est un part de gouvernement? Un parti qui sait ce qu'il faut faire pour gouverner ou un parti qui a déjà gouverné ou participé à un gouvernement? Les mandats des divers partis qui se succédèrent au cours des presque deux dernières décennies donnent à croire que la deuxième proposition est la bonne. D'ailleurs, les commentateurs sportifs politiques ont dans leur majorité cessé de parler de gauche et de droite “de gouvernement” et opté pour “modérées” ou “classiques”. Ceci n'est pas de l'ironie facile mais une interrogation sur la situation actuelle en politique. À considérer que le cas français n'est pas exceptionnel.
Une personne m'intéresse beaucoup, Donald Trump. Il a bien de traits communs avec Emmanuel Macron, et beaucoup de gouvernants qui ont acquis leur position ces dernières années, ainsi que son prédécesseur. En premier, leur élection inattendue et imprévisible. A posteriori, l'élection de Barack Obama et celle d'Emmanuel Macron apparaissent plus “normales” et par reconstruction des événements, “prévisibles”, celles de Trump, ou Bolsonaro au Brésil, ou la Ligue des Étoiles en Italie, apparaissent “anormales” car ils sont supposément “atypiques”. Or, tous furent imprévus, imprévisibles et inattendus, et tous atypiques. La “normalité” a posteriori d'Obama et Macron vient plus de leur discours et de leur insertion assez lisse dans les instances politiques de leur pays et à l'international – enfin, pour Macron ça devient plus délicat, le temps passant. Pour les autres dirigeants, sinon peut-être Bolsonaro, et même pour lui, j'ai une opinion autre que celle courante. Notamment Trump. On le prétend imprévisible ce qui n'a guère de sens. Je veux dire, si une personne est systématiquement “imprévisible” alors elle est toujours prévisible, puisque dans tous les cas “on ne peut pas prévoir”. Donc, il faut passer au-delà des apparences, au-delà de son discours, pour observer ses actes. Car, je le constate, chaque fois que l'on prévoit la catastrophe le matin parce qu'il twitte qu'il va tout casser dans la baraque, on doit l'après-midi constater qu'il a mis de l'eau modératrice dans son vin catastrophiste. Et surtout, je constate ce que tout le monde peut constater: Donald Trump est devenu président de la République des États-Unis. Si ce que prétendent les personnes qui postulent que les systèmes de désignation de nos représentants en vigueur presque partout, sans le certifier, partout me semble-t-il où le pouvoir n'est pas une dictature ou la conséquence d'un coup d'État, par élection directe ou indirecte, est la conséquence d'un choix raisonné et non une loterie ou un non choix, un pouvoir imposé, alors il n'est pas président de son pays par hasard.
Croire ou prétendre qu'une élection est imprévisible c'est alors croire ou prétendre que cette sélection est aléatoire. C'est le cas bien sûr mais censément non. Je l'expliquais dans un autre billet (avec une ironie assez méchante à l'encontre des commentateurs de la politique), à chaque élection présidentielle française depuis 1988 au moins un candidat du second tour est présenté comme imprévisible. Dès lors que la liste des candidats est fermée, la logique dit que la présence de ces deux candidats est prévisible. Ce que disent ces commentateurs est qu'ils ne correspondent pas à leur attente, voilà tout. Donald Trump est un candidat de fin de séquence typique un pur produit du présent qui mobilise tous les outils du changement pour proposer de rétablir le Passé Glorieux de la Nation – un passé mythique qui n'eut jamais lieu bien sûr. Et bien sûr, il eut un programme électoral inapplicable car allant contre ses intérêts, contre ceux de son groupe – “son” parti et ses soutiens directs – et contre ceux de ses électeurs comme du reste du pays, enfin contre ce que son discours impliquait. le Passé Glorieux par exemple est le plus souvent expansionniste et belliciste. Le cœur de son message électoral fut «Make America great again!», «rendre l'Amérique de nouveau grande!». Quand fut-elle grande? Quand elle mena des guerres, étendit son emprise sur le monde et mena une politique expansionniste. Dans le même temps il proposa de la “rendre de nouveau grande” en se fermant, en se dégageant du jeu diplomatique, en se retirant de conflits en cours et en refusant de s'engager dans des conflits futurs – donc de la rendre “plus petite”. Les contrastes entre ses propositions de campagne, incompatibles et contradictoires, et l'écart entre sa pratique effective, qui s'appuie sur ce qui constitue dans l'imaginaire “le futur”, et ce rêve de grandeur qui propose le retour vers un passé tout aussi imaginaire mais écarté de sa pratique, tend à le rendre impuissant, incohérent dans ses discours et conformiste dans sa pratique – conformiste au sens où sa politique réelle ne se distingue pas de celle de ses prédécesseurs, notamment assez peu de celle de son immédiat prédécesseur. Et bien sûr, assez vite après son élection, face au constat qu'il est difficile d'annuler le réel il se plia au le type de “politique spectacle” qui pouvait satisfaire son électorat sans l'engager lui-même dans des voies sans issue, une position belliciste et conquérante en paroles, non en actes, sinon lâcher quelques bombinettes sur des pays ou dans des zones où il ne courait pas le risque d'affronter un adversaire avec du répondant: menacer l'Iran, la Corée du Nord et la Chine, mais attaquer l'Afghanistan, la Syrie en périphérie, et “l'État islamique”. Bien sûr, l'avenir n'est pas écrit, quand on a un discours agressif et un rêve de grandeur donc de “puissance”, il peut arriver que ça se réalise... Non pas la grandeur et la puissance, mais la mise en œuvre des moyens censés les établir ou rétablir, en tout premier la guerre.
Je vis en un temps qui a ses racines dans une époque très lointaine. Je puis affirmer que les complots, ni ne sont secrets, ni n'ont la volonté de nuire, en sachant que c'est faux, et que pourtant c'est vrai. C'est que, la réalité a un rapport varié à la vérité et la fausseté. Un fait de la réalité effective n'est ni vrai ni faux, il est, voilà tout; un fait de la réalité symbolique est vrai et faux en soi, réfère ou ne réfère pas à une réalité effective; une réalité symbolique peut être produite en tant que vraie ou fausse du point de vue de ses producteurs indépendamment de sa vérité ou fausseté référentielle, elle peut être présentée en tant que vraie ou fausse indépendamment du point de vue de ses producteurs, reçue en tant que vraie ou fausse indépendamment de ce que supposent et proposent ses producteurs. La réalité “la loi salique” est effective en tant qu'elle est un objet de la réalité observable et donc, agit dans ce monde; elle est une réalité symbolique en soi, un document produit à un certain moment par une ou plusieurs personnes, elle est vraie parce qu'elle est, fausse car toujours autre que ce qu'en croient ses producteurs, pour eux c'est un message ou un moyen alors que c'est un moyen qui est son propre message, un message en tant que c'est un moyen, le “message” pour une tierce personne est le moyen lui-même, qu'il n'interprétera pas nécessairement comme le producteur le fait ni comme il suppose que des tiers le feront; pour ses producteurs c'est un faux en tant que forgerie, que réalité symbolique ne référant pas à la réalité effective à laquelle il est supposé se relier, un vrai en tant qu'instrument pour une certaine fin, la réalité effective dans laquelle il s'insère, ses récepteurs la jugeront “vraie” ou “fausse” naïvement (considéreront le discours “document établissant une règle datant du VI° siècle” comme vrai et référant à une réalité effective de cette époque, ou celui “document inventé au XV° siècle” comme vrai et référant à une réalité effective de ce siècle), vraie ou fausse dans le cadre de leurs idéologies (que le document soit vrai ou faux en tant que preuve de la légitimité des Valois à revendiquer le trône de France n'est pas dépendant de la vérité ou fausseté de cette affirmation pour les partisans ou opposant aux prétentions des Valois, les Valois le savaient une forgerie et leurs partisans pouvaient le croire ou savoir une forgerie, leurs opposants pouvaient le savoir une forgerie ou seulement le croire ou le supposer, ou croire en sa véracité comme document du VI° siècle, sans que leurs affirmations quand à sa vérité ou fausseté dépendent en rien de leur science ou croyance). Et comme dit, jusqu'au XX° siècle au moins la “loi salique” appartint au récit historique communément admis non en tant que document du VI° siècle mais en tant que document fondateur de la légitimité des gouvernements successifs puisque même si en rupture avec celui précédent, leur légitimité à le remplacer reposait sur la légitimité antérieure de leur prédécesseurs: quand les Bourbons succédèrent aux Valois, la validité de leur prétention au trône reposait sur la légitimité antérieure de cette branche; quand les révolutionnaires de 1791 établirent la République, ils le firent en tant que successeurs des rois de France.
Les “complots” sont rarement secrets et en tout cas le sont rarement longtemps. On peut considérer la forgerie de la “loi salique” comme un complot, et en ce cas il fut vite éventé puisque dès le moment de sa fabrication ce document fut connu comme tel, comme un faux, mais ça importe peu pour les comploteurs, ils ne visent pas à convaincre leurs adversaires mais à se légitimer auprès de leurs possibles soutiens et dans le futur: dans le contexte de la Guerre de Cent Ans, tous les acteurs qui revendiquaient le trône, ou le territoire, ou telles parties du territoire, s'appuyaient sur le même genre de légitimité douteuse, et leurs soutiens acceptaient (en variant souvent leurs allégeances selon le contexte et leurs intérêts du moment) leur légitimité le plus souvent pour d'autres raisons qu'une croyance ou qu'une certitude en la validité de ce qui était censé “faire preuve”. Dans le futur aussi car pour se dire héritier de quoi que ce soit, il faut des “titres de propriété”, que ce soit une réalité observable ou conventionnelle. Cela dit, toute propriété est d'ordre conventionnel: je me dis propriétaire d'un territoire parce que j'en hérite, je l'achète, je l'occupe, je le fabrique ou je m'en empare; dans tous ces cas et autres imaginables la “propriété” au sens de possession, de “droit sur”, ne vaut qu'aussi longtemps que la société l'accepte et le confirme; dans une société qui met en place une règle de type jubilé ou potlatch toute possession cesse par effacement du titre ou par obligation de rétrocession. Le jubilé n'était pas qu'une simple «solennité publique [...] à l'occasion de laquelle dettes et peines étaient remises», c'est l'annulation de toute cession et de toute contrainte. Le livre où figurent les règles du jubilé, le Lévitique, chapitre 25, laisse songeur. Si on appliquait ses règles on aurait une société “communiste” et “écologiste”, une société d'égalité et de liberté, une société où tous seraient “égaux en droits”, et égaux en fait. Cela dit, certaines règles sont inapplicables. Notamment pour cette question de la légitimité. Prenez celles-ci:
« Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu’a vendu son frère. Si un homme n’a personne qui ait le droit de rachat, et qu’il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l’acquéreur, et retournera dans sa propriété. S’il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu’il a vendu restera entre les mains de l’acquéreur jusqu’à l’année du jubilé; au jubilé, il retournera dans sa propriété, et l’acquéreur en sortira».
Bon. Mais comment sera établi le droit de rachat, et ses pendants, les droits d'achat et de vente? Car on ne peut racheter que ce qui a été vendu, et on ne peut vendre que ce que l'on possède. Or, «le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants», “moi” étant spécifié un peu avant comme « l’Éternel, votre Dieu». Le seul et légitime propriétaire est donc cette entité, tous les autres sont des résidents temporaires ou des, disons, des locataires ou des usufruitiers qui ont un droit de jouissance et de propriété du fruit mais non de propriété foncière et immobilière.
Comment j'ai écrit certains de mes textes.
Ce titre de partie est ce qu'on nomme une référence culturelle, ça renvoie à un livre que je n'ai pas lu d'un auteur que je n'ai jamais lu. Une référence parmi les amateurs de littérature sous contraintes – l'auteur comme le livre, les lecteurs comme les créateurs de ce type de littérature. Cette remarque préalable pour illustrer certains trucs de rhéteurs, par exemple calquer un titre de texte ou de partie de texte sur un titre existant pour, et bien, pour diverses choses, établir une connivence avec les connaisseurs du titre et plus largement les amateurs d'une certaine sorte de littérature, me donner de la surface culturelle, à l'occasion faire le beau en explicitant plus ou moins la référence et selon les cas, en valorisant ou dévalorisant mes possibles lecteurs et lectrices, par une mention très sibylline du genre «On aura reconnu le titre dont je me suis inspiré», ou «Hommage à un grand écrivain!», voire «Hommage à lui!», ou par une mention très explicite du titre et de l'auteur. Un autre auteur écrivit une sorte de manuel, que je n'ai pas plus lu, intitulé, si je me rappelle, Comment parler des livres qu'on a jamais lus, je ne l'ai pas lu parce que je connais diverses manières de le faire avec brio et vraisemblance. Je puis par exemple parler du livre qui m'a servi à donner un titre à cette partie parce que j'en ai entendu parler par certains de ses lecteurs et en ai lu des critiques, ce qui me donne des éléments pour évoquer son contenu; pour le reste, on n'a pas nécessité à lire un ouvrage pour livrer son opinion dessus. Un bon conseil, si vous ne savez pas comment parler d'un livre que vous n'avez pas lu: moins vous en saurez sur son contenu, plus vous aurez intérêt à émettre un avis négatif et tranchant, ça vous évitera des erreurs factuelles. Dans un film vu récemment l'un des personnages principaux, critique littéraire à la télé, y assassine un livre en une phrase, du genre «Sa lecture est très dispensable, aussi vite lu, aussi vite oublié, sinon le désagrément de l'avoir parcouru». Livre qu'il n'a pas lu bien sûr.
Au départ, je comptais intituler cet excursus «Pourquoi j'écris certains de mes textes». La similarité de forme avec le titre de l'ouvrage mentionné, qui commence par “pourquoi” mais se termine par un autre mot, m'a incité par plaisanterie à donner ce titre, mais le sujet est bien “pourquoi”, parce que le comment de la chose est sans mystère aucun: en plaçant un mot après l'autre dans une forme syntaxique assez conventionnelle, ces mots composant des phrases et ces phrases composant ensemble un texte. Étant un auteur paresseux je ne réfléchis pas trop au contenu et à la forme, sauf quand je rédige des textes où la forme compte, comme des poèmes en vers comptés et rimés, ou autre type de littérature sous contrainte. C'est sûr que quand on décide de composer un sonnet en alexandrins il vaut mieux réfléchir à la forme. Pour le fond ça importe moins, fut un temps je pratiquais ce qu'on nomme bout-rimé, «un poème, généralement, un sonnet, composé à partir d’un appariement de rimes données d’avance, les “bouts-rimés”». Le fin du fin est de se donner la contrainte supplémentaire de les placer dans l'ordre où on vous les propose, sinon le déplacement mineur que pourrait requérir l'ordre des rimes (pour un sonnet, classiquement ABBA ABBA CCD EDE – il y eut d'autres alternances de rimes proposées mais celle-ci est la plus courante). On peut certes tenter de “donner du sens au poème”, de lui donner une apparence de cohérence pour le fond, mais ça n'a pas trop d'importance, s'il a une syntaxe l'auteur supposera sans grand risque d'erreur que ses lecteurs lui donneront du sens. Vous avez déjà lu ou vu des “cadavres exquis”? Dans la première variante de ce jeu littéraire, «chaque participant écri[vi]t à tour de rôle une partie d'une phrase, dans l'ordre sujet–verbe–complément, sans savoir ce que le précédent a[vait] écrit», ce qui aboutit à ce premier résultat:
Le cadavre exquis boira le vin nouveau.
D'où ce nom de “cadavre exquis”. Quand une phrase est syntaxiquement acceptable on peut assez facilement lui donner du sens. Faut dire, ce premier cadavre exquis eut l'heur d'associer un verbe et un complément qui aide à donner du sens à l'ensemble. Comme le mentionne l'article de Wikipédia, ce procédé connut une extension, d'abord par la composition de textes courts dont chaque participante rédigeait une phrase ou un bref alinéa, puis par la composition de romans où chacun compose un chapitre, avec une contrainte un peu ou beaucoup moins rigoureuse. Contrairement à ce qui est écrit dans l'article, les auteurs ne connaissent pas nécessairement tout ce qui précède mais au moins le chapitre précédent en tout ou partie et le nom de quelques personnages, leur fonction et si besoin leurs liens; dans le cas d'un roman policier, il est bien sûr bon de mentionner si l'un de ces personnages est mort mais non nécessaire de préciser si certains sont soupçonnés ou accusés de crime ou de délit.
Pourquoi j'écris certains de mes textes? Par goût d'écrire. Il m'arrive d'écrire que j'ai horreur d'écrire, ce qui est vrai tout en étant paradoxal, écrire qu'on déteste faire ce qu'on est en train de faire, étrange... Et c'est en même temps faux, j'aime bien écrire, je trouve ça plaisant. N'étant pas à un paradoxe près j'aime bien écrire pour écrire, pour le simple plaisir d'aligner les mots, de les organiser en phrases, en alinéas, en paragraphes, en chapitres, et in fine en textes délimités. Certains sont proprement “achevés”, ils ont un début, une fin et une organisation linéaire et cohérente. Dans la discussion en cours, la blague en forme de saynète que je cite sur “notre président” qui dit “et en même temps”™ noir et blanc, est de ce genre; dans le recueil Élucubrations & autres coquecigrues il y a plusieurs courts textes, parfois sérieux, parfois plaisants, qui me semblent achevés. Dès qu'un de mes textes dépasse les quatre ou cinq pages sa qualité d'achèvement devient assez peu vraisemblable. Bien sûr, à un moment je décide que ça suffira mais non qu'il est “terminé”. Ceci découle de ma pratique, écrire en plaçant un mot après l'autre selon une syntaxe acceptable et sans préméditation; même dans des textes plus serrés que celui-ci, de moins d'une vingtaine de pages imprimées, je divague, je me laisse entraîner par des tours et détours, une sorte de promeneur, d'explorateur de mes propres pensées, en mon esprit comme en le vôtre et comme en tout ce qui participe de cet univers tout se relie à tout, sans ordre; on peut donner un peu d'ordre à un petit segment mais prétendre le faire pour un plus grand segment me semble peu envisageable, très ambitieux. Donc, pas pour moi car je n'ai guère d'ambition sinon celle de vivre une vie aussi plaisante que possible. Et l'ambition sans complément, le fait d'être ambitieux, ne me semble pas favorable pour mon ambition limitée, une vie plaisante. Ordinaire et plaisante. Pour qu'écrire me soit un plaisir je le fais sans ambition, en promeneur. Si parfois je trouve un chemin bien dessiné, une pensée brève et limitée, j'en achèverai la rédaction, sinon je suivrai le cheminement de mes pensées au gré de ma fantaisie, jusqu'au moment où il me semblera pertinent de laisser là cette promenade pour m'engager dans une autre, ou pour me poser un moment, parfois long. Une fois terminé un texte devient autre chose, une sorte d'arbre ou un rhizome, les rares sur lesquels je reviens je m'en fais alors jardinier, je taille, j'élague, j'étaie, je ente, j'y fais des greffes, je le divise en plusieurs textes, je l'inclus dans un texte plus large. Les autres, je les laisse en l'état sinon parfois, quand par hasard ou par nécessité j'en relis un, pour corriger des erreurs de syntaxe ou d'orthographe, des imprécisions, des redites. supprimer des répétitions ou certaines digressions sans pertinence ou sans intérêt.
Je n'aime pas écrire et même, j'en ai parfois horreur, sous un autre aspect, celui de la parole comme message. Autant que possible j'essaie de faire preuve d'honnêteté envers mon possible lectorat, d'une part en disant que je n'ai pas proprement de message à délivrer, de l'autre en me présentant pour ce que je suis, et ce qu'est toute personne usant de la parole, un rhéteur, un être qui désire convaincre, qui désire que l'univers lui soit le plus favorable possible et qui pour cela agit autant qu'il en a moyen sur le segment le plus large possible de cet univers pour l'organiser en sa faveur. Raison pourquoi je ne suis pas ambitieux sinon de manière très limitée dans l'espace et le temps: je ne désire pas agir sur un très large segment de la réalité. Je ne désire pas ne pas le faire mais je ne désire pas le faire par volonté, “en m'en donnant les moyens” comme pourraient le dire “notre président” ou son premier ministre, et bien d'autres de leur clique: ils se sont donnés les moyens de “changer la réalité”, un tout petit morceau de la réalité certes, pour l'essentiel la France et un peu l'Union européenne, presque pas le reste de la réalité humaine globale, et puis? Comme on le pouvait prévoir, la réalité change sans qu'ils y soient pour grand chose, elle change autrement que ce qu'ils en souhaitaient, et du coup elle les change. Soit ils en tiennent compte et versent dans la conspiration, soit non, et ils versent dans le complot. Comme je sais que la réalité n'a pas besoin de moi pour changer, qu'elle change en permanence et que personne ou presque n'y est pour grand chose, comme je sais que si je veux l'orienter, disons, dans le sens qui me convient, j'ai intérêt à concentrer mon action dans la limite du petit segment de réalité sur lequel je peux effectivement agir, et à inscrire mon mouvement dans le mouvement général que contre lui, je n'ai pas ce genre d'ambition qui anime presque tous nos gouvernants et leurs soutiens, jouer à Dieu, faire le monde “à mon image” et mes semblables, les humains, “à mon image”: ça ne marchera pas parce que je ne suis ni Dieu ni un de ses anges. Ni même “le Diable” – là ce serait plus facile mais ce n'est vraiment pas mon truc. Remarquez, «qui fait l'ange fait la bête» et qui fait le Dieu fait le Diable, ce que nous disent d'ailleurs la plus grande part des sagesses, le “mal” est une conséquence du “bien”, si la “cause première” de tout en ce monde elle est aussi cause du mal, qui a comme autre nom la corruption – la corruption du bien. Dit autrement: le mal est le bien vu sous un autre aspect. Si pour tels “le bien” est que rien ne change, “le mal” sera le changement; si pour tels “le bien” est que tout change, “le mal” sera le non changement. Comme tout change tout le temps mais très modérément, pour qui voit le mal dans le changement il y en a toujours trop, pour qui le voit le bien dans le changement, il n'y en a jamais assez.
J'ai un message, mais un message inutile parce que c'est celui proposé de tout temps par qui tient compte de la réalité effective et de l'écart entre elle et la réalité symbolique, il faut cultiver notre jardin, et ne s'occuper de celui de notre voisin que pour en prendre leçon ou à sa requête. Ce qui n'induit pas le “chacun pour soi”. Il y a de nombreuses variantes à la sentence commençant par “la liberté des uns”; celle qui a ma faveur: «La liberté des uns commence où commence celle des autres». La meilleure manière de défendre ma propre liberté est de défendre celle de chacun et celle de tous, les deux pires sont d'imposer ma liberté aux autres ou que d'autres veuillent m'imposer la leur: quelle liberté y a-t-il si c'est sous contrainte? Mon humble ambition lorsque je me lance dans des textes aussi longs et dispersés que celui-ci? D'une part, exposer mon jardin, de l'autre proposer une leçon, il n'y a pas de “meilleure façon de marcher”, et en tout cas pas celle de mettre un pied devant l'autre, car cette leçon exclut les cul-de-jatte, les unijambistes, les paraplégiques, et les myopathes et personnes atteintes de sclérose en plaque graves, entre autres. La meilleure n'existe pas. Je répète régulièrement que ce que j'écris n'a pas pour ambition de proposer un “modèle de vie”, juste un modèle de comportement, je n'ai nulle vérité universelle à proposer, sinon celle-ci: toujours interroger ses propres certitudes avant de mettre en cause celles de son prochain. Comprendre que le sens d'un discours est produit par le lecteur ou l'auditeur dissuade de prétendre délivrer quelque message en supposant être compris. Non que ça n'arrive jamais, cela dit, loin de là, mais c'est rare.
Je n'ai jamais lu Spinoza, sinon quelques citations, mais je puis cependant, le cas échéant, en parler, et en parler à l'aise. Ayant tendance à ne pas masquer mes tours de passe-passe je puis aussi, dans une interaction directe, mentionner que je parle sans connaître, ou non, ça dépend du contexte. Quand une personne m'agace ou attire mon antipathie, pour la dissuader de tenter de dialoguer avec moi je ne déteste pas de faire mon cuistre, pour “en imposer” comme on dit, ou au contraire à faire l'imbécile: vous aimez ça, vous, discuter avec des cuistres ou des imbéciles? Remarquez, ça ne fonctionne pas à tous les coups, si cette personne est cuistre ou imbécile, ou est joueuse comme moi (enfin, le plus souvent: il m'arrive d'être sincèrement cuistre ou imbécile, de “prendre mon rôle au sérieux” et même, plus souvent que je ne le souhaiterais), le dialogue peut durer plus que je ne l'espérais; arrive toujours un moment où l'un de nous casse la spirale, en disqualifiant le discours de l'autre ou son propre discours, ou en changeant brusquement de rôle, ou si l'un ou l'autre n'a pas une antipathie trop forte et veut rester poli, il trouvera une excuse vague pour rompre l'échange. De l'autre bord, prolonger l'échange permet souvent de changer d'opinion, et parfois même de passer de l'antipathie à la franche sympathie. Donc, je n'ai pas lu Spinoza sinon brièvement, mais j'ai quelques avis sur son œuvre. Notamment sur sa conception de l'entité “Dieu” ou “cause première”. Je ne sais pas si ce fut son opinion mais on lui fait la réputation d'identifier cette cause première à l'ensemble des causes ultérieures, en gros, de postuler que “Dieu” n'est que l'autre nom de l'univers, spécialement de la partie de cet univers qui nous concerne directement, qu'on nomme “la nature”. Si c'est le cas, je suis assez d'accord. Tiens ben, du coup ça me donne idée de le lire, plutôt que de me reposer sur les avis de ses commentateurs ou de ses exégètes. Avant de me lancer dans cette lecture, une confirmation, c'est bien un propos de Spinoza, «Deus sive Natura», «Dieu ou [aussi] Nature» il y a donc identification entre les deux termes chez lui. J'avais cherché cette association entre “Dieu” et “nature” chez cet auteur pour situer l'ouvrage où elle apparaît et suis tombé sur cet article de Wikipédia. Au passage cette recherche me permet à la fois d'appuyer ma réticence envers les commentaires et de confirmer que le sens est donné par le lecteur, puisqu'à partir de cette seule phrase on trouve des commentaires où elle fait la preuve de son athéisme, ou de son mysticisme, ou de sa religiosité, ou... Et aussi la preuve de sa modernité radicale ou de son traditionalisme radical, ou... Bref, la preuve de tout et du contraire de tout. Si vous souhaitez ne pas savoir ce que pense un auteur, le meilleur moyen est de lire ses commentateurs, si possible au moins trois sans rapports directs entre eux. Si vous souhaitez connaitre peut-être sa pensée ou au moins savoir ce que vous en pensez, lisez-le, ou alors lisez beaucoup de commentateurs, d'entre leurs divergences peut souvent émerger une idée de ce que pourrait être sa pensée et surtout, une idée de ses propres divergences et contradictions. Pour conclure avant d'y aller voir, je viens de découvrir via «Les Classiques des sciences sociales» le site spinozaetnous.org, qui met à disposition ses écrits dont l'Éthique où, semble-t-il, figurerait cette proposition. Je vais y aller voir avant de poursuivre ce billet.
Non que ça ait quelque intérêt dans le cadre de cette discussion, j'y ai jeté un bref coup d'œil pour ma propre édification. Le bref aperçu que l'en ai eu ne me sépare pas de mon opinion, exprimée dans la deuxième partie:
« Il est des auteurs couverts par les commentaires, d'autres découverts par eux. Je soupçonne, vu les opinions contrastées sur son œuvre, qu'il prête à toutes les interprétations donc que son discours est plus sophistique que rhétorique».
Ce qui n'induit pas, disons, quelque malhonnêteté intellectuelle, il écrit en son temps et avec les prudences de son temps. Malgré ces prudences, il fut tout de même mis au ban de sa communauté, ainsi que ses œuvres, et de manière définitive. Plutôt que sophistique son style est plutôt scolastique, selon la première acception du substantif, de la «philosophie [et la] logique enseignées au Moyen Âge dans les universités et les écoles, qui avaient pour caractère essentiel de tenter d'accorder la raison et la révélation en s'appuyant sur les méthodes d'argumentation aristotélicienne». Faut dire, en son temps encore on avait vite fait de subir un anathème, quelle que soit sa religion ou sa communauté, ce qui ne laissait de poser problème vu que les rapports sociaux étaient très tributaires des rapports de chacun avec les autorités religieuses. Je parle sans savoir vu que je n'ai pas vérifié mais je suppose que cette mise au ban radicale était due à sa méthode: on peut dire pas mal de trucs à la limite de l'hérésie dans pas mal de religions, notamment parmi les diverses sectes se reliant à la Torah, sous condition de se référer explicitement au corpus, de s'appuyer sur les “textes sacrés”, ce qu'il ne fit guère. Pour exemple, Martin Luther, qui commence a développer des idées “pas très catholiques” avant le placardage public de ses “95 thèses”, et même après il se passera presque quatre ans avant qu'il soit excommunié mais au départ plus pour des motifs, disons, administratifs que proprement théologiques. Ce qui est admissible par sa communauté ou par les autorités varie beaucoup d'un moment à un autre, par exemple les comportements que l'on nomme depuis la toute fin du siècle précédent “pédophiles”, étaient assez bien reçus à la fin des années 1970, et l'on pouvait sans problème s'en faire le propagandiste dans des périodiques aussi divers que Le Monde, Le Figaro, L'Express, l'évoquer en termes moins explicites mais pas très voilés sur les radios et télés; les rappels de propos prononcés ou écrits à l'époque par des pères-la-vertu de ce siècle qui n'ont pas de mots assez durs envers “la pédophilie” montre que de nos jours comme au temps de Spinoza l'anathème peut tomber très vite si on ne suit pas les préceptes moraux et sociaux les mieux admis. En fait, entre 1975 et 1980, en gros, les personnes vite tricardes étaient plutôt celles défavorables à “la pédophilie”...
Bon, mais pourquoi est-ce que je cause de Spinoza? Ah oui! Pour sa conception de l'entité “Dieu” ou “cause première”. Enfin non, pas pour ça. J'en parle parce qu'il a émergé dans ce billet au cours de la partie II, quand j'ai cherché un texte qui le mentionne en même temps que Descartes, Pascal et Deleuze. Un pue plus loin je mentionne une première fois que je le connais peu et ne l'ai jamais lu sinon comme citations. Il remonte à ma mémoire dans la partie en cours pour cette question de “Dieu” ou de la “cause première” (au passage, Spinoza, qui est de son temps, emploie l'expression, ce qui en la mienne serait plutôt l'indice d'une attitude intempestive car en dehors des Églises et de certains cénacles elle ne fait plus partie du vocabulaire courant. Pas sûr que mon potentiel lectorat comprenne précisément ce que signifie “cause première” dans cet emploi. Faut dire, notre cadre conceptuel s'est quelque peu éloigné de l'aristotélisme au sens strict, donc de ses concepts, mais déjà au temps de Spinoza le concept fondamental d'un univers purement causal avait du plomb dans l'aile, donc ça explique cette prise de distance); n'aimant guère parler sans connaître, je décide d'y aller voir juste comme ça, pour déterminer si mon a priori envers Spinoza est fondé ou non mais comme dit aussi, les opinions contrastées sur son œuvre montrent qu'il prête à toutes les interprétations, ce qui donne à penser qu'il dit tout et le contraire de tout. Ce qui est inexact mais effectif. Par la construction même de ses ouvrages. Dans son siècle et à son époque (il est à peu de choses près contemporain de Blaise Pascal, à peine plus vieux que Nicolas Malebranche, et le postulat de Gilles Deleuze est assez juste bien que discutable, «Un principe de la logique classique c’est que toute réalité est perfection. Toute réalité est perfection. Ça leur vient de la logique du Moyen-Age mais ils s’en servent d’une manière tout à fait spéciale. Ça va devenir vraiment la méthode de la pensée classique». Je veux dire, tous les philosophes que cite Deleuze sont au minimum déistes, en général fidèles d'une religion constituée donc “croyants en Dieu”, et dans leur contexte, qu'ils adhèrent sincèrement à ce déisme ou ce théisme ils doivent nécessairement renouveler leur conviction que toute réalité est perfection s'ils veulent être audibles, si possible recevables, et ne point trop risquer leur situation ni leur vie. Le texte de l'Éthique est un méandre, le discours est construit comme un texte de loi français du XXI° siècle, avec des mentions sibyllines et des renvois multiples à des articles précédents, suivants et extérieurs. Pour illustration, ces passages:
«Nous avons montré, en effet, dans l’appendice de la première partie, que la Nature n’agit pas en vue d’une fin; car cet Être éternel et infini, que nous appelons Dieu ou la Nature, agit avec la même nécessité qu’il existe. C’est, en effet, de la même nécessité de nature qu’il existe, qu’il agit aussi, comme nous l’avons montré (proposition 16, partie I). La raison donc, ou la cause, pourquoi Dieu ou la Nature agit, et pourquoi il existe, est unique et la même» – Partie IV, préface.
«Pour montrer maintenant que la Nature n’a aucune fin à elle prescrite, et que toutes les causes finales ne sont rien que des fictions humaines, je n’aurai pas besoin de beaucoup de peine. Je crois, en effet, l’avoir déjà assez établi, tant par les principes et les causes d’où j’ai montré que ce préjugé a tiré son origine, que par la proposition 16 et les corollaires de la proposition 32, et en outre par toutes les raisons par lesquelles j’ai montré que tout dans la Nature procède selon une nécessité éternelle et une souveraine perfection. J’ajouterai cependant encore ceci, que cette doctrine finaliste renverse totalement la Nature. Car ce qui, en réalité, est cause, elle le considère comme effet, et inversement. Ensuite, ce qui par nature est antérieur, elle le fait postérieur. Enfin, ce qui est le plus élevé et le plus parfait, elle le rend le plus imparfait. Car (en laissant de côté les deux premiers points qui sont évidents par eux-mêmes), comme il est établi par les propositions 21, 22 et 23, cet effet-là est le plus parfait, qui est produit immédiatement par Dieu, et plus une chose a besoin, pour être produite, d’un plus grand nombre de [61] causes intermédiaires, plus elle est imparfaite» – partie I, annexe.
«De la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes (c’est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini).
DÉMONSTRATION
Cette proposition doit être évidente pour quiconque, pourvu qu’il fasse attention que, de la définition donnée d’une chose quelconque, l’entendement conclut plusieurs propriétés, qui réellement suivent nécessairement de cette définition (c’est-à-dire de l’essence même de la chose), et d’autant plus nombreuses que la définition de la chose exprime plus de réalité, c’est-à-dire que l’essence de la chose définie enveloppe plus de réalité. Or, comme la nature divine a une infinité absolue d’attributs (selon la définition 6), dont chacun aussi exprime une essence infinie en son genre, de sa nécessité donc doivent suivre nécessairement une infinité de choses en une infinité de modes (c’est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini). C.Q.F.D.
COROLLAIRE I
Il suit de là : 1° Que Dieu est la cause efficiente de toutes les choses qui peuvent tomber sous un entendement infini.
COROLLAIRE II
Il suit : 2° Que Dieu est cause par soi, et non par accident.
COROLLAIRE III
Il suit : 3° Que Dieu est absolument cause première» – partie I, proposition XVI.
«PAR DIEU, J’ENTENDS UN ÊTRE ABSOLUMENT INFINI, C’EST-A-DIRE UNE SUBSTANCE CONSISTANT EN UNE INFINITÉ D’ATTRIBUTS, DONT CHACUN EXPRIME UNE ESSENCE ÉTERNELLE ET INFINIE.
EXPLICATION
Je dis absolument infini, et non pas seulement en son genre; car de ce qui est infini seulement en son genre, nous pouvons nier une infinité d’attributs; mais pour ce qui est absolument infini, tout ce qui exprime une essence et n’enveloppe aucune négation appartient à son essence» – partie I, définition 6.
«COROLLAIRE I
Il suit de là : 1° Que Dieu ne produit pas ses effets par la liberté de sa volonté.
COROLLAIRE II
Il suit : 2° Que la volonté et l’entendement sont avec la nature de Dieu dans le même rapport que le mouvement et le repos, et absolument que toutes les choses naturelles, qui (selon la proposition 29) doivent être déterminées par Dieu à exister et à produire un effet d’une certaine façon. Car la volonté, comme tout le reste, a besoin d’une cause par laquelle elle soit déterminée à exister et à produire un effet d’une certaine façon. Et, bien que d’une volonté ou d’un entendement donnés suivent une infinité de choses, on ne peut cependant pour cela dire que Dieu agit par la liberté de sa volonté, pas plus que, du fait que certaines choses suivent du mouvement et du repos (de là aussi suivent, en effet, une infinité de choses), on ne peut dire que Dieu agit par la liberté du mouvement et du repos. C’est pourquoi la volonté n’appartient pas plus à la nature de Dieu que le reste des choses naturelles, mais elle est avec elle dans le même rapport que le mouvement et le repos et tout le reste, que nous avons montré suivre de la nécessité de la nature divine et être déterminé par elle à exister et à produire un effet d’une certaine façon» – partie I, corollaires de la proposition 32.
«La volonté ne peut être appelée cause libre, mais seulement cause nécessaire.
DÉMONSTRATION
La volonté n’est qu’un certain mode de penser, de même que l’entendement ; par conséquent (selon la proposition 28), chaque volition ne peut exister ni être déterminée à produire un effet, si elle n’est déterminée par une autre cause, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi de suite à l’infini. Que si une volonté est supposée infinie, elle doit aussi être déterminée à exister et à produire un effet par Dieu, non en tant qu’il est une substance absolument infinie, mais en tant qu’il possède un attribut qui exprime l’essence infinie et éternelle de la pensée (selon la proposition 23). De quelque façon donc que soit conçue la volonté, soit finie, soit infinie, elle requiert une cause par laquelle elle soit déterminée à exister et à produire un effet ; par conséquent (selon la définition 7), elle ne peut être dite cause libre, mais seulement nécessaire ou contrainte. C.Q.F.D.» – partie I, proposition 32.
«Tout mode qui existe nécessairement et est infini, a dû suivre nécessairement, ou de la nature absolue d’un attribut de Dieu, ou d’un attribut modifié d’une modification qui existe nécessairement et est infinie.
DÉMONSTRATION
Un mode, en effet, est en autre chose, par quoi il doit être conçu (selon la définition 5), c’est-à-dire (selon la proposition 15) qu’il est en Dieu seul et peut être conçu par Dieu seul. Si donc un mode est conçu comme existant nécessairement et comme infini, ceci, de part et d’autre, doit être nécessairement conclu ou perçu par quelque attribut de Dieu, en tant que cet attribut est conçu comme exprimant l’infinité et la nécessité de l’existence, autrement dit (ce qui revient au même selon la définition 8) l’éternité, c’est-à-dire (selon la définition 6 et la proposition 19) en tant qu’il est considéré absolument. Un mode donc qui existe nécessairement et est infini, a dû suivre de la nature absolue d’un attribut de Dieu; et cela, ou bien immédiatement (voir à ce sujet la proposition 21), ou bien par l’intermédiaire de quelque modification qui suit de la nature absolue de cet attribut, c’est-à-dire (selon la proposition précédente) qui existe nécessairement et est infinie. C.Q.F.D.» – partie I, proposition 23.
Etc. Comme on le voit, la pensée de Spinoza va, comme disait un de ses prédécesseurs, “à sauts et à gambades”, sans ordre et sans suite. Mais non dans l'esprit ni à la manière des auteurs, dont lui, que cette remarque vise: Montaigne parle de la liberté d'écrire, en partant d'une remarque sur une «farcissure [qui] est un peu hors de [s]on thème»:
«Je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique. J'ai passé les yeux sur tel dialogue de Platon mi parti d'une fantastique bigarrure, le devant à l'amour, tout le bas à la rhétorique. Ils ne craignent point ces muances, et ont une merveilleuse grâce à se laisser ainsi rouler au vent, ou à le sembler. Les noms de mes chapitres n'en embrassent pas toujours la matière; souvent ils la dénotent seulement par quelque marque [...]. J'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades. C'est un art, comme dit Platon , léger, volage, démoniaque [...]. C'est l'indiligent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi; il s'en trouvera toujours en un coin quelque mot qui ne laisse pas d'être bastant, quoiqu'il soit serré. Je vais au change, indiscrètement et tumultueusement. Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise, disent les préceptes de nos maîtres et encore plus leurs exemples».
Racontons ma vie: j'ai passé un temps assez long, trois heures au moins, à chercher une version “modernisée” mais non “en français moderne”, des Essais de Montaigne, une traduction et non une “adaptation”, une traduction mais sans excès. Ces temps-ci je prospecte pour trouver une version de la Bible en français qui soit aussi fidèle que possible à l'original sans l'être trop; en explorant, j'ai découvert une classification des traductions en trois types, celles dites littérales, semi-littérales et “à équivalence fonctionnelle”. Bien sûr, ces noms sont inexacts: s'il existait, s'il pouvait exister une traduction littérale, tous les “littéralistes” contemporains produiraient le même texte, ce qui n'est pas le cas; celles dites à équivalence fonctionnelle ne sont pas plus fonctionnelles et pas moins “à équivalence” que les autres, les mots et phrases de la langue cible “équivalent”, “valent à-peu-près” les mots et phrases de la source, toutes les traductions “fonctionnent” mais il n'existe pas de mode de traduction plus fonctionnel qu'un autre; et toute traduction est semi-littérale en ce sens que même celle la plus littérale est une adaptation, donc n'est pas littérale, même la plus “à équivalence fonctionnelle” suit d'assez près la continuité du texte original, donc suit la lettre. Malgré tout, ces trois classes sont assez valides: les traductions dites littérales suivent la lettre au mot à mot, en évitant le plus possible les déplacements (ce n'est pas strictement possible parce que chaque langue organise ses phrases dans un spectre limité de variations, donc des constructions de phrases trop écartées des constructions recevables deviennent inanalysables) et en conservant les mêmes équivalences dans tous les contextes de phrases; celles semi-littérales suivent au plus près le texte original mais moins strictement l'ordre des mots et varieront l'équivalence selon le contexte de phrase et selon l'époque de rédaction – une des tâches de la philologie est notamment de suivre l'évolution du sens des mots selon les régions et les périodes, et leur variété d'emploi, leurs acceptions diverses, pour éviter les erreurs d'interprétation –; celles à équivalence fonctionnelle tendent de rendre l'original dans des formulations équivalentes en sens mais non nécessairement en mots, entre autres elles cherchent des équivalences pour les lieux communs, les expressions figées, les sentences et les expressions proverbiales.
Sans vouloir médire, puisque dans cette partie je suis supposé éviter l'ironie facile, les littéralistes et les “fonctionnalistes” sont des faiseurs, ils trafiquent, ils mentent ou ils se mentent; les semi-littéralistes ne sont pas proprement plus fidèles à l'original mais d'une part s'essaient à le rendre plus accessible que les littéralistes sans le modifier autant que les “fonctionnalistes”, de l'autre ont le plus souvent l'honnêteté de dire que leur traduction ne rend pas compte de cet original. Ils ont aussi une autre qualité, le plus souvent ils proposent d'autres leçons que la leur pour des passages équivoques, et ils fournissent un appareil critique parfois conséquent: les littéralistes donnant censément un équivalent strict, se passent de toute autre leçon et réduisent au minimum leur appareil critique, les “fonctionnalistes” s'éloignant de la lettre, n'ont pas nécessité à justifier leurs choix en fonction de la lettre de l'original, pas d'appareil critique et pas d'autres leçons, donc. Avant de poursuivre, une remarque: il y a une autre sorte de traductions de la Bible, plus rare cependant, celles qu'on peut dire poétiques, le plus souvent elles associent des philologues ou des exégètes et des poètes, pour aboutir à un texte qui suit autant que possible le sens et produit une forme du même ordre, car la Bible est aussi un ouvrage poétique, voire avant tout un poème.
Je cherchais, et n'ai pas encore trouvé, une édition “semi-littérale” de Montaigne parce que je n'apprécie pas celles trop littérales de textes écrits dans un français d'avant le milieu du XVII° siècle mais pas non plus celles qui “traduisent”, qui transforment radicalement l'original au prétexte que le sens originel est largement perdu. Au départ, j'ai pensé citer une édition en “français moderne” (c'est-à-dire, pour le philologues, en français contemporain, car le terme “moderne” suit à-peu-près la périodisation des historiens, le français moderne correspondant à la langue dite classique en vigueur en gros début du XVII° siècle au premier tiers du XVIII° siècle, avant ça c'est le “français moyen”, avant ça “l'ancien français”, et avant ce n'est plus le français, certains parlant de “proto-français” pour la langue qui s'élabore progressivement au tournant des premier et deuxième millénaires), mais elle est vraiment trop “fonctionnelle”, trop distante de l'original, ce qui m'ennuyait. Entre deux maux il faut choisir le moindre, j'ai opté pour une édition un peu trop littérale à mon jugé, qui offre au moins l'avantage de garder la saveur de la langue de Montaigne.
Cette farcissure est un peu hors de mon thème. Enfin non. Enfin oui. Je fais mon Montaigne, je fais mon rhéteur, car je puis dire comme lui que mes chapitres n'embrassent pas toujours la matière de leur sujet; souvent ils le dénotent seulement par quelque marque: j'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades. Et en fin de compte c'est l'indiligent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi. Pour Spinoza je doute: j'ai le sentiment que ce gars se prenait au sérieux et que ses “sauts et gambades” ont plus une visée hermétique que poétique, plus le souci de ne pas rendre son discours trop explicite que le goût de disserter sans trop suivre une supposée linéarité. À preuve qu'il avait raison, son exclusion de sa communauté; à preuve qu'il eut tort, les censeurs sont souvent de très bons lecteurs de textes ésotériques parce que justement ils cherchent le “texte caché” dans les ouvrages, et à coup sûr ils en trouveront un dans les textes ésotériques, pas nécessairement celui que croit y placer l'auteur mais ils en trouveront un, et si c'est caché c'est mal, donc à réprimer...
L'hermétisme est intrinsèque au langage, et le “sens caché” y figure toujours, qu'on le veuille ou non. Partant de ce constat, point trop besoin de se soucier de la forme: l'auteur “littéraliste” qui croit qu'on va au plus proche du sens par la forme comme le “fonctionnaliste” qui croit qu'on va au plus proche de la forme par le sens sont dans l'erreur; le “semi-littéraliste” (donc, tout aussi “semi-fonctionnaliste” puisque entre les deux) est aussi dans l'erreur mais assez souvent il le sait et en prend son parti. Dans «La Farce du changement climatique» je parle assez longuement de la leçon de rhétorique que constitue la plus grande partie de Matthieu, 13, tout le chapitre ,même, si je me souviens. C'est une lecture possible. Plusieurs indices me donnent à croire que l'un des buts de son ou ses rédacteurs fut tel, proposer une leçon de rhétorique, une sorte de “manuel du maître” – du maître de la parole – mais peu importe, puisque je l'y trouve elle y est, dans mon œil et dans mon esprit ce passage s'est inscrit, entre autres choses, comme une leçon de rhétorique. Le sens ne se trouve pas dans la main du rédacteur mais dans l'œil du lecteur – ou dans sa main s'il lit en braille, ou dans son oreille s'il écoute la lecture de ce texte. Le sens, et bien, il est du côté de la partie sensible de l'ensemble texte-lecteur: si personne ne lit le texte, ou si personne ne peut le décoder, il n'a pas d'autre sens alors que son orientation générale par rapport à son environnement, si on peut lui en attribuer une, ou un sens très général, comme les tablettes en “linéaire A” mentionnées dans la première partie de cette discussion, section «Le blues du rédacteur»: pour qui a une certaine familiarité avec les systèmes de signes de type “écriture” ça a toutes les caractéristiques d'une écriture; pour qui a une familiarité avec les systèmes de signes, selon toute apparence c'en est un; pour qui a une familiarité avec les artifices produits par des humains ce sont des artifices. Exemple:
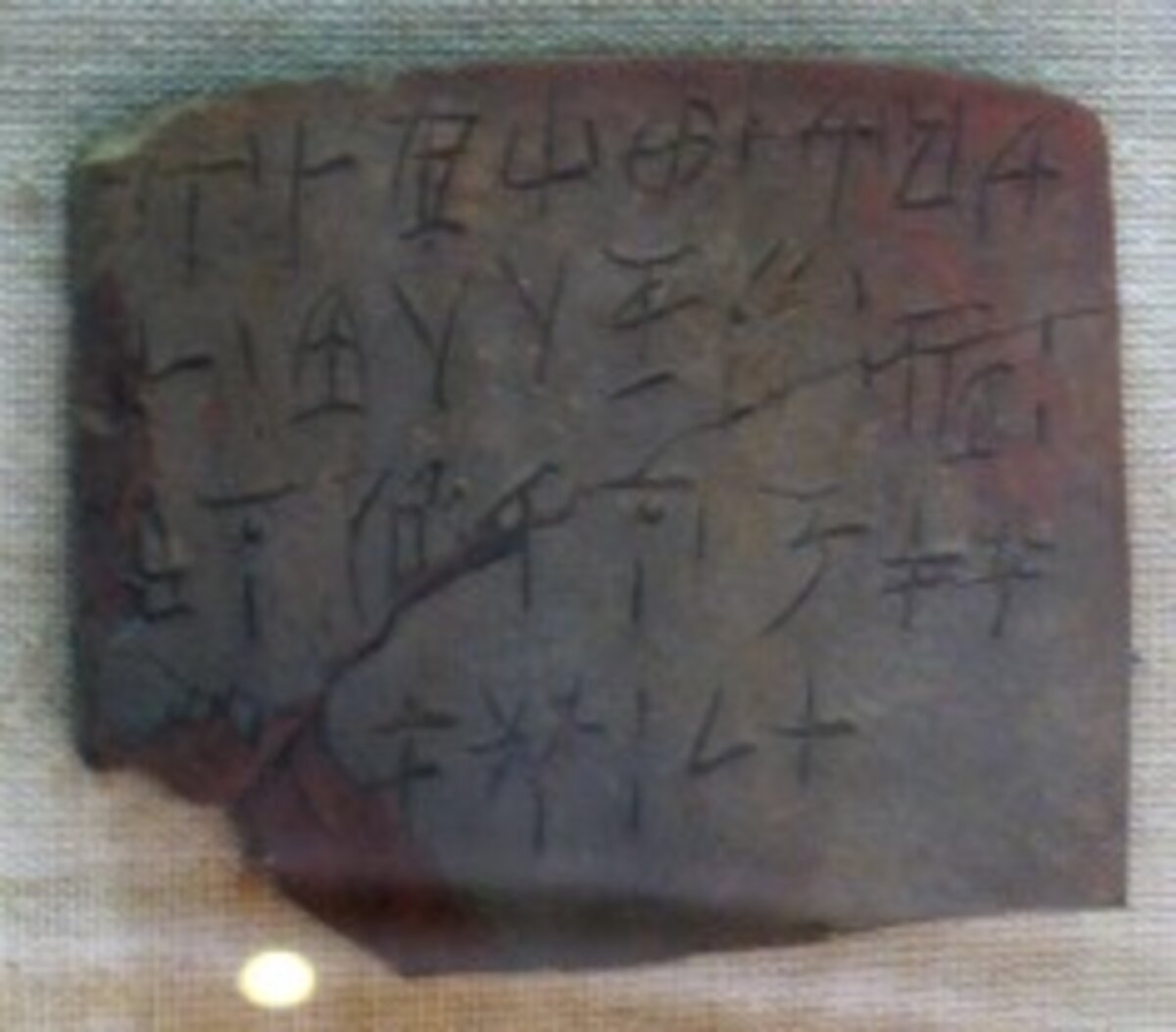
De l'autre bord, quand on n'a pas d'informations précises, ça reste un artifice mais toutes les autres hypothèses sont indémontrables, possible que ce ne soit pas proprement de l'écriture. Non pas en ce cas parce qu'on a le “linéaire B” qui permet de savoir que ces deux ensembles de tablettes sont bien des écritures, mais on peut aussi bien faire l'hypothèse que le “linéaire A” ne note aucun langage, que, je ne sais pas, ce sont des modèles d'écriture ou des essais d'écriture d'apprentis, que ça a autant de signification que les “lignes d'écriture” qu'on fait quand on apprend à écrire. Ou des dessins créés par des non lettrés et librement inspirés des tablettes en “linéaire B” – plus d'un parent pourrait raconter le moment où son enfant a “fait des lignes d'écriture” sans connaître le code mais en comprenant la valeur symbolique du geste, parfois même ça ressemblait vaguement à de l'écriture. Dans la même partie et dans la même section je prends le cas du “rongorongo“, qui a toutes les caractéristiques d'une écriture. Il existe plusieurs tentatives de déchiffrage qui ne sont que de l'ordre de la vraisemblance faute d'indices suffisants, de clés de décodage; on peut associer certains symboles de type pictographique à quelques données anthropologique ou observables mais le seul segment auquel on puisse “donner du sens” est une sorte de calendrier lunaire, donc une réalité symbolique mais non nécessairement associée à une langue.
Ces cas limites illustrent trois de mes propos:
- quelque sens que lui donne son auteur, la signification d'un artifice est produite par son receveur;
- le moyen est le message car on ne connaît pas le “message” que comptaient délivrer les producteurs des tablettes “rongorongo” si du moins c'était un message, un vecteur de message linguistique, mais ces objets sont leur propre message, au minimum “je suis un artifice réalisé par un humain”, “je suis un moyen”;
- si même un tel objet “n'a pas de sens” ou si son producteur ne lui en donne pas (hypothèse “lignes d'écriture d'un apprenti”), quand on cherche on trouve, parfois on trouve “le sens montré”, parfois “le sens caché” donc à coup sûr un autre sens que celui que lui prête son producteur – car le “linéaire A” en tant que lignes d'apprentissage aura quand même un sens pour son producteur, au moins celui de traces de son apprentissage – comme pour les diverses fictions présentées comme un «déchiffrage des rongo-rongo» dans l'article de Wikipédia, alors que ce ne sont que des déchiffrages de l'idéologie des auteurs de ces hypothèses – non qu'elles soient totalement infondées, mais du moins on ne peut proprement parler de déchiffrage, alors que pour le “linéaire A” existent tout de même des éléments pour le déterminer comme un alphabet et en décoder assurément quelques éléments. En tous les cas quand on cherche on trouve, même si on ne trouve pas ce qu'y a placé l'inventeur de l'objet.
Le sens montré et le sens caché... Et bien, si vraiment un système de signes de type écriture “a du sens”, il doit obligatoirement être montré, visible. Dans un système cryptographique, le “sens du message”, sa signification, n'est pas caché, sans quoi son destinataire ne pourrait le décoder, ce que l'on cache, et pas toujours très efficacement, c'est la clé du code. On est, avec un message crypté, dans la même situation qu'avec les “linéaires” ou le “rongorongo“, et on a les mêmes instruments et les mêmes prérequis pour les décoder – ou ne pas les décoder.
Une chose est impérative pour décoder un système symbolique dont on ne détient pas la clé, pouvoir le relier à une réalité autre, qu'elle soit effective ou symbolique: Sans la pierre de Rosette, ou quelque autre moyen permettant de relier les hiéroglyphes avec un autre code, langue parlée ou écrite, on se poserait encore les mêmes questions que pour le “rongorongo”: écriture ou dessins? Idéogrammes ou syllabaire ou alphabet? Et bien sûr, le langage nous resterait hermétique tant dans sa sémantique que dans sa phonétique et sa syntaxe. Remarquez, une pierre de Rosette bilingue grec-hiéroglyphique ne nous aurait donné accès qu'au sens et pour partie à la syntaxe mais non aux sons, c'est la présence de l'égyptien démotique qui ouvre cette partie du code. Un autre type de document, par exemple un lexique bilingue qui noterait aussi le son transcrit en alphabet grec des hiéroglyphes simples ou combinés aurait aussi permis de restituer la phonologie du hiéroglyphique, à l'instar par exemple des équivalents en alphabet latin de mots chinois que l'on trouve dans les articles de la Wikipédia française à côté de leur forme idéographique, comme pour le mot taìjítú, «Le taijitu (chinois simplifié : 太极图 ; chinois traditionnel : 太極圖 ; pinyin : taìjítú; Wade : t'ai⁴chi²t'u²) (figure du faîte suprême)», qui donne le son, le sens et l'idéographie du mot. Nous ne possédons pas de pierre de rosette ni de lexique bilingue pour les “linéaires” et le “rongorongo”, donc il faut trouver un autre moyen pour les décoder. Il se trouve que pour le “linéaire B” on disposa d'une clé, la langue transcrite: par déductions et inductions successives, Alice Kober. d'abord puis Michael Ventris à sa suite, déterminèrent de probables lettres ou syllabes puis le second mit en évidence qu'il note un dialecte grec avec éléments exotiques (dont des toponymes). L'accès partiel au “linéaire A” vient de ce que ces deux systèmes ont des grammes (lettres / phonèmes ou syllabes) communs et aussi certains mots, dont des toponymes. Soit précisé, le “linéaire B” est un système mixte, comme beaucoup d'écritures anciennes et de certaines actuelles, en partie phonétique, en partie idéographique, logographique. Pour le “rongorongo”, rien de tout ça, les seules éléments auxquels on a en partie accès sont ceux qu'on peut relier à une autre réalité, effective (calendrier lunaire) ou symbolique (succession de pictogrammes représentant des objets du réel qui correspondent à des chants ou des récitations comportant les mêmes éléments dans le même ordre). J'ai cédé à l'ironie facile, certaines hypothèses pour le déchiffrement du “rongorongo” ont une certaine validité, mais la langue qu'il pourrait au moins en partie noter reste hermétique.
Tout système de signes est cryptographique, ou cryptophonique, donc toute langue humaine l'est. Dans la même section de la première partie et ici de nouveau je mentionne le fait que même sans pouvoir le décoder, une personne familière des systèmes d'écriture est capable d'identifier comme écriture un système de ce type totalement inconnu et inaccessible pour ses sons et ses sens; mais tout humain qui n'a pas appris à le faire ne peut accéder à quelque langue écrite ou orale que ce soit, on doit lui fournir les clés d'accès, d'abord aux sons ou aux gestes (langue “des signes”, au cas où les langues orales ou écrites ne se baseraient pas sur des signes...) «qui portent du sens», puis aux sens portés par ces signes, la paire signifiant-signifié, forme et sens. Pour un non francophone, le français est un langage cryptographique, il accède à la forme mais non au sens; pour un lettré en chinois qui ne connaîtrait pas les langues parlées associées, il peut accéder au sens mais ça ne lui livrera pas la forme, les sons de ces langues. On peut d'ailleurs établir des cryptographies (dans l'acception usuelle de “langues secrètes”) en retenant les sons associés aux idéogrammes chinois dans une des langues qu'elle note. Même s'il ne s'agit pas ici, ou pas vraiment, de cryptographie, on a le cas de l'écrivain Cordwainer Smith: son nom d'état-civil est Paul Linebarger, son équivalence phonétique approximative en chinois est 林白樂 qui se prononce “Línbáilè”, mais les valeurs sémantiques de ces idéogrammes sont “forêt heureuse”, d'où son premier pseudonyme d'écrivain, Felix C. Forrest, qui associe le sens d'un mot latin et celui d'un mot anglais (de lointaine origine latine) qui peuvent se lire comme “heureuse forêt”. N'étant pas Paul Linebarger je ne certifie rien mais le “C.” entre ces mots peut se lire “see” ou “sea” en anglais, qui pourrait permettre une lecture du genre “heureux de voir la forêt” ou “heureuse forêt de (bord de) mer”. On peut donc inventer un code secret qui associe les idéogrammes à des sons, non des sens – sans que le code soit secret sinon pour la large majorité d'humains qui ne connaissent pas cette langue, c'est ce que firent les japonais: leur écriture est syllabique et reprend au départ des idéogrammes chinois pour leur seule valeur de son.
Les langues sont cryptographiques parce que “le sens des mots” ne vaut que pour une personne, celle qui les dit ou écrit, ou celle qui les ouït ou lit. Bien sûr, il y a un “sens commun” mais labile, variable, fuyant, équivoque car multiple. La citation venant des Essais de Montaigne est pour l'essentiel lisible mot à mot par un locuteur français du XXI° siècle, déjà un peu moins phrase à phrase, et pour qui n'a pas les mêmes références culturelles, une bonne part de ce passage sera équivoque ou incompréhensible, à quoi s'ajoutent les changements de sens des mots et les changements d'usage de la syntaxe. J'évoquais ma réticence envers la version modernisée récente, proposée par Guy de Pernon, elle a au moins l'avantage, en l'accompagnant d'une version seulement modernisée dans la forme, qui suit de près le texte original et n'en fait pas une traduction ni une restructuration, de donner à voir l'écart de sens entre ce que pouvait comprendre un de ses contemporains et un des miens. Je ne suis pas si compétent en ce qui concerne la langue d'avant le XVIII° siècle mais du moins j'ai une assez bonne conscience de cet écart, et quelques connaissances dessus. Un éditeur aurait une excellente idée s'il publiait, sur papier ou en ligne, une édition “bilingue”. Je mets ça entre guillemets alors que ce serait proprement le cas: depuis le VII° ou VIII° siècle s'élabora une nouvelle langue, une lingua franca continentale qui, un demi-millénaire avant celle méditerranéenne, se constitua aussi à partir de quelques langues principales et d'une multitude de langues secondaires, les deux principales langues ou plus exactement les deux principaux ensembles de dialectes, on peut les nommer “latin” et “germain”. Pour mon compte je nomme cette lingua franca le germano-latin, peut-être parce que j'ai un fonds idéologique inconscient qui me fait prévaloir le germain sur le latin, peut-être par un sentiment euphonique qui m'est propre, donc subjectif, probablement plus parce que j'ai un peu idée de l'élaboration de ses diverses variantes, comme il se trouve que la syntaxe de ces variantes doit beaucoup plus au substrat germain qu'à celui latin, et comme une de mes idéologies conscientes, celle que j'ai construite durant mes années d'études en sciences du langage, me fait considérer que ce qui fait une langue est avant tout la syntaxe, ensuite sa mélodie et sa phonologie, en dernier son vocabulaire, de mon point de vue le germain prime le latin car même les langues dites latines ont une syntaxe plutôt germanique. Quant au vocabulaire, c'est variable et pas toujours spécialement moins “germanique” dans les langues actuelles dites latines que dans les autres. De toute manière, une part non négligeable des vocabulaires des diverses langues issues des dialectes germano-latins ont une origine ni latine, ni germanique, mais puisent dans le grec, l'hébreu et l'araméen, l'arabe, et à des degrés divers toutes les langues du monde: si j'écris que mon karma s'approche du nirvana quand mon gourou m'initie aux plus subtils sutras du yoga, j'écris une phrase française dont pas un substantif n'est issu d'une langue d'Europe centrale ou occidentale. Bien sûr j'ai pris plaisir à les prendre tous des langues du sous-continent indien, mais su j'avais évoqué le plaisir de siroter un café, assis sur mon divan ou allongé dans mon hamac sous ma véranda, revêtu de mon pyjama de soirée ou de ma djellaba, la majorité des substantifs aurait été tout aussi extra-européenne, et la phrase un peu plus ordinaire et sensée Si j'y avais ajouté du tabac et de l'alcool ça nous aurait fait voyager encore un peu plus dans les langues et les continents...
Donc, une série de pidgins et de créoles qui se créent un peu partout en Europe centrale et occidentale, à base germano-latine avec ajouts de plusieurs langues locales ou distantes, notamment le grec, l'araméen et l'hébreu, “christianisation” de cet espace le voulant – cela dit, le grec avait déjà fourni un stock non négligeable de mots en latin dès l'époque républicaine de la Rome antique, ainsi que l'étrusque et certains dialectes “gaulois”. Tiens tiens, voilà qui nous ramène tout doucement à la question du titre... Quand commence cette Histoire-ci, celle des langues germano-latines, il y a deux groupes de pouvoir, l'un déclinant, sis plutôt au sud et à l'ouest, avec le latin comme langue fédératrice, l'autre émergeant, sis plutôt au nord et à l'est, avec plusieurs dialectes “germains” encore assez proches (une situation très semblable à celle des langues dites slaves, qui sont assez différentes mais qui ont une assez grande proximité pour pouvoir communiquer sur l'essentiel sans trop de problèmes entre voisins, et même entre lointains); les élites “déclinantes” comme celles “ascendantes” pratiquent comme l'ont toujours fait les élites depuis au moins six, plutôt sept à huit millénaires: s'appuyer autant que possible sur des élites locales dans les territoires nouvellement annexés, si possible celles déjà en place, sinon, et bien, on trouvera presque toujours assez de membres des “classes moyennes supérieures” prêts à perdre l'adjectif “moyennes” de leur définition de classe pour s'en faire des alliés. J'y reviendra plus loin, du moins faut-il considérer que les fameuses fables des “grandes invasions” et de la “chute de l'Empire romain” ne rendent qu'assez mal compte de la réalité de la transition longue qui eut lieu principalement du IV° siècles au début de VII°. Certes il y eut bien un affaissement multifactoriel de la partie occidentale de l'Empire romain qui affaiblit beaucoup sa superstructure et selon les régions, diversement son infrastructure, mais pas réellement de chute, parce que les nouveaux maîtres n'étaient pas des imbéciles – le jour où vous verrez des cons devenir durablement maîtres des salauds n'est pas venu, à mon avis, quand les cons se prennent pour des salauds ça ne dure pas très longtemps... En fait, assez vite les “envahisseurs” qui n'étaient pas encore “latinisés” le furent, parce que ça leur permettait de disposer d'un très bon instrument de communication déjà maîtrisé par les élites locales. Manière rapide de raconter les choses: en un premier temps cette acculturation ne concerne que les élites, aux niveaux en-dessous on préfère ne pas trop aller dans ce sens, si tout le monde maîtrise la langue des maîtres, qui sont les maîtres? Tout le monde?
Je passe sur les siècles, les brassages, les renversements d'alliances et de pouvoirs, en tous les cas à la fin du premier millénaire les dialectes nouveaux commencent à se stabiliser et se différencier pour devenir à leur tour des langues, mais entre ces débuts de stabilisation et la fin du processus il se passe beaucoup de temps: le premier texte attesté en “bilingue” proto-français et proto-allemand, les Serments de Strasbourg, est daté de 842 mais attesté bien plus tard. C'est une forgerie, mais j'en discuterai plus tard, par contre ça donne une idée de l'évolution géopolitique de la période, avec du côté des élites des options plus nettement “germaniques” ou “latines” selon le territoire considéré des deux prêteurs de serment qui s'entendent (très provisoirement) pour faire un sort à un tiers absent, leur “bien aimé frère” – les absents ont toujours tort... Celui qui s'appuie sur les territoires du nord-est prête serment en “tudesque”, celui qui s'appuie sur le sud-ouest, en “roman”. Pour le tudesque je ne dirai rien, pour le roman, c'est lisiblement la langue des troupes, le bas-latin, mais “modernisé” (avec une syntaxe déjà assez différente de celle du latin, du moins de celui écrit), et très probablement ça ne rend pas compte du serment réellement prononcé, on dira, une version diplomatique à destination des élites politiques du sud-ouest. Cela posé, on peut supposer que ces “serments de Strasbourg” sont quelque chose d'assez proche de la “loi salique”, un document créé ultérieurement pour légitimer la situation du moment, celle qui fut – provisoirement – défavorable aux tenants d'une autre version, celle dite du Traité de Verdun de la mi-843, dont “malheureusement” on n'a pas trace, quand le frère absent se révéla plus coriace que prévu et les frères présents à Strasbourg moins solidaires que juré près d'un an et demi avant. Il se trouve que le diffuseur initial du texte des serments de Strasbourg, Nithard, était aussi un parent – un cousin – des trois frères et un allié d'un des deux prêteurs de serment de 842, Charles le Chauve, et il se trouve que la branche du frère absent de 842 s'éteignit prématurément, avec l'aide active des deux autres frères et de leurs descendants. Charles initia la constitution de ce qui deviendra par la suite la France, son frère Louis le Germanique, ce qui sera le premier centre du Saint-Empire romain germanique (ce qui montre au passage que les “Tudesques” de 842 étaient tout de même assez “Romans”). De toute manière, le plus ancien manuscrit du document connu comme Les Serments de Strasbourg est bien postérieur à ce moment, et bien postérieur au décès de celui à qui on l'attribue, Nithard, mort au plus tard en 856 ou 857, alors que le manuscrit date environ de l'an 1000 – enfin, est supposé dater de cette époque. Savez-vous? Je ne crois pas trop au hasard. Aux aléas oui, aux accidents oui, au hasard non. Le manuscrit censé daté du tout début du millénaire eut un parcours à éclipses jusqu'au XV° siècle au moins, l'autre manuscrit le plus ancien date précisément du XV° siècle, et, ô hasard! Fut fait du côté où était en train de se résoudre la succession au trône de France en faveur des continuateurs de Charles le Chauve (ou des usurpateurs, selon le point de vue, les Capétiens, qui hâtèrent un peu l'extinction de cette branche carolingienne...). Non que je doute vraiment de la datation du manuscrit du début du XI° siècle, par contre j'ai quelques doutes sur un supposé original du milieu du IX° siècle.
Zut! J'ai un peu anticipé sur la suite. Les langues européennes ne se firent pas en un jour, ni en un siècle, il n'y a pas un moment, 842, où le français naît, si vous lisez le serment en question vous verrez que le “roman” ressemble beaucoup plus au latin qu'au français même du XIII° siècle, disons, beaucoup plus à ce que deviendront les langues italiques, spécialement l'italien, qu'à ce que devint le français. Je parle du XIII° siècle parce qu'à l'époque il n'y a pas encore proprement de langue française, juste ces deux groupes de langues dites d'oïl et d'oc, parfois convergentes, parfois divergentes, selon le moments et les évolutions géopolitiques: au tournant des VIII° et XIV° siècles le futur anglais est l'anglo-normand, à cet époque plus “normand” que “anglo”, une des variantes des dialectes d'oïl; ce n'est qu'au XV° siècle, quand les rois d'Angleterre ont durablement perdu toute chance de reprendre le dessus sur le continent, et perdu au passage la partie continentale du duché de Normandie, que l'anglo-normand se “saxonnisa”, la composante normande resta assez forte mais politiquement il valut mieux parler d'anglo-saxon. Au moment où Montaigne écrit, le français est une langue toute neuve, devenue depuis peu avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 la seule langue administrative autorisée à l'exclusion du latin et des autres langues vulgaires. Mais il faudra encore un bon siècle et demi après cette ordonnance pour qu'elle se normalise. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de lire les pièces de Corneille et Racine dans leur forme originelle, celle de leurs premières publications, vous risquez de trouver l'orthographe et parfois la syntaxe un peu exotiques, et même, à l'occasion vous découvrirez des vers différents de ceux correspondants dans les éditions contemporaines. Factuellement, ce n'est que dans la première moitié du XVIII° siècle que la langue écrite se stabilise mais il faudra encore un siècle environ pour que les orthographes connaissent moins de variations: même dans des éditions qui éliminent les éléments de typographie pas faciles à décoder quand on n'a pas l'habitude, l'orthographe de textes du début du XIX° siècle est parfois assez dépaysante...
Les langues, ça bouge sans cesse, et pas seulement dans la forme – orthographe ou phonologie et syntaxe. Tenez, un truc: il y a une vingtaine d'années, quand la chose commença de se répandre, j'avais l'habitude de corriger mon neveu – gentiment cela dit – quand il employait “trop” là où moins d'une décennie auparavant on s'attendait à entendre “très”. Avec ma nièce, de vingt ans plus jeune, j'ai renoncé: ce qui au début du millénaire apparaissait à pas mal de gens une anormalité tend à devenir la norme. C'est un exemple entre mille, non pas d'usage d'un mot nouveau pour une notion ancienne mais d'un mot ancien dans un emploi nouveau, parfois avec exclusion des emplois anciens. La réalité change, la langue avec elle. J'aime bien me servir du cas du mot “voiture”: en 1910, quand on devait préciser, c'était pour mentionner “voiture automobile” car la voiture était à l'évidence mue par des chevaux; un quart de siècle plus tard “voiture” et “automobile” étaient interchangeables, et il fallait préciser “à cheval” parce que c'était déjà un véhicule de l'ancien monde. En 1985, quand ça ne désignait pas les motifs d'un crime, un mobile était un objet décoratif avec des machins qui pendouillaient en s'entrechoquant; un quart de siècle après c'est surtout un ordinateur ou, le plus souvent, un téléphone, qui peuvent aussi être les mobiles d'une action délictueuse, le vol. Et je présume que si on parlait devant un jeune Français des mobiles de Calder il imaginerait une nouvelle marque de smartphones ou un nouveau serial killer.
J'ose espérer que ce qui précède ne sera pas interprété comme les jérémiades d'un vieux réac contre l'évolution des langues, mais si l'espoir fait vivre il n'évite pas les contresens, les langues change comme le monde change, si on est contre mieux vaut cesser de vivre parce que c'est le cours normal des choses, c'est précisément ce qui fait le charme de la vie. Ce qui ne m'empêche de considérer certaines évolutions, dans la langue comme dans le monde, problématiques. J'ai pris le cas du remplacement de “très” par “trop” dans certains contextes, à quoi s'ajoute l'emploi de “trop” sans complément, «Ce film, il est trop!», par exemple, parce qu'il m'ennuie: “très” vaut pour “beaucoup”, “trop” pour “excessivement”, quand on vit dans une société où l'excès est connoté positivement dans les situations les plus ordinaires, ça pose problème, et pas seulement à moi. En fait, à moi “trop moins” qu'a celles et ceux qui vivent dans un monde “trop” et trouvent ça «trop bien!». Quand l'excès est la norme, qu'est-ce qui est excès relativement à la norme?
Mon but dans cette partie de la discussion, avant d'en revenir brièvement à Montaigne, est d'alerter sur l'instabilité de la langue et l'influence de ses changements sur notre rapport au monde. Vous vous souvenez de la blague sur le noir qui est noir pour les uns et blanc pour les autres? Pour moi, “très” est orange, “trop” est rouge, “ni très ni trop” est vert. Si pour vous “ni très ni trop” est incolore ou gris, “très” est vert et “trop” est orange, à quel niveau situez-vous le rouge? Je ne sais pas, mais en tout cas bien après que pour moi tous les signaux soient au “trop”...
Montaigne. La “traduction” de Guy du Perron en “français moderne” ne me plaît pas mais elle va cependant me servir. Voici les deux versions du passage cité, celle en français orthographique contemporain et celle en “équivalence fonctionnelle”:
«Sur l’art de conférer (De la conversation).
Éloge de l’inspiration poétique.
Cette farcissure est un peu hors de mon thème. Je m'égare, mais plutôt par licence que par mégarde.
Ce qui précède est un peu du remplissage, et en dehors de mon sujet. Je m’égare... mais plutôt par une liberté voulue que par mégarde.
Mes fantaisies se suivent, mais parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique.
Mes idées se suivent, mais parfois de loin; elles se répondent, mais de façon détournée.
J'ai passé les yeux sur tel dialogue de Platon mi parti d'une fantastique bigarrure, le devant à l'amour, tout le bas à la rhétorique.
J’ai jeté les yeux sur un dialogue de Platon, divisé en deux parties fort contrastées: la première consacrée à l’amour, tout le reste à la rhétorique.
Ils ne craignent point ces muances, et ont une merveilleuse grâce à se laisser ainsi rouler au vent, ou à le sembler.
Les Anciens ne craignaient pas ces variations, et se laissaient porter ainsi au vent – ou faisaient semblant de le faire – avec une élégance surprenante.
Les noms de mes chapitres n'en embrassent pas toujours la matière; souvent ils la dénotent seulement par quelque marque [...].
Les noms de mes chapitres n’en couvrent pas toujours le sujet; souvent ils n’y font qu’une allusion, par quelque côté [...].
J'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades. C'est un art, comme dit Platon , léger, volage, démoniaque [...].
J’aime que l’on écrive de façon poétique, en sautillant, en gambadant. C’est, comme le dit Platon, un art léger, volage, inspiré [...].
C'est l'indiligent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi; il s'en trouvera toujours en un coin quelque mot qui ne laisse pas d'être bastant, quoiqu'il soit serré.
C’est le lecteur peu attentif qui risque de perdre mon sujet – pas moi. On trouvera toujours, dans quelque recoin, un mot qui doit suffire, même s’il est peu visible.
Je vais au change, indiscrètement et tumultueusement. Mon style et mon esprit vont vagabondant de même.
Je fais des variations à tout bout de champ, sans me restreindre. Mon style et mon esprit vagabondent de concert.
Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise, disent les préceptes de nos maîtres et encore plus leurs exemples.
“Il faut mettre un grain de folie pour éviter trop de sottises”, voilà ce que disent nos maîtres – et surtout par les exemples qu’ils en donnent».
On aura compris j'espère en quoi cette “traduction” me déplaît: l'auteur anticipe un tel niveau d'inculture et d'idiotie de ses possibles lecteurs qu'il juge opportun de “traduire” des mots et des phrases qui restent compréhensibles dans leur forme première, il ne simplifie pas, il appauvrit, et en plus il change le sens du propos. Bien sûr que «C'est l'indiligent lecteur qui perd mon sujet, non pas moi» est pas de compréhension immédiate ni aisée, mais qui connaît les règles de construction des mots du français peut lire “non diligent”, et n'importe quel dictionnaire papier ou en ligne apprendra à qui ne connaît pas le mot que “diligent” signifie «Qui met toute l'application nécessaire (à l'exécution d'une tâche)» (définition TLF) ou «Qui est prompt dans l’exécution d’une chose» (définition Wiktionnaire), donc, est indiligent qui ne met pas toute l'application ou la promptitude nécessaire à l'exécution d'une chose, d'une tâche. C'est mon lecteur négligent qui perd le fil du discours, et non moi. L'une équivalence vaut l'autre sauf pour “qui risque de perdre”, un ajout qui change tout le sens de cette phrase: le lecteur indiligent ne risque pas de perdre le fil, il le perd, nécessairement, non un risque mais une certitude. Ce qui était un avertissement, ne perdez pas le fil, vous y perdrez tout, devient une remarque badine et sans conséquence. Du fait, la phrase suivante prend un sens à-peu-près inverse de celui originel, non plus un complément de l'avertissement, “en manquant de vigilance vous risquez fort de manquer un mot qui est nécessaire, quoi que peu visible”, mais “si vous faites attention pour la suite, vous rattraperez votre manque de vigilance”. L'auteur dit qu'il ne faut surtout pas manquer de vigilance car on ne rattrape jamais une erreur passée, le traducteur, qu'une faute est “presque” toujours pardonnable...
Après la badine, la brosse dans le dos: un passage comme «Je vais au change, indiscrètement et tumultueusement», est de lecture malaisée pour un lecteur contemporain, la leçon «Je fais des variations à tout bout de champ, sans me restreindre» me semble alors intéressante car elle avertit que l'on risque de passer à côté du sens en se laissant abuser par des mots “simples”, qui feront qu'on ne s'y arrêtera pas même si on a du mal à saisir le sens de la phrase. Après la brosse, l'ironie facile: le traducteur trouve vraiment que «Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise, disent les préceptes de nos maîtres et encore plus leurs exemples» est d'interprétation difficile? S'il le pense pour lui-même, c'est triste, s'il le pense pour ses lecteurs, c'est désolant... Une chose m'est hermétique et devrait me le rester, je suppose: pourquoi “traduire” cette partie intitulée «Sur l’art de conférer» ou «De la conversation» par «Éloge de l’inspiration poétique»? C'est ainsi, ce travail prête tant à l'ironie facile que j'ai du mal à m'en priver...
Je n'ai pas découvert de version “semi-littérale” gratuite pour Montaigne, mais je ne désespère pas – non que ça m'intéresse tant, j'en suis marri dans le cadre de cette discussion, voilà tout –, cela dit Montaigne me semble assez décodable. Par contre, pour un ouvrage comme la Bible, je vous conseille, si vous vous y intéressez, de disposer d'une version littérale et de deux semi-littérales, celles littérales sont de lecture difficile et d'un intérêt limité, à mon jugé, celles “à équivalence fonctionnelle” sont indigentes et faussent le sens par une surinterprétation très idéologique – presque toutes viennent de mouvements sectaires vaguement chrétiens mais à coup sûr «pas très catholiques», même quand supposés catholiques –, avoir à disposition, par exemple, la traduction Segond 1910 plus n'importe laquelle de celles signalées dans cette page (incidemment, classer les traductions Segond parmi les “littérales” me semble inexact), si vous avez un peu de sous à dépenser je vous conseille la traduction œcuménique, celles de 1975 ou de 1995 suffisent et coûtent moins que la plus récente, de 2010, en versions papier on les trouve même d'occasion, et pour une littérale, mais alors là, très littérale, quasi du mot à mot, la traduction d'André Chouraqui a l'avantage de se trouver gratuitement en ligne. Pourquoi trois versions? Pour voir les écarts. Celle littérale offre l'avantage de donner le plus souvent une même translation pour un même mot, une même expression; ça n'est pas toujours pertinent mais du moins, ça peut être indicatif d'un trop grand écart entre la source et la cible, et dans tous les cas ça donne une idée de la différence conceptuelle entre les cultures source et cible. Au fait, je vous ai dit que je suis un peu pervers en tant que lecteur? J'aime bien la traduction Chouraqui. Pas trop longtemps mais j'aime bien. Elle est d'un abord ardu mais a une certaine poésie. Ce qui me rappelle de mentionner une autre traduction, du genre que je disais poétique, avec l'association d'un exégète et d'un poète pour chaque livre, parue en 2001 sous la direction de Frédéric Boyer, Marc Sevin et Jean-Pierre Prévost.
Qui raconte l'Histoire? Ma Pomme. Entre autres. Je comptais le mentionner, peut-être l'ai-je fait mais il me semble que non, j'ai produit plusieurs récits de mêmes moments historiques, parfois contradictoires ou incompatibles, parfois multiples – plusieurs descriptions d'un événement, d'une séquence. Des récits tantôt très “fictifs”, tantôt très “factuels”. Certaines fois je précise que ça n'a pas trop de consistance, d'autres fois, sans le dire mais en le donnant à penser je les présente comme très vraisemblables, genre “vérité historique”. Qu'est-ce que je sais de l'Histoire? Ce que vous en savez, c'est-à-dire rien ou presque – vous y étiez, vous, alentour de l'an mil, quand quelqu'un, supposément, “copia” une Histoire des fils de Louis le Pieux supposée avoir été rédigée par un certain Nithard à partir de 843, supposément à la demande de son supposé cousin Charles le Chauve, où figurent de supposés “serments de Strasbourg”. Les généalogies et les “vies” d'avant, disons, comme ça, au doigt mouillé... Ouais, je ne sais pas, d'avant un certain moment, et même encore un peu, ou beaucoup, après, donc, les généalogies et les “vies”, c'est plus ou moins gravé dans le marbre. Il semble que le nommé Nithard a bien existé, qu'il était dans les papiers de certains “puissants”, qu'il a dit ou dont on a dit ou dont on a dit qu'il a dit qu'il était plus ou moins le fils de Berthe, une des filles du Grand Charles (mais non! pas la fille de Charles de Gaulle! la fille du premier “grand Charles”, vous savez, Charles le “magne”, le “grand”) et probablement d'un nommé Angilbert, qu'était pas tout frais quand, à ce qui se dit, il se mit à la colle avec ladite Berthe, franchement plus jeune – z'avaient dans les quarante ans d'écart d'âge –, le temps de lui faire deux gnards et puis s'en va, ladite Berthe, ainsi que toutes ses sœurs, furent mises à l'écart juste après la mort de Charles par le très aimable et très pieux Louis, fils de Charles et père de trois garnements qui ne s'entendirent vraiment – et brièvement – que pour destituer leur père en 833, mais leurs dissensions, qui ne firent que s'accentuer avec le temps, permirent à Louis de se rétablir un bref moment; après sa mort en 840, et même un poil avant, tout s'embrouille et tous s'embrouillent, avec le fameux moment de 842 et des serments qui unissent un bref moment encore deux des frères contre le troisième, qui se la pétait un peu trop, puis tout le monde se réconcilie (un peu par nécessité, et même beaucoup, vu que chacun ayant trahi chacun deux ou trois fois déjà, les positions des trois frères en tant que chefs de leurs plus ou moins partisans commençaient à devenir assez précaires) mais pas très longtemps. Ça vaut le coup de regarder tout ça d'un peu près. En toute sincérité, quand on s'y attarde nait un fort sentiment de “reconstruction historique” in media res, chaque épisode étant réécrit très peu après que de nouvelles alliances tout aussi précaires que les précédentes s'établit. Et chaque acteur tentant de démontrer que la situation dans laquelle il se trouve est justement celle qu'il escomptait. Le frère aîné, Lothaire, a vu par exemple ses ambitions très réduites mais il fut censément parmi les vainqueurs.
Je le disais au début de cette partie, ma dernière opinion quant aux rédacteurs de l'Histoire est: surtout les vaincus. Car, comme dit déjà, on a beaucoup plus de vaincus que de vainqueurs au cours des temps, donc beaucoup plus de raconteurs vaincus que vainqueurs, mais que les vaincus préfèrent dire qu'ils ont choisi leur destin que de faire le constat que non, vraiment non, c'est pas ça, et qu'ils ont foiré. Considérez, au hasard, le gouvernement français de 2019 et ses soutiens: vous avez l'impression que leur parcours actuel est plutôt de l'ordre “réussite” ou plutôt “échec”? Il y a les discours et il y a les faits, et côté faits, il y a une grande distance entre ce que prévu et ce que réalisé. Un exemple parmi d'autres: comme tous les précédents exécutifs de ce début de millénaire, celui de 2019 a décidé, peu après son arrivée en fonction, de donner aux riches et de reprendre aux pauvres, avec l'idée indémontrée et indémontrable, et pour l'heure jamais vérifiée, que d'une part donner aux pauvres ne réduit pas la pauvreté mais réduit la richesse, de l'autre les riches ont prouvé par leur accumulation de richesses leur capacité à “créer de la richesse”, “donc” à “réduire la pauvreté”. Ce qui ne tient pas compte de faits démontrés et démontrables, et pour l'heure très souvent vérifiés, du genre: l'enrichissement des riches résulte souvent de l'appauvrissement des pauvres – quand en début de mandat on réduit la redistribution vers les moins riches et les plus pauvres et qu'on augmente les perceptions uniformes qui touchent indifféremment riches et pauvres tout en réduisant les perceptions progressives qui touchent plus les riches que les pauvres, les riches s'enrichissent sans pour autant “créer de la richesse”; quand on y ajoute en outre des mécanismes de réduction du niveau d'imposition par perception directe – impôts sur les sociétés et impôts sur le revenu notamment –, les seuls qui peuvent en profiter sont les personnes morales et physiques qui sont imposables, ce qui réduit encore la redistribution puisque les riches donnent encore moins sans que les pauvres reçoivent plus. Les processus du genre potlatch ou évergétisme ou jubilé se basent sur ces faits d'observation assez sommaires mais toujours vérifiés: donner de la richesse aux riches les enrichit sans réduire la pauvreté des pauvres, donner de la puissance aux puissants augmente leur puissance sans réduire l'impuissance des impuissants.
L'Histoire? Je vais vous la raconter en bref, en très bref: dans toute société, les périodes où les choses vont le mieux sont toujours celles où on opère une forte réduction des inégalités, celles où elles se dégradent, celles de forte progression des inégalités. Et l'issue du creusement accru des inégalités a le plus souvent le même résultat: la guerre. Toute guerre est fondamentalement une guerre civile, car toute guerre a pour but de régler un problème social. Et ce problème est toujours le même: l'inégalité croissante entre les membres de la société.
Quand j'en viens à des points de ce genre je me confronte toujours au même problème, la question des complots. Ils sont là. Ils sont évidents et visibles. Ils ne se masquent pas. En 1944-45, tous les fauteurs de guerre de 1935-38 ont perdu, y compris ceux qui semblent du camp des vainqueurs. Selon les cas, ils parviendront ou non à un compromis. En France on y parvint assez vite – les rares vaincus sans espoir à court et moyen terme de se rétablir ont assez vite monté en épingle “l'épuration” avec l'intention de créer, comme dit l'article de Wikipédia, une “légende noire”, alors que l'épuration dure des toutes premières semaines fit assez peu de victimes et dura très peu, celle “légale” fut assez brève, quelques mois, avec peu de condamnations lourdes, et trois amnisties successives et assez rapides, en 1947, 1971 et 1953, réduisit encore plus la durée et l'ampleur des ces condamnations –, après moins d'un an les choses revinrent presque à la normale d'un point de vue structurel, après deux ans elles y revinrent même si sur d'autres plans (notamment ceux du logement, et les approvisionnements toujours difficiles – il y eut du rationnement jusqu'en 1949, des carences en ressources jusqu'au milieu de la décennie suivante). Je l'évoque dans «Qu'est-ce que le fascisme?», le programme du CNR fut très vite mis en place, la partie proprement institutionnelle, le «plan d'action immédiate», dès la Libération pour empêcher les Alliés, en tout premier les États-Unis, de mettre en place leur propre projet, et les parties économique et sociale assez vite après, dans les deux premières années pour l'essentiel. Vous apprendrez en lisant l'article de Wikipédia que ce qu'écrit dans «Qu'est-ce que le fascisme», que ce programme qui mécontentait presque tout le monde (trop mou pour les “révolutionnaires”, trop dur pour les “réactionnaires”) reçut l'appui de presque tous après la Libération, n'est pas une opinion mais un fait. Ce qui explique largement pourquoi assez vite après il reçut toutes les critiques quant à son inefficacité, contre l'évidence des faits. Nier les complots c'est nier la réalité. Le fait que le plus souvent les complots échouent dans leurs projets, souvent dès l'origine et dans presque tous les cas à moyen terme, ne prouve pas leur inexistence: dès la Libération mais plus clairement de 1946 à environ 1965, les “deux grands” organisèrent et soutinrent en France des courants censément “de leur camp”, et parfois censément “contre leur camp”, dans le but très explicite d'y faire triompher leur propre projet de société; que ça n'ait pas très bien fonctionné n'y change rien, il y eut bien, parmi plusieurs autres de moindre ampleur, deux vastes complots soutenus, financés et structurés par les États-Unis et la Russie (on dira “le Monde Libre” capitaliste et “le Monde Libre” soviétique), qui s'épuisèrent, du moins pour la France, vers le milieu de la décennie 1960.
Quel est le problème avec les complots? Je précise: non pas avec le fait des complots mais avec leur interprétation. C'est leur analyse en cause et non en effet. Un complot n'est pas une “cause” mais une “conséquence”, la conséquence d'une situation antérieure. Ces deux complots indéniables désignés assez faussement “la Guerre froide”, animés, l'un par “le bloc de l'ouest”, l'autre par “le bloc de l'est”, visent à la même chose que celui antérieur qui conduisit à la première guerre mondiale et connut une conclusion provisoire avec la deuxième, et à la même chose que tous les complots de tous les temps, quelle que soit leur ampleur, qu'on peut nommer “solder les comptes”. Il m'arrive de décrire la vie sociale, et plus largement la vie, comme un jeu. En titre court, je le nomme d'un nom très classique, «le jeu du chat et de la souris», en titre long «le jeu des chats, des chiens, des souris, des rats, de l'Arbitre et de l'Autre». J'en parle dans ce billet ou dans l'un des deux autres en cours, je suppose que ça doit être dans «La Farce...» – non, c'est dans «...le fascisme?» –, les humains “s'identifient”, il s'identifient à tout et à n'importe quoi. Comme l'expliquait récemment Boris Cyrulnik sur ma radio (émission Les Chemins de la philosophie du 24 juin 2019 sur France Culture), le cerveau d'un être humain et plus largement d'un mammifère ne s'active que par le contact avec un autre cerveau, précisément un cerveau déjà actif, déjà activé, il citait le cas, déjà évoqué la veille dans l'émission Une histoire particulière, épisode «Le manoir de Bois Larris, Les enfants du Lebensborn», deuxième partie, des orphelinats roumains de l'époque Ceaucescu, où les enfants étaient privés de toute interaction avec des aînés socialisés, ce qui les empêchait de développer les processus de création de réseaux synaptiques qui permettent à un individu de construire son rapport au monde: passé un ou deux ans ça crée des “lésions comportementales” irréversibles, passé quatre ou cinq ans ça crée des “lésions vitales” irréversibles, les individus sont insensibles et catatoniques, une sorte de “coma dépassé” induit. Entre autres processus, l'identification: les individus construisent leur rapport au monde par imitation des comportements des personnes et plus largement des êtres vivants avec qui ils sont en interaction; en un second temps, ils peuvent inventer d'autres identifications, l'exemple donné dans l'autre billet du “loup des steppes” opiomane rend compte d'une identification non par imprégnation mais par décision – plus ou moins volontaire cela dit, mais peu importe ici.
Le cerveau est un objet curieux, j'entendais récemment une émission, toujours sur la même radio, là je ne peux pas vous dire laquelle et quand, un truc entendu la nuit, vers deux ou trois heures, une vieille émission, fin des années 1950 ou début des années 1960, où le gars qui causait et dont j'ignore le nom disait quelque chose de fort intéressant: les sensations “nourrissent le cerveau”. Il le disait non sur un plan symbolique mais effectif: une sensation est un transport d'énergie depuis les récepteurs jusqu'au cerveau, donc plus on reçoit de sensations plus on transporte d'énergie, qui au niveau du cerveau est convertie en énergie électrique ou électronique, une manière simple et directe de “nourrir le cerveau”, lequel est très gourmand en énergie. Certes ce n'est pas l'apport principal mais cette méthode a un grand avantage, très peu de perte entre la zone de perception et celle de réception, alors que l'autre circuit, celui qui passe par le tube digestif, connaît beaucoup de déperdition. En gros, la différence entre les capteurs d'énergie à domicile (capteurs solaires, éoliennes, roues hydrauliques) et le réseau électrique: les capteurs proches recueillent peu d'énergie mais on en utilise la plus grande part, alors que les pertes sur le réseau représentent 40% à 80% de la dépense énergétique pour la production d'électricité. Au passage, les propagandistes qui luttent contre l'extension des moyens de production d'énergie dite propre ne tiennent pas compte, ou du moins ne semblent pas en tenir compte, de deux faits: si même ce qu'ils prétendent, que le rendement de ces moyens n'atteindra jamais plus que 30% à 35% des moyens actuels, en réduisant les pertes locales par une meilleure isolation thermique et des instruments moins dispendieux, comme c'est déjà le cas pour les sources lumineuses (LED ou ampoules basse énergie) et pourrait l'être pour bien d'autres objets, et en utilisant cette énergie directement – non pas la convertir en électricité mais l'utiliser comme force motrice ou source de chaleur – on pourrait réduire notre dépense énergétique actuellement “électrique” d'un ordre de deux-tiers assez facilement, donc au niveau qu'ils supposent atteignable pour les énergies dites propres. L'erreur conceptuelle ici est de vouloir produire “à l'ancienne” avec des moyens qui ne sont pas adaptés à ce modèle de production mais très bien adaptés pour un autre modèle. Passons...
Ou alors, ne passons pas. Voilà un bon exemple de schéma complotiste.
Au cours des, en gros, six dernières décennies, s'est mis en place un “réseau de régulation sociale” qui fonctionne très différemment de celui en vigueur à l'époque et encore largement en place aujourd'hui. Enfin s'est mis en place... Eh voilà! Encore obligé de mitiger mes affirmations... Pour dire ça en gros, en très gros, en franchement grossier et approximatif, c'est une histoire de corps et d'esprit. Les corps et les esprits c'est comme les conspirations et les complots: les esprits je n'y crois pas mais je les constate, les corps j'y crois mais je ne les constate pas. Pour les corps je prends souvent mon cas: entre le jour de ma naissance (et même un peu avant) je suis le même, le même individu, la même personne, donc “le même corps”, sinon que presque tout ce qui me constituait le 11 mai 1959 ne participe plus de moi. Comme je me sais “le même” je “crois en moi”, je me suppose un corps continu, ce que la réalité objective ne confirme pas vraiment. Quant à l'esprit, et bien, avant que je sois il n'était pas, après que j'aurai été, il ne sera plus, il me faut donc considérer le fait de “quelque chose comme un esprit” qui me constitue dans la continuité, qui est proprement la partie la plus continument “moi”, mais qui dépend de ce corps impermanent et qui cessera quand cessera ce corps en tant que “mon individu” – quand je mourrai. Le fameux machin du tao, vous savez, le taìjítú (maintenant vous devriez connaître le nom), indissociablement yin et yang, du yin dans le yang et du yang dans le yin: on peut déterminer “quelque chose comme un corps” et “quelque chose comme un esprit”, ils sont indissociables, il y a “de l'esprit dans le corps” et il y a “du corps dans l'esprit“. La société c'est pareil: elle a un corps, son espace et tout ce qui participe d'elle, vivant ou non vivant, et un esprit, le réseau matériel et informationnel qui permet sa coordination. Son “esprit” a besoin d'un support matériel pour fonctionner, son “corps” a besoin d'un réseau immatériel pour se coordonner.
Factuellement, une société est toujours et partout à la fois corps et esprit. Donc, quelle que soit la société considérée elle comporte nécessairement un “réseau de régulation sociale” et nécessairement il est continu, sinon elle meurt. Comme un individu, comme Ma Pomme, son corps peut changer du tout au tout, et de fait change du tout au tout pour ce qui en forme l'élément principal, qui en fait une société humaine, les humains, tous les siècles environ une société a complètement renouvelé son stock d'humains, donc n'a plus le même corps, et pourtant c'est la même. Il m'arrive de dire que la société dans laquelle je vis le plus souvent, la société française, a changé trois ou quatre fois depuis ma naissance, que je ne vis plus dans la même société, ce qui est vrai sous un aspect, faux sous un autre, sa “continuité spirituelle”: je suis l'héritier des générations passées qui contribuèrent à en faire ce qu'elle est cette année 2019, contrairement à certains je situe son début alentour de 1429, à un demi-siècle près par excès ou par défaut, tout en considérant aussi ce que l'on peut nommer la “proto-France”, en gros du début du IX° siècle au premier tiers du XV° siècle; avant, c'est la restructuration des espaces territoriaux de ce qui devint l'Empire romain d'occident durant les derniers siècles avant et les premiers siècles après le début de l'ère commune, donc y chercher une “pré-France” me semble un non sens, sinon ceci: en inventant “la Gaule”, les Romains du premier siècle avant l'ère commune ont semé les germes de l'invention d'un territoire “la France”. À un niveau, il n'y a qu'un être, la biosphère, mais un être fractal, chaque entité vivante autonome est à elle-même un monde, une biosphère, mais en interaction et en interdépendance avec toutes les autres entités vivantes. À un autre niveau, celui contingent qui concerne chacun d'entre nous, être finis et fugaces, et bien nous avons des liens distants à la plus grande partie de la biosphère et des liens forts à une partie assez restreinte de celle-ci, plus ou moins restreinte mais assez limitée dans tous les cas. D'une certaine manière, un vieux projet de l'humanité est de former un seul être, mais ce projet s'incarne dans chaque civilisation, chaque culture, chaque nation, chaque État, chaque société, chaque groupe et finalement, dans chaque individu. Conspirer revient à tenter de concilier tous ces projets, comploter, à tenter, à l'un de ces niveaux ou à tous, d'imposer son propre projet à toute l'humanité. Sentimentalement, conspirer me semble préférable, mieux, plus moral, plus honorable, plus “humain”; objectivement et subjectivement je pense de même que Qohelet, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, la question étant alors de bien répartir son temps, ses temps. Par exemple, la musique: si l'on oublie d'y ménager un temps pour le silence ça devient du bruit. Mais si on n'y ménage pas un temps pour le son ça cesse d'être de la musique. Le monde, l'univers sont musique; on peut tenter de saturer son environnement de son qu'on n'y parviendra pas, car le son est perceptible par contraste; on peut tenter de faire cesser tout son qu'on n'y arrivera pas car vivre est un contraste, une petite différence de mouvement avec les reste de l'univers, donc vivre requiert une “dissonance” donc un son, voir l'expérience de John Cage relatée dans l'article 4'3". J'avais pensé citer les “monochromes” pour illustration de l'impossibilité de l'insensibilité pour un être vivant tant qu'il le reste, mais l'article en question en parle aussi. Si je puis me permettre, la partie «Interprétations», sinon peut-être les parties factuelles rendant compte des interprétations de l'œuvre (son exécution publique ou en studio), est dispensable, les interprétations de type commentaires ne valent que pour ce qu'elles sont, du bruit.
L'univers est une onde, ou un truc du genre. Disons, l'univers est perceptible en termes de contrastes. Je vais vous redire ma rengaine, je ne développerai pas ce sujet ici car je l'ai largement fait par ailleurs, un individu est pour lui-même un objet fermé et factuellement un objet globalement fermé, ses contacts avec le reste de l'univers sont indirects et aussi limités que possible, le principe général pour réguler ses relations au reste de l'univers est de placer des récepteurs de sensations sur la surface intérieure d'une membrane, et d'observer des contrastes donnant des informations sur “le mouvement de l'univers”, celui très proche, la partie de l'univers en contact avec la surface extérieure de cette membrane. Cette méthode a comme résultat de faire percevoir ces contacts comme discontinus, une alternance de sensations et de non sensations. L'onde est une hypothèse, on supposera que, par exemple, un son est produit par une onde se déplaçant d'est en ouest selon un mouvement sinueux sur un axe nord-sud ou haut-bas ou autre variation perpendiculaire à l'axe de progression du son. Hypothèse non confirmée par des expérimentations probantes constatant un mouvement erratique, une propagation “brownienne” de ce qui provoque la sensation sonore; l'impulsion initiale est forte, le milieu de propagation très diffus, donc les mouvements sont modérément erratiques et presque linéaires, mais ce qui se déplace n'est pas une onde, ce sont des corpuscules, les atomes et molécules qui se baladent dans le milieu très diffus que constitue l'atmosphère. Ceci n'est pas une valeur constante mais les variations de densité de l'air à altitude modérée, quelques centaines de mètres, sont faibles, de même pour l'eau liquide à profondeur modérée, en tout cas (repris de l'article de Wikipédia sur la masse volumique de l'air), la masse volumique de l'air au niveau de la mer est d'environ 1,225 kg/m3 à 15 °C, celle de l'eau d'environ 998 kg/m3 à 20 °C. Même le plus dense des gaz ne dépasse guère les cinq kilos au mètre cube, soit une densité plus de cent cinquante fois inférieure à celle de l'eau. L'air au niveau de la mer est environ huit cent fois moins dense que l'eau. Un milieu très diffus, très peu dense, peuplé de corpuscules très volumineux, d'où une certaine linéarité des mouvements induits par les les sources de sons. Ce qui provoque la sensation sonore n'est donc pas une onde mais la percussion d'atomes et de molécules contre la membrane que constitue notre peau, avec cette zone spécialisée que constitue l'oreille, qui est sensible à des percussions de faible niveau – pour sentir un son via les autres parties de notre membrane, pour l'essentiel celle qu'on nomme la peau, le source du son doit être très puissante, sauf pour celle en contact avec le sol, si la source du son est aussi en contact avec lui, dans ces cas le son est ressenti comme un souffle, est un “souffle”, un mouvement massif de l'air, assimilable à du vent, dans la direction opposée à la source du son. Ou alors le contraire: un son est une sorte de vent mais à un niveau de déplacement très faible il est presque insensible, sauf si on dispose d'un senseur spécialisé, une oreille par exemple, construite de telle manière qu'elle amplifie considérablement les sensations faible et atténue celles fortes, dans certaines limites. Les personnes sourdes ou troublant d'acouphènes suite à une exposition de sons diffusés par des hauts-parleurs très puissants à faible distance le savent, que l'atténuation du signal a ses limites...
Je ne sais pas si l'univers est une onde, par contre je sais que tout ce qu'on peut percevoir de lui, directement ou par le biais d'instruments sensibles, est analysable comme une onde. Produire une onde requiert une dépense d'énergie. Un être vivant dispose d'un stock limité d'énergie propre, celle que son corps représente. Pour rester en vie il doit, disons, onduler, dépenser de l'énergie qui maintiendra son mouvement propre, légèrement différent de celui de l'univers proche. D'où la nécessité de prélever de l'énergie ou des réserves d'énergie dans son environnement proche, pour réduire sa dépense propre ou pour renouveler ou augmenter son stock disponible. La méthode sensible est la moins coûteuse en énergie propre mais ne génère pas un mouvement très important. Un auteur de science-fiction, John Varley, a imaginé un système pour obtenir un mouvement propre assez important par un système sensible, la symbiose entre un végétal et un animal (en ce cas, un tournesol et un humain), le végétal déploie une sorte de parasol très fin et très large qui recueille une quantité appréciable d'énergie photonique, et l'animal l'utilise pour sa subsistance et pour leurs déplacements. Bien sûr, pour que ça fonctionne le parasol doit être TRÈS large, raison pourquoi ses symbiotes vivent dans l'espace, en orbite autour de Saturne, comme ça ils ne gênent pas les voisins et ne sont pas non plus limités par l'énergie requise pour simplement lutter contre la gravité quand on est en surface d'une planète solide. Sur la Terre, le niveau requis d'énergie pour maintenir en vie un animal, entre autres un humain, et maintenir son autonomie de déplacement est assez important, dans son cas la solution de captation sensible de l'énergie est insuffisante, très insuffisante, donc il doit faire autrement, par exemple en mangeant les voisins.
Vivre nécessite de faire des compromis entre l'autonomie et la persistance. Je ne sais pas s'il y a un “sens de la vie”, une téléologie profonde, une Cause Première et une Fin Dernière, mais je sais ceci: par circonstance ou par choix, vraisemblablement hypothèse par circonstance et par choix en proportions variables, les être vivants évoluent. Les hypothèses sur les Causes Premières et les Fins Dernières ont leur intérêt, en tout premier ce sont des moteurs puissants pour inciter à mieux connaître et comprendre l'univers et en retour mieux se connaître et se comprendre. Mais elles peuvent aussi conduire à “perdre le contact avec la réalité”. Entre guillemets parce que tant qu'on est vivant on ne perd pas ce contact, c'est plutôt une manière d'exprimer le fait que ce que l'on suppose savoir de la réalité est de l'ordre de la croyance, toujours, donc si on suppose que ce que l'on comprend de l'univers et de nous vaut depuis toujours et pour toujours, est la réalité réelle et immuable, on risque d'agir non selon ce qu'on perçoit mais selon ce qu'on croit. On voit par exemple en ce moment une opposition forte entre, peut-on dire, les “aveugles”, les “borgnes” et les “voyants”: pour les premiers, la seule réalité est celle symbolique ou discursive, pour les seconds, la seule effective ou observable, pour les derniers la réalité symbolique est un guide pour se diriger aussi bien que possible dans la réalité effective mais il faut savoir reconsidérer la réalité symbolique quand elle diverge trop de celle effective. Factuellement, tous les êtres vivants sont des voyants puisqu'ils vivent, je reprends toujours un peu les mêmes exemples parce qu'ils sont d'immédiate compréhension, si du moins on n'est pas un aveugle – un aveugle volontaire –, ici c'est celui de l'incompatibilité fondamentale entre la croyance à la Terre plate au centre de l'Univers et l'utilisation du GPS: celui-ci n'est réalisable que si Einstein et Newton ont raison, et s'ils ont raison, alors la Terre est une sphère qui tourne sur elle-même en vingt-quatre heures et autour du Soleil en 365 jours, à quelque chose près, nous adhérons à la Terre parce qu'il y a une force d'attraction et non parce que le ciel pèse sur nous ou par l'Opération du Saint-Esprit ou du Petit Lutin Vert, la Voie Lactée est composée d'astres très distants et l'univers excède de beaucoup les limites du système solaire. Je répète aussi assez souvent ceci: il n'importe pas d'avoir une conception de l'univers aussi proche de ce qu'on en peut savoir de manière objective, par observation et par calcul, on peut même en avoir une conception très erronée, dans mes déplacements ordinaires j'agis en considérant mon environnement comme plutôt plat et je dis et pense comme tout le monde que le Soleil et la Lune se lèvent et se couchent, c'est très suffisant pour le quotidien, mais dès que je m'inscris dans un ensemble plus vaste que ma seule personne ou mon voisinage proche, les gens de ma commune ou de mon canton, il me faut considérer la réalité autrement.
Dans un monde où les sociétés ne dépasseraient pas les limites d'un territoire de la dimension d'un canton et auraient des contacts limités avec les autres sociétés, leurs membres auraient nécessairement un “impact écologique” limité. Ce qui ne garantit pas des catastrophes, j'entendais sur ma radio une personne parler de la “catastrophe écologique” du Sahara il y a quelques trois millénaires dans l'épisode du jour de La Fabrique de l'Histoire. Elle disait que selon toute vraisemblance cette catastrophe était inévitable, cette zone était semi-aride et ne correspondait pas à l'imaginaire actuel du “Sahara vert”, c'était un biotope fragile et à la merci d'un changement faible des conditions: un peu plus de chaleur, un peu moins d'humidité, et l'équilibre local – qui de toute manière est toujours précaire dans un écosystème – se rompait rapidement et profondément. Les humains contribuèrent certes assez à accélérer et augmenter cette rupture mais n'en furent pas la cause première et principale, cette cause première est multiple et indépendante de leur action, en premier le changement climatique: les êtres vivants sont attachés à leur écosystème comme les moules sur leurs rochers, aussi vaste serait-il, quand les conditions changent, et bien, elles changent pour tous et partout et ils faut s'adapter ou mourir, à tout le moins dépérir. Dans un monde où les sociétés sont étendues mais de manière encore assez limitée, et le niveau technologique assez bas, les sociétés auront certes un impact plus important sur leur écosystème, pour le meilleur comme pour le pire, et quand les conditions changent y seront plus sensibles, j'ai beau dire que l'Empire romain d'occident ne s'est pas effondré, il connut une rupture des conditions suffisante pour le déstructurer et laisser la place à une autre société, qui lui doit beaucoup et a repris une part importante de sa superstructure et une moindre part mais non négligeable de son infrastructure, mais qui mit plusieurs siècles pour reconstituer une société comparable à celle qui s'établit au tournant du début de l'ère commune. Question de contexte: les sociétés sont assez résilientes mais il y a des limites, quand il n'y a plus rien, et bien, on ne reconstruit rien. Le Sahara ne devint pas un espace vidé de toute humanité mais celle qui continua d'y vivre ne pouvait plus “faire société” localement, sinon comme le font encore les très petites sociétés de chasseurs-cueilleurs du Kalahari, pour vivre une vie plus élaborée elles doit se relier à des sociétés périphériques. Mais je ne crois pas que des sociétés de chasseurs-cueilleurs soient possibles dans le Sahara, il est trop aride...
Depuis, et bien, depuis un certain temps, en tout cas de manière avérée depuis le XVI° siècle, un mouvement s'est enclenché pour peu à peu fédérer toute l'humanité dans une seule société, dans un seul écosystème à la dimension de la biosphère. Sous un certain aspect c'est le cas depuis toujours, depuis les débuts de l'humanité, de manière certaine depuis que la branche dominante puis hégémonique et enfin exclusive des espèces humaines, l'humain moderne, Homo sapiens, s'est répandu sur l'ensemble du globe sinon, jusqu'à il y a quelques siècles, l'Antarctique. Les humains ont cette particularité d'avoir cessé de se spécier il y a quelques temps, alentour de trois ou quatre cent millénaires de manière certaine, probablement avant: un humain reconnaît un humain autrement que par la forme, la couleur, l'odeur, le chant ou quelque critère anatomique ou physiologique, il le reconnaît tel dès lors qu'ils peuvent s'asseoir l'un en face de l'autre, partager un godet et discuter du temps qu'il fait ou des choses qui ne sont plus ce qu'elles étaient comme au Bon Vieux Temps.Des fois la discussion n'est pas si facile, alors on fait des gestes, on se sourit, et si vraiment c'est compliqué on s'assied l'un à côté de l'autre et on contemple le spectacle superbe d'un coucher de soleil en riant ou en pleurant ensemble devant tant de beauté. Notre commune humanité. Cela dit, les choses ne sont pas si simple ni la vie un long fleuve tranquille, autant tout humain peut reconnaître humain un parfait étranger, autant il peut ne plus reconnaître un humain en sa sœur ou son frère, en ses parents ou ses enfants. Je ne sais pas comment, après les serments, ce jour de 842 à Strasbourg, Charles et Louis ont causé de Lothaire, le soir, autour d'un godet, mais à mon avis ils ont du le traiter de chien ou de rat, ou de vipère lubrique. Moins qu'un frère honni, moins qu'un inconnu, moins qu'un étranger, un être hors de l'humanité. Étaient-ils les gardiens de leur frère? Oui. Et pourtant, ils ont décidé de ne plus le voir comme un frère, décidé de le rejeter de l'humanité, décidé de le tuer, ou de le bannir à jamais.
Avant de poursuivre sur la société universelle (un petit univers, cependant, juste la biosphère et le boulevard périphérique des orbites géostationnaires), une exploration aussi brève que je le pourrai du jeu des chats, des chiens, des souris, des rats, de l'Arbitre et de l'Autre. On dira que l'Arbitre c'est Dieu ou la Cause Première ou la Justice Immanente mais dans le cadre du jeu c'est celui qui fixe les règles, qui veille à leur respect, qui sanctionne en bien ou en mal, et aussi, c'est lui qui tient la banque. Le jeu lui appartient, l'espace de jeu lui appartient, les instruments du jeu lui appartiennent, et bien sûr, les joueurs lui appartiennent. C'est le Gros Propriétaire, vous savez, comme pour le jubilé, «Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants». Soit dit en passant, avec un proprio de ce genre vaut mieux être un étranger qu'un habitant, si ça tourne au vinaigre on a l'opportunité de rentrer à la maison. Dans le jeu de la vie, il n'y a qu'un proprio et qu'un pays, donc le jour où on se fait dire «Rentre chez toi, l'étranger!» on est dans la mouise, vu que “chez soi” on y est déjà... Les chats, les chiens, les souris et les rats ce sont les noms des équipes. Au tout début d'une partie les joueurs sont répartis par tirage au sort, et à chaque nouvelle manche on est censé refaire un tirage au sort. Au cours d'une manche les joueurs peuvent ou doivent, selon les cas, changer d'équipe, ce qui n'est pas sans risques. L'Autre, et bien c'est l'Autre, il a tous les aspects d'un joueur, ou d'un Arbitre, mais rien n'est sûr. Il a aussi son équipe, ou non, car avec lui rien n'est sûr. Personne ne l'aime mais tout le monde le respecte et l'admire, ou prétend le respecter et l'admirer, et même, certains prétendent l'aimer, parce qu'avec l'Autre on ne sait jamais, faut rester prudent car rien n'est sûr. Il arrive parfois que l'une des équipes, ou plusieurs, ou toutes, décident de faire sortir l'Autre du jeu, mais ça ne sert pas à grand chose sinon à risquer une sanction en mal, ou parfois mais plus rarement en bien, parce qu'il y a pas mal de chances – de risques? – de le voir revenir dans la partie un peu plus tard. Censément, l'Arbitre est là pour assurer la bonne marche du jeu mais à la fin de la première manche il se retire. Ou non. Avec lui aussi rien n'est sûr. Disons, il est là sans être là, ou il n'est pas là tout en y étant. En tout cas, à la fin de la première manche il dit, je me retire, c'est à vous de vous débrouiller pour les règles, leur respect, les sanctions, la banque et le reste. D'accord d'accord, chère lectrice, cher lecteur, vous avez compris le truc, vous êtes très maligne ou malin, il est lourd celui-là avec son Jeu de la Vie vous dites-vous, et vous aurez raison. Ou alors vous n'avez pas encore compris le truc, et soit je suis un imbécile pour ne pas me faire deviner, soit vous manquez de culture et de jugement. Remarquez, il y a tout de même un élément qui pourrait rester intrigant: pourquoi les chats, les chiens, les souris et les rats? Ça vous intrigue, ou non, et vous souhaitez savoir ce que j'ai à en dire? Je vous invite à poursuivre la lecture de l'alinéa suivant. Que ça vous intrigue ou non vous ne voulez pas savoir? Passez à la partie suivante. Vous ne savez pas ce que vous voulez? Je n'y peux pas grand chose. Vous ne savez pas ce que je veux? Moi non plus. Quant à moi, je poursuis cette discussion. Tout d'abord je publie ce billet puis je poursuis. Si par chance vous tombez sur ce passage avant que je publie de nouveau, ça vous donnera l'opportunité de la poursuivre par vous-même, ce qui me semble une excellente chose. Rien de ce que j'écrirai ne vaudra jamais ce que vous penserez.



