Le Collectif Enfance 31 a été créé en 2016 : il regroupe des travailleurs sociaux, des magistrats et a le soutien de certains syndicats. Il organisait à Toulouse, le 29 novembre à l’occasion du 30ème anniversaire de l’adoption à l’ONU de la Convention des droits de l’enfant, son deuxième forum. Une table ronde portait sur la remise en cause des droits, qui ne sont plus inconditionnels. Ainsi s’instaurent des logiques de tri et de hiérarchisation des familles, ce qui remet en cause les droits des enfants.

Agrandissement : Illustration 1

Christophe Daadouch, juriste, auteur de plusieurs ouvrages, est présenté comme « un acteur qui s’engage ». Il tient à préciser que, depuis vingt ans qu’il travaille auprès des travailleurs sociaux sur les droits de l’enfant, il relève tout de même des progrès : « on ne peut pas être toujours morose ». Par contre, il constate que la protection de l’enfance est confrontée à un grave problème : celui de « la judiciarisation des pratiques professionnelles ». On plonge dans « les normes Afnor » de l’intervention éducative et sociale. Cela assurera de beaux jours en perspective pour les juristes, mais ira à l’encontre des innovations.
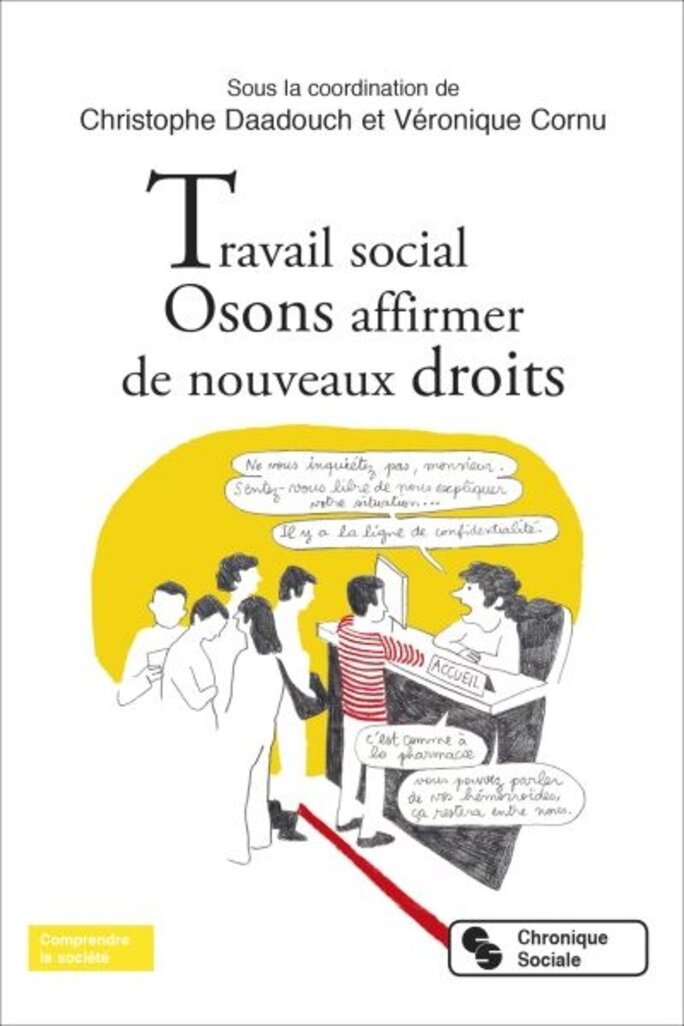
Agrandissement : Illustration 2
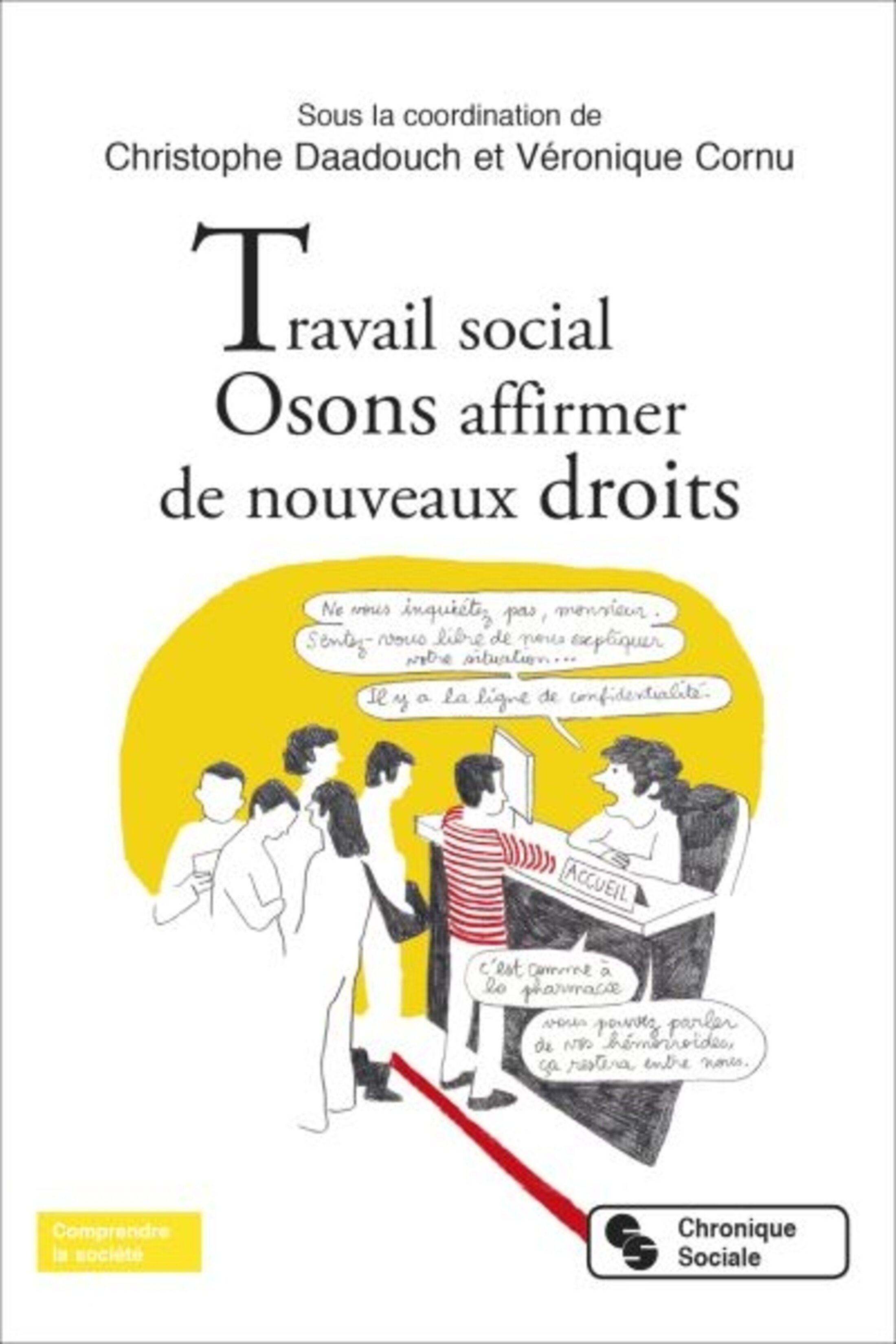
Un soir, avec des travailleurs sociaux de la Dased de Paris qui en avaient ras le bol, il a lancé l’idée de repérer des droits nouveaux qui n’ont jamais été accordés. Ce qui a donné un livre un peu décousu, avec « du travail social au second degré », qu’il a coordonné avec Véronique Cornu : Osons affirmer de nouveaux droits (éditions Chronique sociale). L’objectif était de karchériser la novlangue du style : « l’usager doit avoir un projet », « le parcours ». Il déconseille la lecture de ce livre aux futurs travailleurs sociaux, car ils n’écouteront plus les formateurs. Le droit (pour l’usager) de ne rien dire de son père, d’avoir un entretien qui dure plus de 20 minutes, d’avoir un référent qui ne soit pas celui qu’on lui impose, le droit de mentir au travailleur social. La liste recense aussi des droits qui ne sont pas nouveaux mais qui ne sont pas respectés. L’ouvrage publie aussi un lexique : résilience, ou faire une nouvelle demande après un refus la semaine précédente ; placement à domicile, ou retour à l’envoyeur, etc.
Puis Marie témoigne : confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) à 10 ans, elle a connu un parcours compliqué, avec changement de famille d’accueil tous les deux ans, et d’établissement scolaire. Suite à un rapport d’une assistante sociale, un jour « les gendarmes et une dame habillée en tailleur et talons ont débarqué au domicile, pour nous confier, mes frères et sœurs, à l’ASE ». Ses parents n’étaient pas violents, pense-t-elle, mais sa mère était malade. Elle a connu d’abord un foyer d’urgence : lieu étrange, dit-elle, où l’on est entouré d’un grand nombre de personnes. Le couple de la première famille d’accueil, au bout d’un an, a pris sa retraite (elle pense plutôt qu’ils s’étaient trop attachés à elle et que c’est la raison du changement). La deuxième famille, l’homme était pervers : elle s’est plainte mais on ne l’a pas vraiment crue (« c’était parole contre parole »). Dans la troisième famille d’accueil, elle a pu retrouver ses petites sœurs mais le couple n’était pas à l’aise avec une adolescente, il refusait qu’elle aille en vacances chez une tante car il perdait sa rémunération. Alors elle s’est retrouvée en foyer, où cela s’est très bien passé, avec de « bons éducateurs ». Elle regrette cependant de n’avoir pas été bien accompagnée à 19 ans. Elle voulait aider sa mère malade, elle s’est occupée de son hospitalisation, mais n’était pas armée pour vivre seule (pour toute l’intendance). Elle a perçu l’aide aux jeunes majeurs (AJM) après un certain délai et a dû de ce fait subsister quelques mois avec ses économies d’argent de poche ! Elle ne reproche pas aux travailleurs sociaux d’avoir un jargon particulier : elle comprenait très bien ce qu’ils voulaient dire, mais « quand j’étais dans un bureau c’était un peu comme dans un commissariat : j’étais mal à l’aise ».
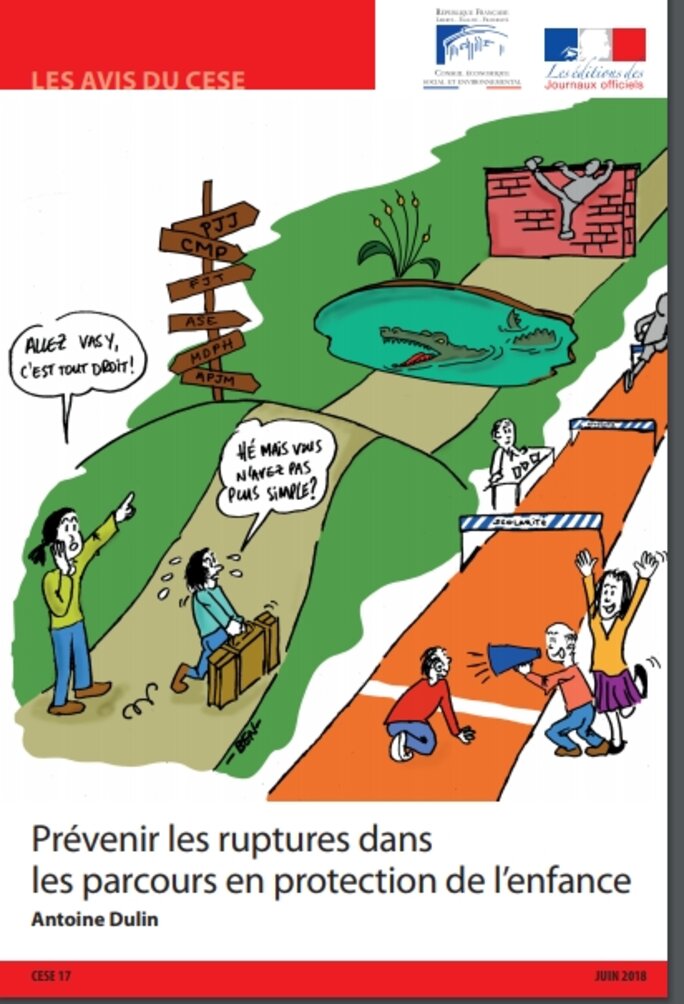
Agrandissement : Illustration 3
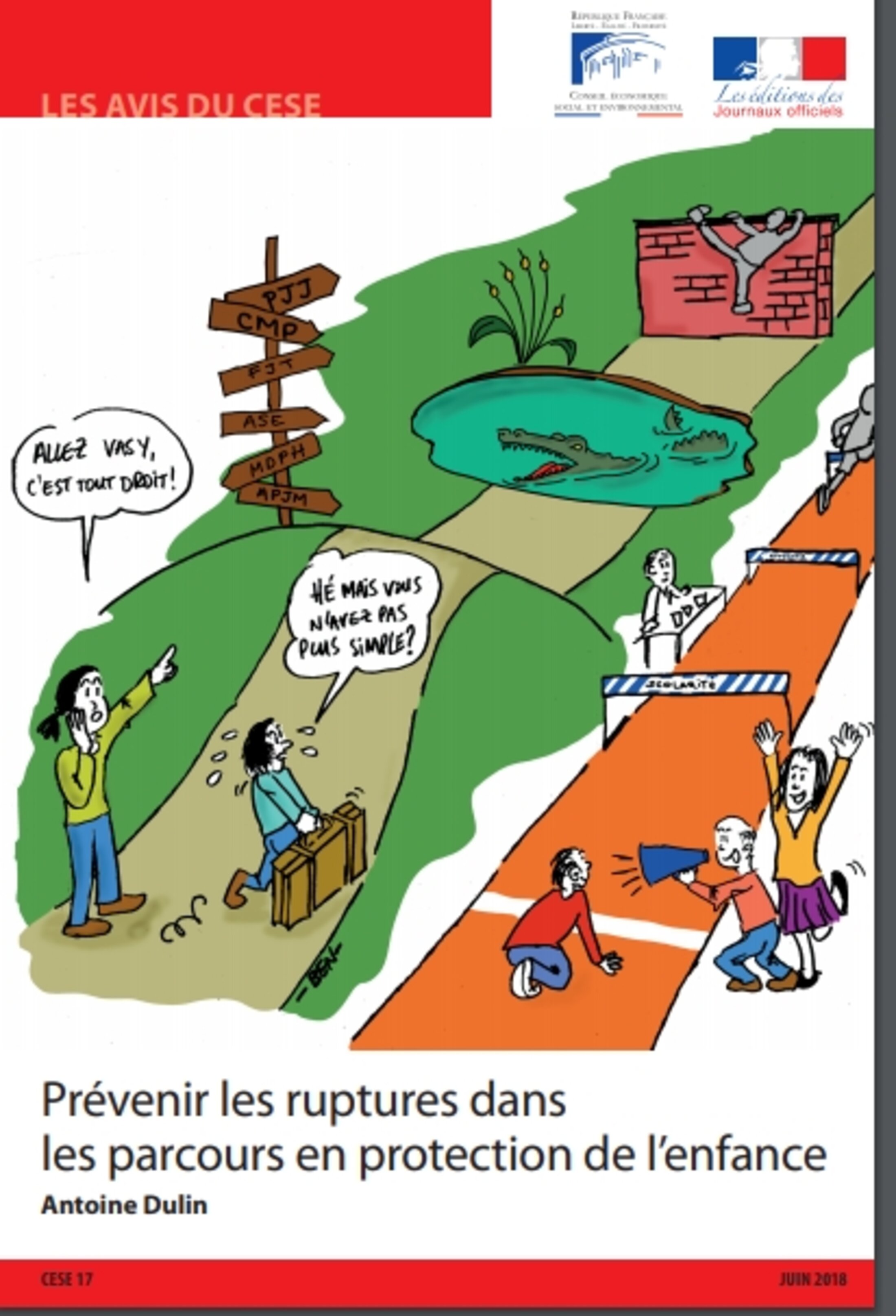
Quand, ayant quitté l’ASE, elle a voulu reprendre des études, c’est l’Adepape, l’association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance, qui l’a aidée. Suite à ce récit, Christophe Daadouch liste les violations des règles de droits : liens avec famille d’accueil, avec fratrie, avec tante. Il rappelle que la loi de 2007 prévoit que le juge des enfants doit être informé si un enfant est changé de famille d’accueil alors qu’il est placé depuis plus de deux ans dans la même famille (plusieurs témoignages, dont celui de Lyes Louffok, ont mis en évidence que des enfants placés sont ballotés d’une famille d’accueil à l’autre). Enfin, l’aide aux jeunes majeurs n’est pas forcément ou seulement une aide financière mais un appui. Il cite le rapport Antoine Dulin (Prévenir les ruptures dans les parcours de protection de l’enfance, juin 2018) qui parle de « désastre économique », à propos de ce non-accompagnement après 18 ans. On dépense pendant des années des sommes importantes pour sortir d’affaire un enfant, et soudain on le largue à 18 ans, sabotant ainsi cet « investissement ». La paupérisation actuelle des jeunes majeurs est sans précédent dans l’histoire de la protection de l’enfance.
Julie, avocate pour enfants et jeunes majeurs, se plaint de l’attitude de travailleurs sociaux qui, lorsqu’elle les contacte, refusent de lui parler sous prétexte du secret professionnel alors qu’elle y est tenue elle aussi. Elle regrette que beaucoup d’enfants placés ne soient pas toujours assistés d’un avocat. Du coup c’est l’ASE qui est le porte-voix de l’enfant alors que ce service départemental est objet de la procédure, donc « juge et partie ». Si l’avocat est obligatoire au pénal, il ne l’est pas au civil, en assistance éducative. Une association regroupe ces avocats spécialisés qui sont au nombre de 80 sur Toulouse : elle tient une permanence de conseils juridiques gratuite.
Christophe Daadouch, qui assure par ailleurs des formations pour avocats et travailleurs sociaux, tout en regrettant que l’avocat pour enfant ne soit pas toujours là, se fait l’écho de griefs de travailleurs sociaux reprochant à des avocats de ne pas respecter leurs obligations envers des enfants qu’ils sont censés défendre. Dans un livre écrit avec Pierre Verdier, il a défendu l’idée d’un avocat obligatoire dans le cadre de l’assistance éducative, alors qu’il l’est dans les cas de divorce sans conflit. Il rappelle que les travailleurs sociaux ont aussi un secret professionnel à respecter. Julie en convient mais estime qu’il devrait y avoir au moins la possibilité de se parler. Il est arrivé qu’elle découvre au cours d’une audience qu’un enfant a été placé quatre fois sans qu’elle en connaisse les raisons. Au pénal, les éducateurs PJJ lui communiquent leurs rapports. Amel, travailleuse sociale à l’ASE, confirme que dès qu’un avocat est présent dans une situation, cela inquiète les travailleurs sociaux.
Colette, défenseur des droits, intervenant ici comme administratrice ad hoc, témoigne de la situation d’un jeune MNA (mineur non accompagné, étranger isolé donc) qui a bénéficié d’un camp d’équitation pendant trois semaines pris en charge par l’ASE, qui, dès son retour du camp, l’a exclu le jour anniversaire de ses 18 ans (alors même qu’il n’y avait aucun doute sur son âge réel). Il s’est retrouvé dans un Foyer pour adultes dans des conditions terribles pour lui, alors qu’il avait été jusqu’alors surprotégé.
Jocelyn, avocat et ancien enfant placé, confie qu’il a eu longtemps honte d’avoir été placé et ne parvient à en parler que depuis la naissance de son premier enfant. Ayant vécu dans une famille de dix enfants dans un bidonville au Cameroun, il considère que l’ASE l’a sauvé (tout en précisant qu’elle l’a laissé tomber à 18 ans). Il venait en France pour faire du foot mais a été abandonné dans la rue et recueilli dans un foyer d’urgence. Installé dans un appartement comme « mineur de confiance », il a subi l’humiliation des tests osseux mais a été reconnu mineur. Le juge des enfants le recevait chaque année et prolongeait sa prise en charge. Un éducateur le taxait de « clando » alors qu’il était mineur. Une éducatrice l’a orienté sur une formation de mécanicien car, selon elle, « c’était la filière pour rester en France ». Pendant son année de Bac Pro, il a subi une obligation à quitter le territoire (OQTF). Il éprouvait une certaine honte à retourner ainsi auprès de sa famille au Cameroun sans rien, sans formation. Ayant pu rester en France grâce à la défense assurée par une avocate, il a du coup voulu faire ce métier. Il travaillait 35 h par semaine comme pompiste tout en suivant ses études de droit (en 2ème année, il ne pouvait être présent qu’au TD) : il fallait vivre mais aussi envoyer de l’argent à la famille. Il note à ce propos que les délinquants aident davantage leur famille car ils peuvent envoyer beaucoup plus d’argent. Grâce « au travail, aux études et… à l’amour », il a obtenu son doctorat. Comme tout ancien enfant de l’ASE, trouver un stage était difficile : alors il a appelé l’avocate qui, dix ans plus tôt, l’avait défendue. Elle croyait qu’il était en garde-à-vue et qu’il avait besoin d’être défendu, avant qu’il ne précise l’objet de son appel : obtenir un stage dans son cabinet. Il ne se considère pas comme un miraculé : des gens l’ont aidé, comme l’Adepape et le Secours Populaire. Il explique combien c’est difficile pour un jeune arrivant ainsi d’Afrique : « on est entouré de Blancs, on n’a pas les codes, on nous impose une filière qui ne nous plaît pas ».
Christophe Daadouch condamne le propos consistant à traiter de « clando » un mineur isolé : c’est contraire à l’éthique et faux. Il considère que mettre des mineurs isolés étrangers à l’hôtel et ne pas leur faire bénéficier d’une famille d’accueil est discriminatoire, et c’est le cas de nombreux jeunes.
Mathieu témoigne : sa sœur présente de graves problèmes psychotiques. Il y a quatre ans, son bébé a été retiré dès la naissance. Mathieu et sa mère ont recueilli cet enfant mais le juge ne les a reçus qu’au bout de six mois. Il a l’impression d’une « loterie » : « pour avoir des informations claires, et connaître l’accès au droit, c’est très hasardeux ». Les prises de position des professionnels sont teintées d’opinions personnelles, exprimées « dans un flou total », parsemées de « contradictions » : « il est difficile de naviguer de l’un à l’autre, d’une institution à l’autre », en somme « une grande confusion ». Il arrive cependant qu’on ait un interlocuteur qui tienne la route (et de citer une travailleuse sociale présente à la tribune).
Lorsque sa sœur a eu un deuxième enfant, celui-ci a été retiré et la famille n’en a rien su. Finalement, on lui a dit qu’en tant qu’oncle cela ne le regardait pas et qu’il n’avait pas à écrire au juge. Il a fallu qu’un ami, travaillant dans une Maison Départementale de la Solidarité, lui explique la marche à suivre. Désormais, lui et sa mère sont reçus par le juge régulièrement mais on leur oppose toujours le droit parental, alors que la mère a des problèmes psychiques lourds et est capable de maltraitance psychologique. Elle a fait appel depuis des années à une armée d’avocats, pour chaque procédure. Son droit parental lui donne un droit de regard sur de nombreux sujets, qui complique considérablement la prise en charge : médecin, choix de la crèche…

Christophe Daadouch précise que si la saisine directe du juge n’est pas possible, la famille dans une telle situation est en droit d’écrire au juge. Par ailleurs, la loi de 2007 a donné pouvoir au juge des enfants de prendre des décisions (de renouvellement) au-delà de deux ans dans le cas où les parents sont psychiquement gravement malades.
Laurence, psychologue en pédopsychiatrie, confirme que si le parent perturbe l’enfant, les rencontres peuvent être suspendues. Elle tient « à redonner des lettres de noblesse à tous ces gens qui travaillent à l’ASE ». Les conditions sont telles que des professionnelles, en Haute-Garonne, ont invoqué leur droit de retrait. Elle précise qu’un enfant peut mythifier sa mère, c’est son droit, mais la réalité peut être bien différente. Si la perception de l’enfant est respectable, il n’empêche que la réalité peut conduire le travailleur social à conclure différemment. A Mathieu, elle dit que sa sœur a raison de demander à récupérer son enfant, mais en face il doit y avoir une autorité capable de dire ce qu’est l’intérêt de l’enfant et de s’opposer à sa demande. Ainsi les professionnels sont sans cesse confrontés à des situations paradoxales.
Christophe Daadouch rappelle que pendant un temps, on éliminait les parents : c’était la DDASS. Ce n’est plus le cas depuis 1984, où une loi a précisé que, lors d’un placement judiciaire ou administratif, la durée maximale doit être respectivement de deux ou d’un an (1). Il reconnaît qu’on a eu tendance à surestimer le lien parental. La loi de 2016 a incité à modifier les pratiques : elle fait obligation à se prononcer sur une éventuelle délégation de l’autorité parentale (DAP) compte tenu d’un délaissement parental avéré. Il considère que cela permet un équilibre complexe entre ces deux injonctions, tellement paradoxales.
Colette, déléguée du défenseur des droits de l’enfant (500 à l’échelle nationale, 10 en Haute-Garonne), explique le sens de sa mission. Le défenseur des droits reçoit chaque année 3000 réclamations. Elle-même, bénévole, a une douzaine de dossiers à traiter par mois. Elle fait état des difficultés qu’elle rencontre avec des travailleurs sociaux, les Maisons départementales de la solidarité. Elle déplore que ce soit l’éducateur qui se rend aux réunions au collège à la place des parents. Ou que les MDPH prennent des décisions trop tardives. Ou le projet pour l’enfant qui tarde tant à être établi. Le dernier rapport (20 novembre) du défenseur des droits, Jacques Toubon, et de la déléguée aux droits de l’enfant, Geneviève Avenard, est très sévère envers les institutions : « ils se sont lâchés », pour dénoncer « carences et violences ».
Christophe Daadouch rappelle que Jacques Toubon a surpris tout le monde sur son réel engagement dans sa mission, compte tenu de son parcours antérieur. Lors d’un colloque récent sur la réforme du droit pénal des mineurs, il a littéralement démonté cette réforme de l’ordonnance de 1945, même si cela ne changera rien, car le gouvernement compte la faire passer « au forceps », s’il le faut par ordonnances. Jacques Toubon doit quitter bientôt le poste : Christophe Daadouch suggère que Emmanuel Macron nomme… Christiane Taubira pour lui succéder.
Lors du débat, est abordée la question du secret professionnel : l’existence du site de Laurent Puech est rappelé (www.secretpro.fr). Le président de l’Adepape, qui préside le Conseil de familles, rend hommage à l’important travail accompli par les intervenants sociaux. Le fichage des mineurs isolés est dénoncé, mesure sans précédent dans le domaine de la protection de l’enfance. Une jeune femme qui a été placée en famille d’accueil dès l’âge de six mois (jusqu’à 21 ans) dit qu’elle n’a jamais vu un avocat (le premier qu’elle a rencontré c’était en fac de droit). Elle doute que la parole de l’enfant soit entendu, « ne serait-ce que son ressenti ». Christophe Daadouch regrette qu’on n’ait pas fait de progrès sur ce point, or la loi (art. 388-1 du Code civil) prévoit que le juge (JE ou JAF) doit recevoir l’enfant s’il est capable de discernement et dans tous les cas si le mineur en fait la demande.
La journée s’est poursuivie en abordant la question de la prévention spécialisée, le projet d’États Généraux de la Protection de l’Enfance, qui a tourné court du fait de l’absence de soutien des institutions. Le Conseil Départemental de Haute-Garonne a refusé de s’engager dans une expérimentation de fichier AEM (Appui à l’évaluation de la minorité), non sans hypocrisie, puisqu’il utilise depuis 2016 des fichiers non conformes à la loi. Est évoqué également le mouvement qui a eu lieu dans les Maisons départementales de la solidarité (MDS) de Haute-Garonne (qui en compte 23) pour protester contre le manque de moyens, avec droit d’alerte et de retrait. Une assemblée générale dans une salle prévue pour 100 personnes a rassemblé 600 agents ! Ils protestaient contre la dégradation des conditions de travail, une réorganisation territoriale sans concertation, la surcharge de travail et le nombre de mesures en suivi, le tout entraînant un accroissement des arrêts-maladie et des demandes de mutation. Il manque des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, des éducateurs, des agents de secrétariat, et nombreux postes existants ne sont pas pourvus. Par ailleurs, le manque de places dans les établissements fait qu’il y a retard à la mise en exécution des placements décidés. Enfin, la situation ne peut que se dégrader quand on sait que 40 % des familles d’accueil partent prochainement à la retraite et ne sont pas remplacées.
Lors d’une rencontre avec Nicole Belloubet, ministre de la Justice, des travailleurs sociaux ont constaté qu’elle semblait ne pas connaître grand-chose à la protection de l’enfance, considérant que cela ne la concernait pas, cette mission relevant du département, ce qui l’a conduit à lâcher tout à trac : « que la PJJ s’occupe de ses jeunes, et l’ASE des siens ». Comme si elle ignorait que ce sont parfois les mêmes, et qu’il est toujours préférable que ces services fonctionnent autant que possible en concertation.

Agrandissement : Illustration 5

______
Les mots pour le dire
Après un travail en atelier, l’une des restitutions évoquait la question du vocabulaire : le jargon du secteur (est rappelé le célèbre sketch de Frank Lepage qui parvient à faire des phrases en utilisant de façon aléatoire les mots à la mode dans le social), les sigles incompréhensibles. On ne sait pas comment dire : usager (ou usagé), client (tendance commerciale), patient, bénéficiaire (ce que beaucoup récusent), allocataire, personne accompagnée ou suivie (« qui rattrape l’autre ? »), « concernés ». Christophe Daadouch rappelle que le mot accompagnement signifie étymologiquement « avec qui mange le pain », d’où son commentaire : « l’empathie vient en mangeant » !
Des éducateurs disent parfois « mon jeune », et des jeunes « mon juge ».
Les éducateurs spécialisés sont, en réalité, les seuls qui ne le sont pas : l’éducateur de jeunes enfants l’est lui, spécialisé, l’éducateur PJJ aussi. On parle de contrat jeune majeur, or ce n’est pas juridiquement un contrat, car il n’y a pas d’obligation réciproque.
Une éducatrice témoigne : elle avait dit à une mère qu’elle allait travailler avec elle « en toute humilité », la mère lui rétorqua : « vous êtes là pour m’humilier ? ».
Christophe Daadouch note que l’on dit « mineur délinquant » mais « personne en situation de handicap », « alors que la délinquance durera moins longtemps que le handicap ». « On dit juge des enfants mais Cour d’assises des mineurs ». La formulation juge des mineurs n’a pas été retenu, tant il y aurait eu… à déminer. Mineur étranger isolé a été abandonné au profit de mineur non accompagné, pour ne pas insister sur étranger. Il est relevé également que l’ASE a été déstabilisée par ces mineurs qui demandent à être protéger alors que d’ordinaire la protection est plutôt imposée. Autre paradoxe ou incohérence : ces mineurs ne doivent pas avoir de contact avec leurs parents, alors même que le droit français incite à maintenir un lien, autant que possible, entre un enfant placé et ses parents.
______
(1) A noter que l’introduction de ces règles (sur les droits des parents) sont venus du monde juridique par souci de respect des droits individuels et non pas des professionnels qui ne contestaient pas le fait qu’une mesure de placement puisse être prise pour près de vingt ans, sans jamais que les parents n’aient à s’exprimer sur la poursuite de la prise en charge !
. Le projet de Christophe Daadouch de karchériser la novlangue me fait penser à cet ouvrage ancien de Jean-Marie Geng, Mauvaises pensées d’un travailleur social, éditions du Seuil (1977). Il traitait le travail social avec « une ironie méchante et une joyeuse dérision ». Il n’a jamais eu les honneurs qu’ont eus dans le microcosme Jacques Donzelot (La Police des familles), Jeannine Verdès-Leroux (Le travail social), Claude Liscia (Familles hors la loi) ou Philippe Meyer (L’enfant et la raison d’État), tous livres parus à cette même époque de contestation sévère du travail social accusé d’être un contrôle social des familles. J.M. Geng, qui avait travaillé comme éducateur, puis sociologue, est devenu ensuite écrivain et scénariste sous le nom de Max Genève.
Billet n° 529
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup
[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans le billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, les 200 premiers articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées. Le billet n°400, correspondant aux 10 ans de Mediapart et de mon abonnement, fait le point sur ma démarche d'écriture, en tant que chroniqueur social indépendant, c'est-à-dire en me fondant sur une expérience, des connaissances et en prenant position. Enfin, dans le billet n°500, je m’explique sur ma conception de la confusion des genres, ni chroniqueur, ni militant, mais chroniqueur militant, et dans le billet n°501 je développe une réflexion, à partir de mon parcours, sur l’engagement, ou le lien entre militantisme et professionnalisme]



