Excusez le mot car son usage abusif et intensif ces temps derniers chez les “responsables politiques” français dissuade de l'employer même quand c'est à-peu-près à bon escient. Disons que ce thème, «le réchauffement climatique», est apparu à certains un bon moyen d'inciter les gens à modifier leurs comportements, avec l'idée que ces changements de comportements provoqueraient un changement en profondeur des superstructures et infrastructures d'une part significative des sociétés actuelles. Finalement, le terme “pédagogique” correspond bien au phénomène: le but est de “faire l"éducation” du bon peuple, lui apprendre sa leçon pour qu'il agisse conformément à ce que souhaitent ses “pédagogues” ou “éducateurs”.
Conditionnements et apprentissages.
La vie en société requiert chez les humains un haut niveau de conditionnement. Les espèces sociales le sont le plus souvent d'une manière inconditionnelle, elles le sont d'une manière qu'on peut qualifier d'innée. J'ai quelque distance aux notions d'inné et d'acquis, sous un aspect tout est inné, sous un autre tout est acquis, cependant on peut déterminer certains comportements qui ne requièrent pas d'apprentissage et qui sauf accident ne se perdent pas; en majorité les espèces sociales le sont de cette manière, un termite, une fourmi, une abeille, ont dès leur dernière métamorphose un comportement social, n'ont pas le choix d'agir autrement et on ne peut pas supposer que ces insectes se savent sociaux. Pour les humains et quelques autres rares espèces il en va autrement, leur socialisation résulte d'un long apprentissage à base de conditionnement, ils ne sont pas nativement sociaux, sans un renforcement régulier de ce conditionnement peuvent assez aisément se “désocialiser”, et sans ce conditionnement initiale, ne se socialiseront pas. Dans le cadre d'une société ce renforcement se fait de manière assez automatique, c'est bête à dire mais on apprend à “se comporter” donc quand on rencontre les contextes où on doit avoir un certain type de comportement on s'y conformera, y compris quand on n'y adhère pas car on sait que l'attente sociale le requiert. On le sait par conditionnement, d'abord par conditionnement classique, passif, ensuite par conditionnement opérant, actif – le sujet participe à son propre conditionnement. Dans le conditionnement opérant le sujet fait de l'auto-renforcement, contrairement à celui classique il n'y a pas nécessairement besoin, une fois le réflexe conditionnel établi, de stimulus conditionnel pour obtenir la réponse conditionnelle, comme dans l'exemple du rat dans la “boîte de Skinner” donné dans l'article: une fois qu'il a découvert que l'appui sur un certain levier permet d'obtenir un certain résultat désirable, il va créer son propre conditionnement en répétant de lui-même le geste qui donne ce résultat.
Chez les humains et chez quelques autres espèces existe un troisième type de conditionnement, qu'on peut nommer “conditionnement opératif”: le sujet crée les contextes de son conditionnement. Pour une description plus large et selon moi plus exacte de ces processus, je vous conseille la lecture de l'article de Gregory Bateson «Les catégories de l'apprentissage et de la communication»: dans son approche, les “apprentissages de niveau zéro” et une partie des “apprentissages de niveau I” ressortent du conditionnement classique, l'autre partie de ce niveau I et une partie du niveau II sont de type opérant, le reste du niveau II et (en l'état actuel du savoir) les “apprentissages de niveau III” sont opératifs.
Censément, dans des sociétés d'orientation démocratique on privilégie l'élaboration de conditionnements opératifs, effectivement ça n'est pas si simple: en tant que tout une société comporte un vaste ensemble de processus inconditionnels, donc demande des réponses conditionnelles classiques ou opérantes. Ce qui structure une société est la répétition inconditionnelle de vastes processus, ce que je décris comme la “confiance aveugle”: j'accomplis une certaine tâche dans un contexte “de travail” dont la fin est très distante ou/et très différée et ne dépend pas de moi, il me faut donc “croire aveuglément” que cette tâche n'est pas réalisée en vain, je l'accomplis parce que j'ai été conditionné pour la réaliser et pour lui “donner du sens”, de la valeur, mais je n'ai aucun moyen de déterminer son utilité sociale réelle, d'où la nécessité d'une confiance aveugle en la société et en le jeu social, en un double sens: le jeu que joue chaque membre de la société en tant qu'agent social – le fameux exemple que donne Jean-Paul Sartre du garçon de café qui “joue un rôle” et joue un jeu, «le jeu du garçon de café», on peut nommer ça la comédie sociale –, et le sens que le mot “jeu” a quand il concerne l'interaction entre diverses structures et différents processus, «aisance dans le fonctionnement d'une chose ou de plusieurs choses entre elles».
Les sociétés sont des systèmes, précisément des écosystèmes ou biosystèmes, plus précisément encore des systèmes autocorrecteurs. De tels systèmes “tendent vers un état optimal” sans jamais y atteindre. Pour tendre vers cet état ils disposent de régulateurs qui vont accélérer ou ralentir telles parties ou l'ensemble du système dès qu'ils s'écartent trop de cet état optimal. Mais ça ne fonctionne pas toujours, parfois le système s'emballe sans qu'on puisse le ralentir, parfois il se ralentit sans qu'on puisse le relancer, il s'écarte de l'état optimal par excès ou insuffisance sans que les régulations agissent. Les causes de ces dérèglements sont diverses, la raison toujours la même: une inadaptation entre les formes de régulation et l'état réel de la société. Ce qui m'amène à ce que nomme le titre de ce billet: l'entropie systémique.
Entropie et néguentropie des systèmes isolés.
L'entropie est diversement définie, on la rapporte le plus souvent à la désorganisation d'un système, je préfère cette proposition, «l'imprédictibilité du contenu en information d'un système»; d'un sens “entropie systémique” est un truisme, une lapalissade, une “vérité d'évidence”, d'un sens non: pour la physique la détermination d'un système est arbitraire, en biologie, en écologie et en théorie de l'information c'est moindrement le cas; en outre, m'intéresse ici l'entropie non comme processus “naturel” mais comme processus “culturel”, les conditions où une société devient paradoxalement imprédictible par le fait même qu'on tente de la rendre ou maintenir prédictible et prévisible. Les systèmes concernés par l'entropie sont des systèmes fermés dynamiques, évolutifs et isolés, l'état optimal d'un tel système se modifie dans le temps et selon les contextes. Notamment, les composantes élémentaires ou complexes d'un écosystème ou d'un biosystème d'un instant donné ne sont plus celles d'un autre instant; ces évolutions sont lentes mais inéluctables, pour ne prendre que la part humaine d'une société humaine, chaque génération (environ tous les vingt ans) l'optimum est défini par un nouveau groupe, et toutes les trois à quatre générations la quasi-totalité des humains qui constituent cette société n'est plus la même, entretemps des humains sont morts, des humains sont nés, il y a eu, comme disent les pessimistes, un Grand Remplacement, ou comme disent les optimistes, une Grande Révolution, et comme disent les réalistes, un changement, peut-être grand, peut-être non, mais dans les tous les cas la société est autre. Un changement grand au moins en ceci: presque aucun humain né avant 1900 n'est vivant et la majeure partie des humains actuels a moins de cinquante ans donc n'a aucune expérience directe de la réalité antérieure à 1970. Je ne suis pas beaucoup plus ancien puisque né en 1959, mais à ma naissance dans leur majorité les anciens combattants de 1914-1918 avaient de 60 à 75 ans, puisqu'ils avaient de 17 à 25 ans à l'époque, et les anciens combattants de la deuxième guerre mondiale de 32 à 47 ans. Ma grand-mère maternelle est née en 1912, sa mère alentour de 1890 et sa propre grand-mère alentour de 1860. La France de 2020 n'a plus grand chose en commun avec celle de 1960, et à-peu-près rien avec celle de 1860. Désolé pour vous, M. Zemmour et Mme Le Pen, vous vous inquiétez inutilement, le Grand Remplacement a déjà eu lieu, la France de 2020 n'est plus celle de votre jeunesse, moins encore celle de votre enfance. Et il n'y a aucune chance qu'elle puisse le redevenir: le passé est passé. C'est ainsi...
Ce qui amène proprement, concrètement cette fois, à l'entropie systémique. Une société n'a qu'une manière de préserver un état optimal, s'adapter. Dans trois billets récents, «Quand les choses doivent changer, elles changent», «Addendum III à “Quand les choses doivent changer...”» et «Changer la société», je reviens sur un sujet qui m'intéresse assez, le rapport complexe entre infrastructure et superstructure dans une société. Fonctionnellement, l'infrastructure est la partie “yang”, stable, du système, la superstructure sa partie “yin”, mobile. Effectivement «il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin», il y a de la mobilité dans la stabilité et de la stabilité dans la mobilité. Pragmatiquement, on peut dire que l'infrastructure est la partie structurelle de la société, la superstructure celle processuelle, ou que la superstructure assure sa régulation, l'infrastructure assurant les productions. Dans les billets cités je spécifie que les changements au niveau de l'infrastructure et de la superstructure sont décalés. Si fonctionnellement la superstructure est la partie mobile du système et l'infrastructure celle stable, quand l'une de ces parties domine, la part correspondante de l'autre partie domine en elle: quand l'infrastructure domine, la superstructure assure sa stabilité, ses structures, quand la superstructure domine, l'infrastructure renforce sa mobilité, ses processus. Et bien sûr, dans toute situation la société est en évolution constante dans sa structure comme dans son processus.
Une comparaison qu'il m'arrive d'utiliser pour illustrer la chose est la marche à pied: durant le parcours l'individu est à la fois stable et mouvant: le déplacement est amorcé par un basculement du corps autour de son centre de gravité; dans cette phase le corps est en mouvement mais a deux points stables, l'un statique, celui au sol, l'autre dynamique, le centre de gravité; au bout de cette phase, le corps trouve un autre point stable au sol, et durant un court moment le point précédemment dynamique est statique, celui précédemment dynamique est statique, et l'on quitte le précédemment point d'appui au sol; puis de nouveau le centre de gravité se déplace jusqu'à trouver un nouveau point d'appui au sol. Je prends cet exemple car il est connu et assez évident d'un phénomène général, le mouvement d'une entité du vivant est un constant déséquilibre qui s'articule sur deux points stables, l'un interne, ici le centre de gravité, l'autre externe, ici le point d'appui au sol. La continuité du mouvement vient de sa répétition, son changement vient de ce que ces points stables évoluent dans l'espace et le temps, et que leur réalisation dépend des individus et du contexte. Ça fait près de soixante ans que je pratique la marche bipède, dans le principe la pratique est la même aujourd'hui qu'il y a cinquante-huit ans, en quelque lieu que je sois et quelles que soient les conditions, dans l'effectivité des choses je ne la réalise pas de la même manière aujourd'hui que quand j'avais trois ans, quand je me prends un tour de rein (déplacement de vertèbre ou froissement de muscles) je me déplace autrement que dans l'ordinaire du temps; selon que j'aie les mains vides ou que je transporte des choses ou des êtres, et selon la manière dont je les porte, mon centre de gravité sera très différent; selon qu'il y ait grand vent ou non, selon que le sol sera verglacé ou non, selon que le terrain sera plat, montant ou descendant, dans chaque circonstance différente cette réalisation sera autre. Ma description abstraite de la marche à pied ne tient pas compte des circonstances “fort vent dans le dos” et “descente d'une pente” où l'on tend à placer le centre de gravité dans le sens contraire de la marche pour compenser une poussée extérieure contraire au mouvement, ou en cas de fort vent à le placer beaucoup plus bas qu'habituellement, ce qui modifie tous les rapports entre la masse du corps, le point d'appui interne et ceux externes.
Dans cette activité comme dans toute autre entre en jeu l'autocorrection, la régulation: l'état optimal n'est pas le même selon les conditions concrètes de réalisation: au temps lointain où je mesurais cinquante centimètres de moins pour environ le tiers de mon poids actuel, ma manière de lutter contre un vent très fort différait grandement pour aboutir à un résultat similaire, me déplacer d'un point A vers un point B, et bien sûr à l'époque comme maintenant je ne me déplace pas de la même manière en montée, en descente et sur le plat, en forêt ou dans un espace ouvert, sur du sable ou du béton, etc.
Une société est un corps, une entité, un système fermé autocorrecteur. Tenant compte du fait, bien sûr, qu'un système n'est jamais strictement fermé, il se meut dans un milieu qui s'insère lui-même dans un environnement. Ce qui me meut n'est pas un simple mouvement interne, ce qui vaut pour la marche vaut pour tout déplacement: sans point d'appui, sans force en opposition, pas de mouvement. Bien sûr il doit aussi y avoir un mouvement propre mais donc, en opposition. Tout mouvement dans cet univers découle d'un enchaînement action-réaction, il en va de même des mouvements du vivant, sinon qu'il s'agit en ce cas d'enchaînements action-réaction-rétroaction. Une entité du vivant est une sorte d'univers, une parcelle d'univers qui a découvert le moyen de faire une chose impossible, de la néguentropie, de l'entropie négative. On doit faire avec les termes dont on hérite, “néguentropie” est mal choisi, il ne s'agit pas d'entropie négative mais d'anti-entropie puisque la néguentropie «se définit par conséquent comme un facteur d'organisation des systèmes physiques, biologiques et éventuellement sociaux et humains, qui s'oppose à la tendance naturelle à la désorganisation (entropie)». Je cite comme c'est écrit, ici «par conséquent» propose une fausse conséquence, ici une conséquence qui découle de l'explication du terme donnée dans la première phrase: «La néguentropie est l'entropie négative. Elle se définit par conséquent [etc.]». Je ne sais pas ce que pourrait être une “néguentropie”, une entropie dans un “univers négatif”? Un anti-univers constitué d'anti-particules. Ici il s'agit d'autre chose, la néguentropie s'oppose à l'entropie non parce que c'est “de l'entropie inversée” mais un processus inverse à l'entropie, un facteur d'organisation et non un facteur de désorganisation.
La néguentropie étant une chose impossible – tout système fermé isolé tend à la désorganisation –, un système du vivant, et le vivant en tant que système, la biosphère, font une autre chose qu'on peut nommer “entropie différée”, dans le temps ou/et dans l'espace. Localement, là où a lieu le phénomène, une partie de l'énergie disponible dans le système est dirigée de manière à l'organiser, et la désorganisation induite dirigée pour partie ailleurs dans le système et pour une partie nettement plus importante dirigée en-dehors du système. Comme cet “extérieur du système” est aussi, à son niveau, un système, duquel ce système “néguentropique” participe, celui-ci n'est que temporairement et localement anti-entropique. La partie «Exemple et application» permet de comprendre la manière dont la néguentropie se réalise:
«Interprétation en termes d'énergie.
En prenant l'exemple d'une cellule, on peut voir la vie comme une forme de néguentropie. Elle tend à conserver sa néguentropie, c’est-à-dire une organisation, une structure, une forme, un fonctionnement, et cela grâce à la consommation d'énergie, venant de l'extérieur de la cellule. Une cellule morte n'entretient plus cette néguentropie, donc elle se désagrège.
Interprétation en terme d'information.
Ce qui rend possible le maintien d'une structure “ordonnée” (capable de s'adapter en permanence à un environnement changeant): ce sont les voies de communication sélectives entre le corps de la cellule et son environnement. Les membranes des cellules sont poreuses, mais seulement de façon sélective; si une cellule perd cette capacité de sélection dans ses échanges avec son environnement, elle meurt rapidement, notamment sous l'effet de toxines dont elle ne peut plus se protéger.
À une échelle beaucoup plus large, la planète Terre n'est pas un système isolé: elle reçoit de l'énergie, essentiellement solaire, en réémet une partie vers l'univers, et, au passage, une partie est captée par les formes de vie sur Terre, contribuant à donner cette vision de néguentropie présentée par Schrödinger».
Souligné par moi. On peut dire de même pour les parties déterminées du biosystème global, la biosphère, ou des biosystèmes locaux, les écosystèmes: à une échelle bien plus restreinte, une entité du vivant n'est pas un système isolé, la cellule fait comme l'organisme dont elle participe, l'organisme comme son écosystème, l'écosystème comme la biosphère: chaque entité reçoit de l'énergie, en réémet une partie en dehors d'elle et au passage, en capte une partie, contribuant à donner cette sensation de néguentropie. Je suppose que vous le savez, la partie “matière” de l'univers est en permanence traversée par ce qui compose sa partie “énergie”, une parcelle de matière est construite de telle manière qu'une faible frange de ce qui en constitue l'énergie peut interagir de manière importante avec elle, chaque parcelle de matière, simple ou complexe, a sa propre frange de fréquences, qui s'harmonisent occasionnellement avec de l'énergie dans les mêmes franges. Par exemple, un être vivant terrien est “opaque à la lumière” en ce sens qu'il s'harmonise principalement avec la frange d'ondes électro-magnétiques allant 300nm (nanomètres) à environ 900nm; il interagit avec les autres fréquences du spectre électromagnétique mais ne sait pas les organiser, il existe d'ailleurs une série de franges proches de celle qui forme la “lumière visible” – visible par un œil humain – qui tendent à désorganiser une entité du vivant, celles dites “rayons X”, “ultraviolet”, “infrarouge”, et les “micro-ondes”, tenant compte qu'une partie de ces franges, l'ultraviolet proche et l'infrarouge proche, contribue à l'organisation du vivant pour autant que ces fréquences ne soient pas en excès.
Factuellement, toutes les fréquences du spectre électromagnétique interagissent avec le vivant mais seule une partie restreinte de ce spectre contribue massivement à sa “néguentropie”. La raison en est circonstancielle: cette frange «correspond à la plus forte énergie de rayonnement solaire arrivant à la surface de la Terre», et comme, ainsi que mentionné dans l'article “néguentropie”, en tant que système “semi-fermé” la Terre reçoit de l'énergie surtout solaire, la plus grand part de l'énergie “circulante” disponible sur cette planète est dans cette frange. Ce n'est pas vrai de toute vie sur la Terre, notamment dans les sources hydrothermales sous-marines profondes ou monts hydrothermaux elle tire partie d'une frange plus basse, les infrarouges, l'énergie solaire n'étant pas disponible dans les grandes profondeurs. Le processus de “synthétisation de l'énergie”, de son “organisation” ou “néguentropisation”, est assez différent dans ces contextes même si le principe reste le même: diriger les flux d'énergie dans une structure de manière à maintenir l'autonomie de l'entité.
La néguentropie est une impossibilité au plus haut niveau d'un système fermé, on ne la réalise que localement et transitoirement, un système ne s'organise pas durablement, arrive toujours le moment où il se désorganisera par excès ou insuffisance d'énergie. Comme dit, aucun système n'est fermé, sinon peut-être l'univers dans son entier – en tout cas, à notre niveau de compréhension de la réalité l'univers einstieinien est fermé, tenant compte de ce que tout “modèle standard” en cosmologie comme en mécanique est toujours transitoire, ce qui ne change rien d'ailleurs; dans un état donné du savoir l'univers est toujours fini, stable et “entropique”. L'univers est fractal, ce qui vaut pour la partie vaut pour le tout et réciproquement: dans un état donné du savoir, l'univers apparaît toujours limité, et toujours tendant vers la désorganisation. Ce qui est probablement vrai – je veux dire, même si les contemporains le comprenaient autrement, quand l'univers se limitait au système solaire il n'était pas moins fini, et pas moins destiné à la désorganisation que dans le contexte actuel où le système solaire apparaît une fraction infime de l'univers. C'est bête à dire mais si un système a un début on peut supposer par extrapolation qu'il aura une fin car c'est le cas général des systèmes: ils ne sont pas éternels. Où ils ont une éternité non infinie...
Toute entité du vivant a quatre contextes: elle-même comme entité, comme “atome”, objet indivisible; elle comme “univers”, comme “milieu intérieur”, elle comme élément d'un système local, d'un “milieu extérieur”, elle enfin comme participant d'un système plongé dans un “environnement”, un ensemble plus large de systèmes similaires en interaction faible ou modérée. Tout système est délimitable comme tel parce qu'il a une forme déterminée de néguentropie, le système solaire est un système car il est organisé et limite ou réduit son niveau d'entropie, la Voie lactée est un système pour les mêmes raisons, les amas de galaxies de même, et in fine l'univers dans son entier – tel qu'il existe, tel qu'on peut le constater, il est organisé dans son ensemble même si localement il tend à une certaine désorganisation, pour exemple notre système solaire a un avenir fini comme ensemble organisé, dans environ cinq milliards d'années il connaîtra un changement qui résultera en sa désorganisation, sa fin en tant que système globalement fermé. Bien sûr, le type de néguentropie des systèmes larges “non vivants” est passif, le système solaire n'a pas choisi de s'organiser, et ne choisira pas de se désorganiser, c'est un état transitoire d'une fraction limitée de l'univers qui pendant un certain temps s'est organisé puis a connu, et connaît encore, un état globalement stable à évolution lente, puis pendant un certain temps il se désorganisera jusqu'à “mourir”, cesser d'être un système globalement fermé.
La néguentropie du vivant diffère de celle du non vivant en ce qu'elle se réalise dans des systèmes non fermés et qu'elle modifie de manière dirigée à la fois l'entropie et la néguentropie de son contexte. Comme dit, la notion de système isolé ou de système fermé ne se vérifie pas, «des systèmes véritablement isolés n'existent pas dans la réalité physique. Il y a toujours des interactions avec l'environnement (exemple de la gravité opérant entre la masse du système et les masses extérieures)», mais «un système réel peut se comporter comme un système isolé avec une bonne approximation». Le système solaire en est un bon exemple, il interagit avec le reste de l'univers mais les principales forces, notamment la gravité, ont une influence très faible qui agit marginalement sur ce système. À l'intérieur de ce système en revanche les influences réciproques entres ses entités est beaucoup plus notable, d'autant plus celles qui sont très massives ou très proches les unes des autres. Et bien sûr, dans le cadre même d'une entité massive comme la Terre ou l'ensemble Terre-Lune il n'existe pas de système fermé, cette entité étant un système “semi-fermé”, on peut le considérer assez fermé dans son ensemble – les flux d'énergie qu'il reçoit et émet s'équilibrent et de ce fait l'ensemble en est lentement et faiblement modifié – et assez ouvert dans ses parties qui “font système”. Cela dit, un système ouvert dans un contexte local limité ne se vérifie pas non plus dès lors qu'on peut le déterminer comme système. Dans un contexte local limité tout système est donc semi-ouvert ou semi-fermé. Comme mentionné dans l'article «Entropie», une cellule «tend à conserver sa néguentropie, c’est-à-dire une organisation, une structure, une forme, un fonctionnement, et cela grâce à la consommation d'énergie, venant de l'extérieur de la cellule», Venant de l'extérieur de la cellule et y retournant: à son début et à sa fin une cellule est plus “ouverte”, au début elle “gagne” en énergie et en matière, à la fin elle “perd”, le reste de son existence elle est plutôt “fermée”, gains et pertes s'équilibrent et le plus souvent se réduisent même si selon les contextes une cellule peut alternativement augmenter le niveau de perte ou de gain, donc augmenter le niveau des échanges avec le milieu ou avec l'environnement (pour la cellule d'un organisme son milieu est le milieu intérieur, le milieu extérieur de l'organisme étant son environnement).
Factuellement, objectivement, les entités du vivant sont des systèmes ouverts, il n'y a pas de solution de continuité entre ces entités, biosphère incluse, et leur milieu ou/et leur environnement; subjectivement ce sont des systèmes fermés en interaction avec leur contexte, leurs contextes, fonctionnellement ils comportent une infrastructure essentiellement “structurelle”, stable, matérielle, et une superstructure essentiellement “processuelle”, mobile, énergétique, mais la structure est mobile et le processus est stable, raison pourquoi l'infrastructure “tend à la fermeture” sans être fermée, est “semi-ouverte”, et la superstructure “tend à l'ouverture“ sans être ouverte, est “semi-fermée”. De ce fait un dérèglement, un désorganisation partant de l'infrastructure ira vers un ralentissement, partant de la superstructure vers un emballement. Dans les deux cas la question cruciale est celle des ressources, de “l'énergie circulante” – y compris quand circule de la matière, celle-ci ne devient “socialement utile” que si on la transforme en énergie ou quand de l'énergie est mobilisée pour la transformer ou la déplacer. Même si l'orientation de l'évolution du système est opposée, au sein de la société les effets sont similaires, dans les deux cas un déséquilibre entre structure et processus, entre matière et énergie, entre stabilité et mobilité, et dans les deux cas on a le choix entre réduire le mouvement ou l'accélérer, bien sûr si on fait le mauvais choix, accélérer en situation d'emballement ou freiner en situation de ralentissement, on augmentera le niveau d'entropie jusqu'à désorganiser le système.
Si pour le système les effets d'un ralentissement ou d'un emballement sont opposés, pour les individus les conséquences sont les mêmes: il perçoit un emballement au niveau global et un ralentissement au niveau local, avec par moments un ralentissement global et un emballement local. La raison en est que “matière” et “énergie” sont en décalage, donc un choix erroné en matière de régulation tendra à donner l'impression d'une accélération du système qui au plan local, dans le sous-système où évolue l'individu, est d'effet presque nul, le contraste entre ces deux perceptions donnant donc dans les deux cas cette impression d'un ralentissement local. On peut le décrire autrement: une société étant un réseau avec des nœuds et des liens, quand il y a discordance entre structure et processus la diffusion des échanges entre nœuds devient erratique. En cas de ralentissement on ne dispose plus d'assez d'énergie pour assurer les échanges, en cas d'accélération il faut toujours plus d'énergie pour un même résultat, dans les deux cas l'énergie dépensée ne suffit plus pour assurer la cohésion de l'ensemble, pour maintenir les liens entre les nœuds. Perceptivement, au plan local on a l'impression qu'il y a “de plus en plus d'information” ou que “l'information va de plus en plus vite”, deux descriptions d'un même phénomène, et l'impression contraire ou paradoxale qu'on “en sait de moins en moins” ou que “l'information informe de moins en moins”. Quelle que soit la situation, quel que soit le cas, la solution est toujours la même: adapter les besoins aux ressources, rétablir une situation où le “niveau d'énergie” du système tende vers un état optimal non pas en fonction de ce qu'on croit mais en fonction de ce qui est. Comme il m'arrive de l'écrire, les sociétés sont immortelles. Ce qui ne leur évite pas toujours de mourir. En outre leur manière d'être immortelles est celle du phénix, de loin en loin elles meurent en se consumant ou en s'embrasant, dans l'un et l'autre cas sont réduites en cendres et peu de temps après, renaissent de leurs cendres. Car contrairement aux organismes la mort de l'entité ne résulte pas en la mort de ses composantes élémentaires.
Pour exemple, entre 1940 et 1946 la France en tant que société est morte quatre fois, en 1940 en cessant d'être une république à tendance démocratique pour devenir une dictature, en 1944 en cessant d'être une dictature pour devenir une république constituante, forme nécessairement transitoire, de peu de durée, puis en 1946 en devenant une république à tendance démocratique. Elle est nouveau morte pour renaître de ses cendres deux fois de plus, en 1958 comme république constituante puis en 1962 comme monarchie républicaine. Chaque fois, ses composantes élémentaires, à quelque chose près, restèrent les mêmes. Certes, ces métamorphoses ne sont pas sans conséquences mais si l'on considère la population de départ, celle de 1939, du moins pour ce qui est de sa population métropolitaine, et celle de 1965, c'est largement la même et en majorité les décès furent la conséquence d'un processus de renouvellement prévisible, sans cesse des gens naissent et des gens meurent, certaines années, pour des raisons diverses il y a une “surmortalité”, dans cette période ce fut surtout en 1939-1940, en 1944-1945 et en 1956-1960 qu'il y eut une surmortalité significative parmi les humains de quinze à trente ans, et une surmortalité de tous âges parmi certaines populations en 1941-1945 et, surtout hors métropole, durant la décennie 1950. Clairement, la mort d'une société n'a pas nécessairement et même, a rarement pour conséquence la mort de ses membres.
Homéostasie, cybernétique, régulations et anomies.
La fin de sa propre société est un événement inquiétant, nous vivons avec ce sentiment faux que notre société telle qu'elle est à un instant donné est dans un état optimal, ce qui n'est pas toujours le cas et ne l'est à coup sûr pas quand elle s'écarte significativement d'un tel état. Or, la manière même dont une société se transforme rend cette métamorphose indiscernable, un ralentissement ou un emballement sont des cas particuliers de cas généraux, comme toute entité du vivant une société, par partie ou dans son ensemble, a des moments de plus grande ou de moindre activité, des moments de plus grande ou de moindre coordination, une société est homéostatique. le terme “homéostasie” est celui qui nomme la régulation autocorrectrice dans les systèmes du vivant. Pour citer l'article de Wikipédia:
«Opérant comme un système de régulation, l’homéostasie requiert un capteur [...] qui mesure le facteur réel, un actionneur capable d'agir sur sa valeur, et entre les deux un processus d'ajustement permettant de faire varier l'activité de l'actionneur en fonction de la valeur mesurée».
L'extension du terme à des systèmes non biotiques est très récente, le Trésor de la langue française, le TLF, donne cette seule définition:
«Tendance de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques (température, débit sanguin, tension artérielle, etc.) à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale».
Ce dictionnaire rend un état de la langue tel qu'il est alentour de 1970, ce qui donne l'indice que l'extension de “homéostasie” à des systèmes non vivants est ultérieur. Je ne sais pas s'il existe un terme propre aux systèmes non vivants mais du moins existe-t-il, depuis le milieu du XX° siècle un terme nommant comme adjectif tous les systèmes autocorrecteurs et nommant comme substantif leur étude, “cybernétique”, qui est, comme substantif féminin, la
«science qui utilise les résultats de la théorie du signal et de l'information pour développer une méthode d'analyse et de synthèse des systèmes complexes, de leurs relations fonctionnelles et des mécanismes de contrôle, en biologie, économie, informatique, etc.»;
en emploi adjectif ça désigne donc ce qui ressort «des systèmes complexes, de leurs relations fonctionnelles et des mécanismes de contrôle», d'où, un système cybernétique est un système complexe doté de mécanismes de contrôle – et de régulation. Pour éviter les confusions, et aussi parce qu'en ce début de troisième millénaire l'usage courant de “cybernétique” désigne autre chose, c'est devenu un quasi-synonyme de “informatique”, et enfin parce que les systèmes qui m'intéressent le plus sont les biosystèmes, je continuerai de parler d'homéostasie et d'homéostatique. Pour une description brève mais très suffisante selon moi je renvoie au texte de Gregory Bateson «L'épistémologie de la cybernétique», que j'ai tiré de son article «La cybernétique du “soi”: une théorie de l'alcoolisme», texte dans lequel il nomme ces systèmes d'après leur caractéristique la plus intéressante pour la cybernétique, des systèmes autocorrecteurs. Un passage notamment m'intéresse ici:
«Cet aspect holistique [d'un système intérieurement (inter) actif] est évident même dans des systèmes autocorrecteurs très simples. Dans la machine à vapeur à “régulateur”, le terme même de régulateur est une appellation impropre, si l'on entend par là que cette partie du système exerce un contrôle unilatéral. Le régulateur est essentiellement un organe sensible (ou un transducteur) qui modifie la différence entre la vitesse réelle à laquelle tourne le moteur et une certaine vitesse idéale ou, du moins, préférable. L'organe sensible convertit cette différence en plusieurs différences d'un message efférent: Par exemple, l'arrivée du combustible ou le freinage. Autrement dit, le comportement du régulateur est déterminé par le comportement des autres parties du système et indirectement par son propre comportement à un moment antérieur».
Même si ce n'est pas toujours le cas un régulateur autre qu'électronique est en général un organe passif, tel par exemple un thermostat, qui se trouvera dans un état “freinage” ou “accélération” selon les conditions du milieu: au-delà d'une certaine température il n'y a plus contact dans le circuit thermique, en-deçà il y a contact, l'état optimal est donc “[N]°C ±[M]°C”, l'interruption ou l'établissement du contact se faisant automatiquement, par dilatation ou contraction du contacteur / interrupteur, dès qu'on atteint les limites supérieure ou inférieure.
Quelque complexe soit un système homéostatique ses régulations sont toujours assez simples, des “bascules” qui s'activent ou s'inactivent dès qu'on atteint des valeurs limites. Le problème avec une société, du moins avec une société large, vient de ce qu'elle se compose de sous-systèmes qui se comportent comme des systèmes fermés – qui sont des systèmes fermés. Enfin, plutôt semi-fermés, ou semi-ouverts. Ce que j'évoquais précédemment, la perception par les individus, lors d'un emballement ou ralentissement global, d'un ralentissement local et d'un emballement global avec par moments un emballement local et un ralentissement global, vient de ce que le système local a sa propre régulation, rarement en phase avec la régulation globale. Dans une société idéale ou à l'inverse une société entièrement contingente il y aurait en permanence une adaptation réciproque de tous les systèmes en interaction en son sein. Or les sociétés humaines sont similaires à tout biosystème, leurs sous-systèmes ne sont qu'imparfaitement concordants et parfois très discordants, avec cette différence par rapport à un organisme ou à une société dont les individus sont nativement conditionnés, les sous-systèmes et leurs composantes (les individus et groupes d'individus) ont une autonomie de décision très supérieure à celle des cellules, des organes, des fourmis ou des abeilles. Dans une société large il y a un énorme écart d'anticipation entre court, moyen et long terme entre le niveau élémentaire et celui global: pour vous et moi le court terme c'est un jour à un mois, le moyen terme deux ou trois mois à quelques années, le long terme un lustre à un peu plus d'une vie; pour une société large le court terme est rarement inférieur à quelques semaines et va jusqu'à quelques lustres à quelques décennies, le moyen terme va d'une à deux générations jusqu'à une dizaine, le long terme se mesure en siècles, voire en millénaires. Compte non tenu de la récente “globalisation”, moins de deux siècles, et de la “mondialisation” actuelle, qu'on peut faire remonter à environ cinq siècles, dans mon espace civilisationnel, celui qui englobe la partie la plus occidentale de l'Eurasie (en gros, l'Europe centrale et occidentale et une partie de l'Europe orientale), le Moyen-Orient et la partie de l'Afrique au nord-est et au nord du Sahara, à quelque chose près ce qui correspond à l'Empire romain dans sa plus grande extension,
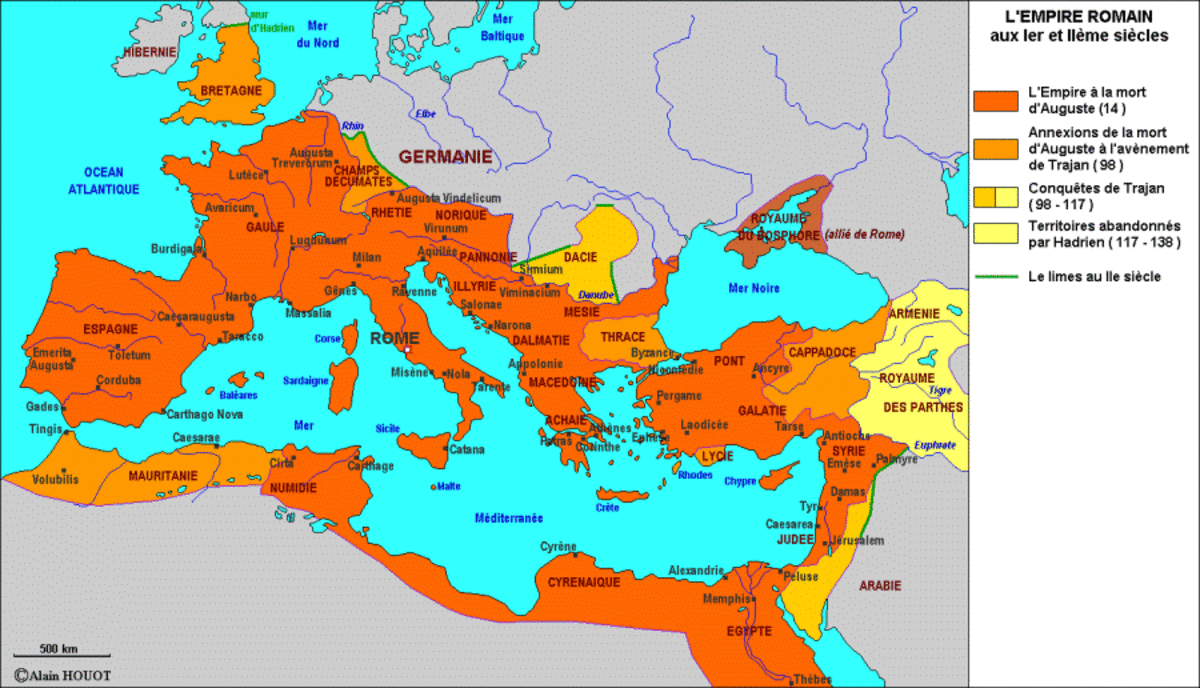
Agrandissement : Illustration 1
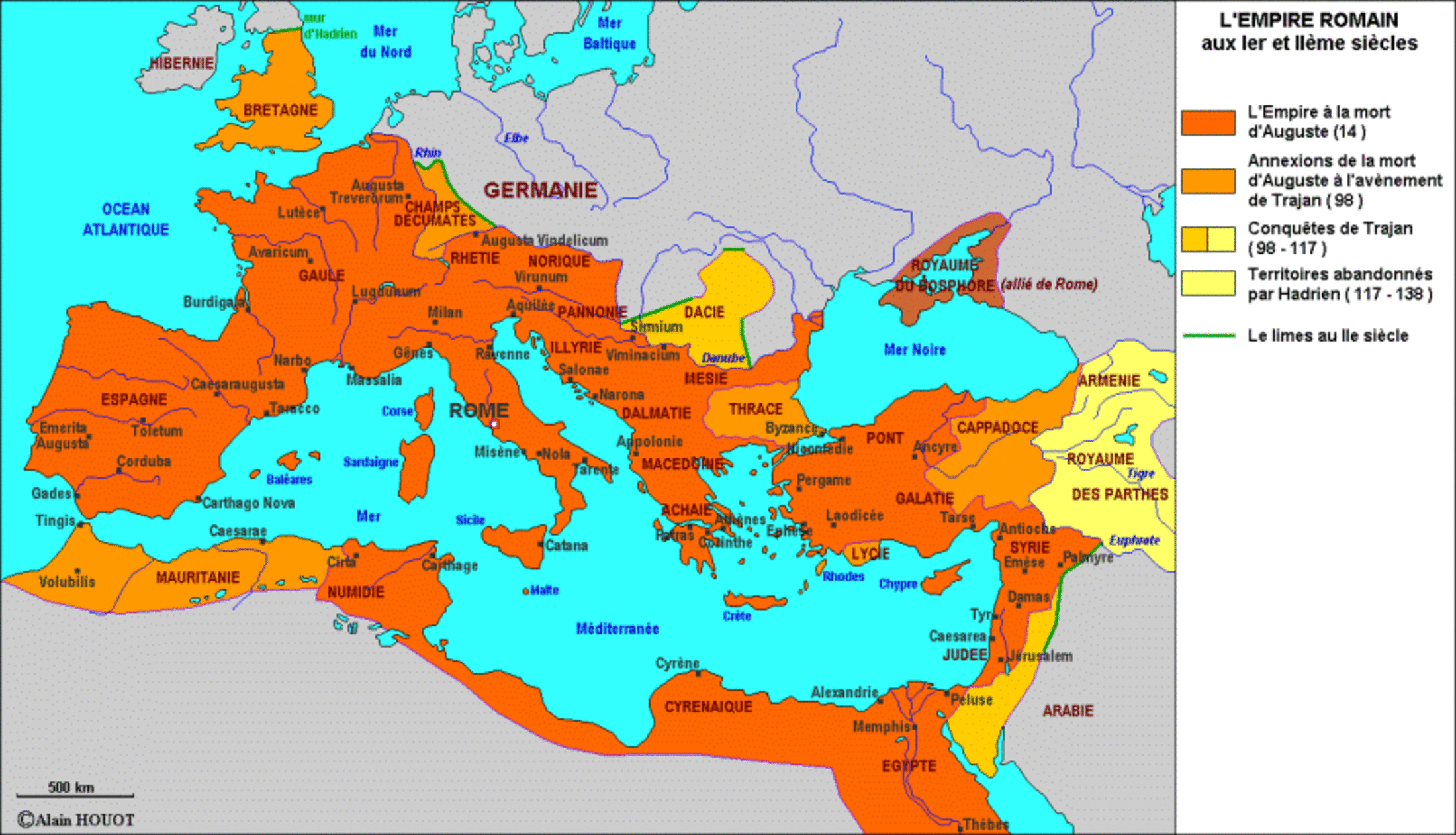
à quoi il faut ajouter la “Germanie” (y compris l'Hibernie – l'Irlande –, la Calédonie – l'Écosse – et la Scandinavie non germanique) et l'“Arabie”, dans cet espace civilisationnel donc, un long processus d'intégration a lieu depuis environ quatre millénaires, avec des phases secondaires, des moyens termes, de plusieurs siècles, et des courts.termes de plusieurs générations, mais régionalement les cycles sont de moindre extension, de l'ordre du millénaire pour le long terme, d'un à deux siècles pour le moyen terme, de deux à quatre générations pour le court terme, et localement d'encore moindre extension, on peut dire qu'en gros le moyen terme d'un système donné correspond au court terme de celui de niveau supérieur et au long terme de celui de niveau inférieur. À quoi s'ajoute, comme cause de discordance, le fait qu'au départ les diverses parties de cet ensemble ne sont pas “en phase”. S'y ajoute encore le fait que les divers systèmes déterminables en tant que “bassins de civilisation”, et bien, sont des biosystèmes, donc semi-fermés ou semi-ouverts: l'ensemble que je nomme ici “mon espace civilisationnel” n'est pas fermé au reste de l'univers local – du monde habité par les humains –, et tantôt est influencé directement (les “invasions” et “colonisations”) ou indirectement par d'autres espaces civilisationnels, tantôt les influence directement ou indirectement. Pour reprendre le cas de l'Empire romain durant l'assez longue période où il fut très étendu et assez unifié, qui commence au I° siècle de l'ère commune et se poursuit jusqu'au début du V° siècle, comme l'illustre cette autre carte,
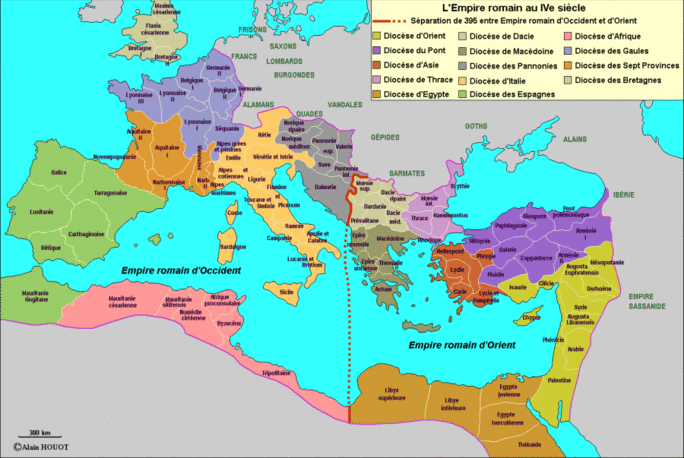
Agrandissement : Illustration 2
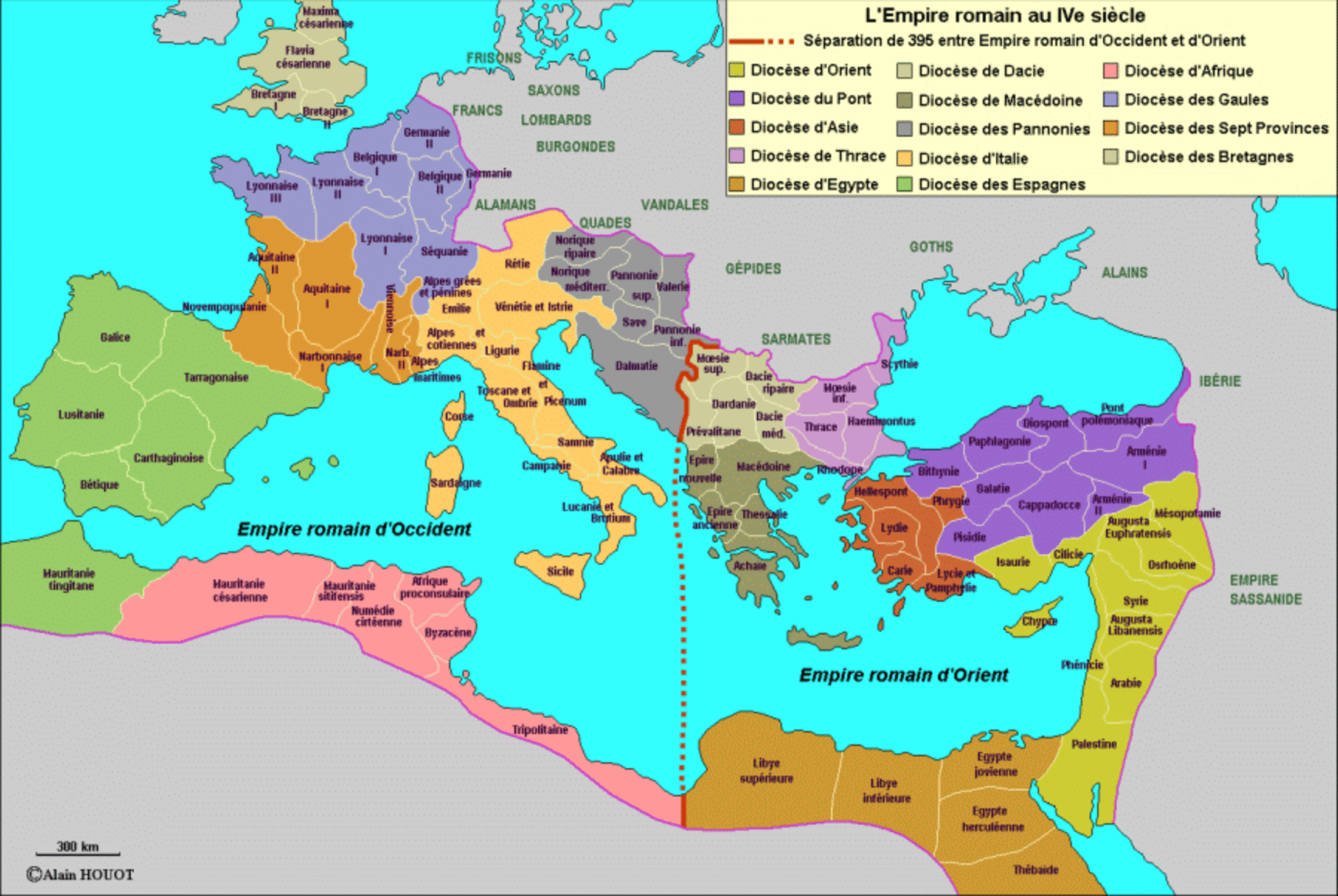
le noyau de cet Empire, le Latium, est au départ “civilisé”, influencé, par deux voisins entreprenants, les Étrusques et les Grecs, puis en prenant son autonomie en un premier temps il intègre à son Empire l'Étrurie et une partie des colonies grecques, en un second temps il influence puis il intègre une large part de l'espace sous influence hellénistique, pour au moment de sa plus grande extension intégrer et les deux autres Empires proches, égyptien et perse, qui étaient déjà à l'époque intégrés à la zone d'influence grecque, qui fut remarquablement étendue sous Alexandre et ses successeurs.
Pour précision, cette extension de l'Empire romain, celle du moment de la scission (de fait à la fin du III° siècle puis de droit un siècle plus tard) entre Empire d'Orient et Empire d'Occident, a peu varié jusqu'au milieu du V° siècles, même si sa partie occidentale est déjà en cours de désorganisation, ce qui fut le principal motif de la scission. Bien que le point d'expansion originel de l'Empire romain soit dans la Péninsule italique, l'unification de sa partie occidentale fut toujours précaire, alors que sa partie orientale, certes pas tout unie et apaisée, est beaucoup plus solide car beaucoup plus anciennement unifiée, pour l'essentiel l'Empire romain place sous son contrôle l'espace “hellénistique”, la partie la plus occidentale du bref mais puissant et puissamment fédérateur Empire d'Alexandre. La partie occidentale connaît à quelque chose près la même expérience que sa partie orientale avec quelques siècles de décalage: l'unification de cette partie se réalise vraiment quand elle est soumise par Rome, et en opposition à cette conquête, leur “unité” se construit en contraste avec l'unification contrainte sous le conquérant romain, alors que dans la période antérieure le conquérant était “le Grec” ou “le Macédonien”. Clairement, cette scission découle du fait que ce qui devint l'Empire d'occident devenait de plus en plus instable et ingouvernable, “entropique”: trop de territoire et trop de population pour insuffisamment de ressources. Dans un état ultérieur, l'Empire d'Orient dans sa plus grande extension reprit la partie la plus orientale de celui d'Occident, plus toute sa partie africaine et une partie de la Péninsule ibérique, mais dès Dioclétien (empereur de 284 à 305) et plus encore sous Constantin Ier (empereur de 306 à 337) le “centre du pouvoir” se déplaça de fait en Orient, à Nicomédie, sous Dioclétien, puis de droit sous Constantin avec la fondation de Constantinople, “la ville de l'empereur” comme son nom l'indique. Mais dès la fin du III° siècle si formellement Rome est toujours la capitale, le pouvoir impérial s'installe d'abord à Milan de 286 à 402, puis à Ravenne de 402 à 476, année où l'Empire d'Occident disparaît en tant qu'entité autonome pour devenir, très provisoirement, une sorte de protectorat de l'Empire d'Orient.
Je raconte ça parce que j'aime étaler ma science – ne pas croire cette sentence probablement inventée par un imbécile et semble-t-il faussement attribuée à Françoise Sagan, «la culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale», la seule manière de propager la culture ou la science est de l'étaler, si possible en couches épaisses – mais surtout pour illustrer mon propos: dans un espace social large les déphasages entre régions est un cas courant, et particulièrement propice à instaurer une situation de désorganisation qui sur le plan des sociétés se traduit en anomie (dans l'acception 2), en «absence de normes ou d'organisation stable», avec pour conséquence le «désarroi qui en résulte chez l'individu». Remarquez, une société anomique est aussi un «genre de mollusques [...] à deux valves inégales». Une entité dont les valves “structure” et “processus” sont “inégales”...
Dans toute société “l'état anomique des individus” est une chose ordinaire qui selon les circonstances peut atteindre une forte minorité voire une majorité de ses membres sans augmenter significativement le niveau d'entropie. En fait ça dépend largement du “sentiment social”: si une personne a une très faible perception et compréhension de la plus large extension de son espace social, et une perception faible ou nulle de toute extension sociale au-delà de son milieu immédiat, qu'elle soit “anomique” ou non a une incidence presque nulle au-delà de ce milieu, et le plus souvent faible dans ce milieu même. C'est bête à dire mais pour désorganiser un système il faut avoir la conscience de ce système, et savoir alors où agir pour enrayer son fonctionnement. Quand je dis en avoir la conscience ça n'induit pas qu'on le comprend en tant que système mais qu'on sait qu'il existe, et à-peu-près quels sont le liens et les nœuds qui en assurent la cohérence. Pour prendre le cas de l'entité “France”, elle existe assurément en tant que société, qu'entité politique, depuis le milieu du XV° siècle (même si une “proto-France” émerge un peu avant, au tournant des XI° et XII° siècles: ce n'est qu'avec la dynastie des Capétiens, qui débute en 987, que se met en place progressivement une rupture avec la pratique antérieure où tous les enfants, au moins ceux mâles, d'une lignée sont également héritiers, donc le territoire divisé en autant de parties qu'il y a d'héritiers, mais ce n'est qu'en 1137, d'abord par circonstance (un seul héritier mâle) puis par coutume puis par droit que seul le premier dans la lignée des héritiers est sacré roi des Francs puis, à partir de 1190, roi de France – considérant qu'au moins jusqu'au XI° siècle les “rois francs” régnaient sur un territoire beaucoup plus large que la seule France, sous un aspect l'Empire de Charlemagne fut le moment de plus grande extension de la “royauté franque” puisqu'à la fois il fut un temps le seul “roi des Francs” en exercice et dans le même temps le successeur autoproclamé de l'empereur romain) mais au moins jusqu'au milieu du XVI° siècle formellement et jusqu'au début du XVII° réellement il n'y a pas d'unité sociale de cette entité, dans le système d'Ancien Régime, au moins jusqu'au début du XVIII° siècle réellement et jusqu'à la fin de ce siècle formellement la majeure partie des Français est “attachée à la terre”, les personnes n'ont pas de liberté formelle de circulation, elles “appartiennent au seigneur”, ou “à la terre”, ou “à cité” dans le cas des “bourgeoisies” même si dans les faits un certain libéralisme a lieu dès le XVII° siècle, dont le motif n'est pas le souhait de changer les règles mais de changer les rapports de force: quand se réalise peu à peu la transition entre régime féodal et régime “absolutiste”, les rois trouvent leurs appuis parmi la “bourgeoisie” afin d'affaiblir les prétentions de la noblesse d'épée. On peut dire que la Révolution française de 1789 trouve une de ses sources principales dans l'extension du “sentiment national” au niveau du royaume parmi les personnes qui dans un état antérieur de la société limitaient ce “sentiment national” à la structure immédiate, le fief ou le bourg, ou au plus à un niveau provincial.
L'anomie ne devient donc un problème que si une frange suffisante de la population d'une société reporte son “désarroi” à ce niveau sans pour autant qu'il y ait une réelle unité de la société. Tant que le voisin est un “étranger” il n'y a pas de possibilité de “fédérer les désarrois”; localement on peut voir émerger des mouvements de mise en cause violente de l'état des choses mais plus rarement son extension sur un territoire plus large. Le cas de la fin (très temporaire) de l'Empire romain d'Occident est inverse: l'anomie atteint la fraction limitée de sa population qui participe pleinement de la structure impériale, un trop large territoire, trop divisé, avec trop peu de ressources; ce qui permet à l'entité “France” d'Ancien Régime une certaine unité est la convergence des “élites” dans le désir du maintien de l'ordre social actuel, des régulations en cours. Le très relatif libéralisme qui se met en place durant le règne de Louis XIV et se poursuit au cours du XVIII° siècle résulte d'une profonde modification de l'infrastructure, de même que le tout aussi relatif libéralisme du tournant des XV° et XVI° siècles résultait d'une profonde modification de la superstructure; mais dès que cette phase de changement va vers son terme, dès que l'infrastructure ou la superstructure trouve son équilibre l'anomie global cesse, la règle revient, et les “dissidents” sont priés de se soumettre, de rentrer dans le rang, ou de disparaître par l'exil ou par la mort.
Dans les “guerres de religion” la religion en soi joua un faible rôle, c'est sa fonction politique, “structurante” et “régulatrice”, qui intervient: l'adhésion des “princes” ou des “peuples” à telle variante du christianisme au tournant des XV° et XVI° siècles eut rarement un motif strictement religieux, notamment nombre de “princes” de l'espace “germanique” adhérèrent à une dissidence “réformée” ou “protestante” pour établir un rapport de force avec l'autorité centrale, l'empereur, et entre eux, et de même dans l'espace français le niveau d'adhésion aux sectes dissidentes du catholicisme est directement lié au rapport qu'entretien telle province avec le pouvoir royal en cours de transformation, celles “girondines”, rétives à la mise en place d'une royauté absolue, y adhérant nettement plus vite et plus fort que celles “jacobines”, plus en accord avec cette évolution. L'édit de Nantes est moins tant un édit de tolérance qu'un édit de pacification, comme le mentionne l'article de Wikipédia. Il n'y a pas de “tolérance religieuse”, de liberté de culte, puisque ce traité divise le territoire en lieux “protestants” et “catholiques” selon l'opinion majoritaire du lieu. Son abolition un siècle plus tard a une cause politique superstructurelle: en 1685 la monarchie absolue est bien assise, il n'y a donc plus lieu pour Louis XIV de ménager les “minoritaires” car ils n'ont plus le soutien de leurs “princes” qui, soit sont entrés dans le nouveau jeu du pouvoir, qui a lieu à la Cour, soit ont perdu de leur puissance car le pouvoir n'est plus dans leurs provinces, sinon en tant que relais du pouvoir royal et pour l'essentiel par l'entremise des “officiers du roi”, essentiellement recrutée dans la bourgeoisie.
Anomie, dérégulation, dérèglement, désorganisation, entropie sont des synonymes quand il s'agit de la modification profonde d'une société, ce que je décrivais comme la mort et la résurrection du phénix. Durant ces moments, on peut dire que le sentiment d'absence de règles n'est pas faux bien qu'il ne soit pas vrai, le phénomène est une substitution, les règles valant dans un certain état des choses ne valent plus dans celui nouveau. Fondamentalement, les règles anciennes restent valides dans leur principe mais non dans leur mise en œuvre. L'exemple que je cite parfois est celui des “dix commandements”, si certains peuvent sembler obsolètes d'autres ont passé l'épreuve du temps. Pour mémoire:
«Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude.
Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c’est pourquoi l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos.
Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu ne tueras point.
Tu ne commettras point d’adultère.
Tu ne déroberas point.
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain» (Deutéronome, 6, 6-21).
On peut discuter du sens et de la validité de toute la première partie, jusqu'au verset qui commence par «Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte», on peut lire et interpréter ces commandements de manière “non religieuse”, “non déiste”, et les estimer aussi valides en ce début de troisième millénaire qu'au temps où ils furent édictés, en revanche les suivants, à partir de «Honore ton père et ta mère», valent dans n'importe quelle société, la seule question pendante étant la notion de “prochain”, dans une société où existe l'esclavage, où la population est divisée en castes, classes ou “races”, et où les membres d'une société voisine sont inassimilables, le “prochain” peut se composer d'une part extrêmement limitée de l'humanité; dans le contexte de 2020, formellement tout humain est un prochain, même si de fait pas mal de personnes ont quelques problèmes en ce qui concerne cette extension de la “proximité”, la persistance de l'esclavage de fait et parfois de droit, les sociétés de caste, le refus de l'étranger “inassimilable” et supposé représenter une menace pour la “race” et sa “pureté”, les situations de discriminations en raison de l'origine, de la race, de la religion et autres distinctions, montre que l'universalité des droits humains de la Déclaration promulguée par l'ONU en 1948 n'est pas d'une si grande évidence pour beaucoup. En tout cas, aussi restreint ou étendu que soit l'ensemble des “prochains” selon le contexte, au moins les commandements «tu ne tueras point. [...], tu ne déroberas point [...], tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain», sont acceptables dans toute société.
Le plus souvent une situation anomique n'induit pas «l'absence de normes ou d'organisation stable», mais induit nécessairement le sentiment d'une telle absence, d'où le «désarroi qui en résulte chez l'individu». J'en parlais précédemment, c'est la conjonction d'un déphasage important entre infrastructure et superstructure et le déphasage entre situations locales et situation globale qui génère ce “sentiment anomique”, qu'il se vérifie ou non dans les faits – en France et en 2020, contrairement à ce qui se passe par exemple en Syrie ou au Congo ex-belge, il n'y a ni absence de règles ni absence de régulations, ce qui n'empêche un discours parcourant toute cette société sur une supposée absence des unes et des autres. Que ces règles et régulations soient en partie au moins mal conçues ou/et mal réalisées est assez probable, mais elles existent. C'est beaucoup plus ce “sentiment anomique” qu'une réelle anomie qui induit le désarroi. Le texte qui me semble très bien décrire la chose, et que je cite plusieurs fois dans ces billets, est celui-ci:
«Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc.
Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces.
Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres;
car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l’ornement du temple, Jésus dit:
Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver?
Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: C’est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.
Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Alors il leur dit: Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume;
il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.
Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom.
Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense;
car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.
Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous.
Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.
Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;
par votre persévérance vous sauverez vos âmes.
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche.
Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville.
Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple.
Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,
les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres.
Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme» (Luc, 21, 1-36, traduction Segond 1910).
Ou dans une autre traduction:
«Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le Trésor.
Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait deux piécettes,
et il dit: "Vraiment, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus qu'eux tous. Car tous ceux-là ont mis de leur superflu dans les offrandes, mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre."
Comme certains disaient du Temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives, il dit:
"De ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée bas."
Ils l'interrogèrent alors en disant: "Maître, quand donc cela aura-t-il lieu, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver?"
Il dit: "Prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront: C'est moi! et Le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne vous effrayez pas; car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas sitôt la fin."
Alors il leur dit: "On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines; il y aura aussi des phénomènes terribles et, venant du ciel, de grands signes.
"Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon Nom, et cela aboutira pour vous au témoignage.
Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense: car moi je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire.
Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis; on fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies!
"Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas; car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit.
Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! "Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens.
"Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots; des hommes défailliront de frayeur, dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire.
Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche."
Et il leur dit une parabole: "Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-mêmes, en les regardant, que désormais l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le Royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
"Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet; car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre.
Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme."». (Évangile de Luc, 21, 1-36, traduction Bible de Jérusalem)
Le passage notable figure dans une chanson de 1969 due à Mouffe et Robert Charlebois (avec l'aide des évangélistes Jean et Luc), La Fin du monde: «Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements ne vous effrayez pas, il faut que ces choses arrivent d'abord, mais ce ne sera pas sitôt la fin». Les bruits de guerres et parfois même les “situations de guerres et de soulèvements” ne sont pas toujours l'indice de guerres ni de soulèvements. Pour exemple les trois “guerres” proclamées par ma société ces deux ou trois dernières décennies, l'une déjà ancienne, la “guerre contre le terrorisme”, l'une très récente, la “guerre contre la pandémie”, et l'une déjà un peu ancienne mais somme toute assez récente, et jamais vraiment déclarée en bonne et due forme, la “guerre contre le climat”. Faut dire, mener une guerre contre le climat apparaît très vite une impossibilité dès lors qu'on l'énonce, aussi irréaliste, je ne sais pas, que par exemple une “guerre contre le sens de rotation de la Terre”: même si on constate une évolution du climat qui semble défavorable à l'humanité, aucune action concertée de “lutte contre le changement climatique” même de la plus grande ampleur n'est en situation d'influer de manière significative sur l'évolution du climat dans un temps significatif, disons, une ou deux générations. Autant il est relativement aisé de contribuer à un changement climatique qui “va dans le sens de la vie”, autant il est impossible de le faire dans le sens contraire. En fait, la seule manière d'agir sur le climat est de ne pas agir. Et ça ne peut avoir un effet possible mais non certain qu'à long ou très long terme. Ne pas agir, il faut s'entendre: non pas cesser d'agir absolument mais cesser de le faire de la manière qui contribue supposément au changement climatique supposément indésirable. Encore une précision, “qui contribue supposément” et “supposément indésirable” n'induisent pas que je réfute la cause anthropique du “réchauffement climatique” ni que je ne suppose que certaines évolutions du climat sont, en certains lieux, plutôt défavorables aux humains, à leur existence et à leurs activités, cela posé, d'une part l'impact des humains sur l'évolution du climat ne peut qu'être très limité, simplement ça se situe dans une frange qui les concerne directement d'où ce sentiment d'impact fort que l'observation ne confirme pas, et pour le second point, il n'existe pas de “climat désirable”, il existe une adaptation des humains et de leur milieu à une variation moyenne des conditions climatiques dans un contexte donné, dès qu'il y a un écart significatif, marqué notamment par un changement aisément mesurable, réchauffement ou refroidissement, c'est d'évidence indésirable dans l'immédiat, mais si ce changement persiste et reste dans une moyenne acceptable, les humains et leur milieu s'adapteront, ils l'ont déjà fait plusieurs fois au cours des temps.
Donc, quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements ne vous effrayez, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Un truc de prophète, cette déclaration: prévoir le prévisible. Quand une situation devient incertaine, prévisiblement on “cherchera des signes” et savez-vous? On les trouvera. C'est ainsi, qui cherche trouve, pas toujours ce que cherché certes, mais qui cherche trouve, et quand ce qu'on cherche est de l'ordre du certain, on le trouvera avec certitude. Vous avez connu des époques sans qu'on entende parler de guerres et de soulèvements? Moi non. Donc il est certain que dans les temps à venir, quel que soit le moment où on le prédit, on en entendra parler. Dans les époques, disons, “optimistes”, ces bruits sont faiblement inquiétants, même quand les situations que ces bruits pointent ne sont pas des petites choses et les conséquences de ces événements assez graves; et à l'inverse, dans celles “pessimistes” tout bruit même le plus infime pour toute situation même la moins grave apparaît effrayant. N'ayant pas une mentalité de “prophète” j'évite de me faire l'apôtre du pire qui prélude au meilleur. Disons, je fais la même hypothèse que le nommé Jésus: à coup sûr vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, en fait vous en entendez déjà parler, ce qui semblera effrayant, mais il fait ses garder d'être effrayé car “notre délivrance est proche“, pour le dire plus trivialement, «après la pluie le beau temps», tout ça finira par se tasser. Et je fais le même pronostic, en tout cas je l'ai fait:
«Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots; des hommes défailliront de frayeur, dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées».
Eh! En ces temps ce n'est plus un pronostic mais un fait avéré. Pour le redire, quand on cherche on trouve, donc chercher «des signes dans le soleil, la lune et les étoiles» et n'importe où ailleurs “confirmant” l'anticipation du pire, c'est les trouver. Et, les nations sont dans l'angoisse, sont «dans l'attente de ce qui menace le monde habité». Vous l'aurez constaté, les discours catastrophistes, “collapsologistes”, les discours sur l'effondrement (le terme “collapsologie” est basé sur le mot anglais «collapse», un calque du latin collapsus, «affaissement, écroulement», et signifie en anglais «éboulement, effondrement, écroulement, renversement», c'est donc «la science de l'effondrement»). La collapsologie n'est pas une science, c'est le discours sophiste habituel dans les périodes de transition, on “cherche les signes”, ceux que l'on peut trouver dans le soleil, la lune, les étoiles et un peu partout, et on les trouve, mais une fois qu'on les a trouvés, on trouve aussi des “solutions” qu'on n'a pas vraiment cherchées, on les a croisées sur son chemin, elles semblent correspondre aux problèmes, donc on dira que ce sont les solutions à ces problèmes. Or, comme le dit la sentence prêtée à Henri Queuille, «Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout» (l'attribution semble ici exacte).
On trouvera une discussion intéressante de ce propos sur une page intitulée justement «Il n’est pas de problème qu’une absence de solution ne finisse par résoudre…», avec cependant cette limite que l'auteur, pour des raisons... Passons sur les raisons: avec cette limite que selon lui, “l'équation”, le problème, «se simplifie alors dans la douleur, voire dans le sang». L'absence de solution à un problème le simplifie, et si sa résolution se passe souvent “dans la douleur” ce n'est pas toujours le cas, quoi que je pense de cette solution à ce problème, au milieu de la décennie 1950 les institutions de la France se sont trouvées confrontées à un problème complexe et apparemment insoluble, et si elle ne se fit pas sans heurts la solution trouvée ne se fit pas dans la douleur et dans le sang (je ne parle pas du contexte local algérien, bien sûr, mais la situation préexistait et trouva tout de même sa solution assez vite), et de la manière la plus simple car, en absence de solutions antérieures pérennes, le problème s'était considérablement simplifiée: si les institutions se révèlent incapables de résoudre une crise durable, on change les institutions. Factuellement, la V° République résulte d'une “révolution”, mais une “révolution de velours”, nettement moins violente que les révolutions antérieures en France. Il n'y a donc pas fatalité qu'une résolution “simple” à un problème complexe s'effectue dans la douleur et dans le sang, comme l'on dit, on apprend de ses erreurs, en 1958 les Français en avaient un peu (et même beaucoup) soupé des “solutions” violentes et sanglantes, entre les révolutions, contre-révolutions, guerres civiles et de frontières, ils avaient beaucoup donné au cours du siècle et demi précédent, et appris que parfois le remède peut être pire que le mal. Le trajet vers la démocratie est un long chemin assez escarpé...
Pour reprendre le cas du “changement climatique”, mais on en dirait autant du “terrorisme”, on a affaire ici à des effets et non de causes. Dans ces deux cas la cause en est un certain état des choses, une certaine organisation des sociétés qui induit des comportements favorisant des “dissidences” limitées mais violentes, et insolubles précisément parce qu'on traite non l'effet mais la cause, et de même les changements à cause anthropique dans le climat et dans la biosphère qui nous apparaissent défavorables et indésirables, et qui parfois le sont, découlent d'une manière d'organiser les processus sociaux, donc les structures permettant de les réaliser. Le “terrorisme” dans son acception actuelle (pour mémoire, à l'origine l'usage politique de “terreur” et de “terrorisme” désigne une pratique d'État, le mot “terrorisme” désigne la «politique de terreur pratiquée pendant la Révolution», pendant la Terreur, et non une pratique individuelle ou groupusculaire contre les États et institutions, on peut dire que l'expression figée, et de peu d'emploi en ce début de XXI° siècle, de “terrorisme d'État”, est pléonastique pour les penseurs de la Contre-Révolution: il n'y a pour eux de terreur que d'État, tout au plus peuvent-ils penser une “contre-terreur” s'opposant à la Terreur).
Excursus: Truismes.
Un truisme est une «vérité d'évidence», une «vérité trop évidente pour devoir être énoncée»; puisqu'il existe un terme pour les désigner, ça signifie qu'on les énonce, d'ailleurs le premier exemple donné par le TLF, «Pas de vie propre, créatrice, pour la pensée, sans indépendance: c'est un truisme que de l'affirmer», montre paradoxalement qu'un truisme n'est pas un truisme, qu'il n'y a pas de “vérités d'évidence”: pour l'auteur de cette phrase qualifier de truisme ce qu'il affirme est purement rhétorique, précisément, sophistique, présenter comme une évidence, un “fait de nature”, ce qui est une opinion Non que ça soit à coup sûr inexact, mais ce n'est pas démontré. Il y a même des exemples contraires, dans bien des contextes passés et présents la pensée créatrice requiert l'interdépendance, on peut donc le considérer, cette affirmation n'est probablement pas un truisme. L'autre exemple, «Il faut encore qu'il se rencontre un historien capable de les repérer et surtout de les comprendre. Cela pourrait passer pour un truisme, mais l'expérience montre que le rappel d'une telle évidence n'est peut-être pas inutile», montre à la fois qu'un auteur n'est pas toujours dupe de ses présupposés, et que celui-ci connaît bien les ressorts de la rhétorique mais n'en use pas comme moyen de convaincre sans prouver.
Il n'est pas de vérité d'évidence, sauf à prendre “évidence” comme un anglicisme, avec le sens de “preuve”, des vérités prouvées; en tout cas, toute vérité doit être énoncée car il n'est de vérité que de discours.Ce qui précède cet excursus n'est ni vrai ni faux, s'il y a les éléments factuels, qui sont vérifiables, notamment ce qui se rapporte à l'Histoire événementielle ou à l'évolution des entités politiques (même si on peut en contester l'interprétation dans ce billet, .les changements de régimes en France en 1848, 1852, 1871, 1940, 1944, de Constitution en 1875, 1946, 1958, sont des faits vérifiables), s'il y a les propositions qui ressortent du “sens commun”, celles qui, vraies ou fausses, font consensus, l'ensemble de mes propos est de l'ordre de l'interprétation, j'essaie autant que se peut de proposer des interprétations consistantes et qui évitent la sophistique, la recherche de l'adhésion par le sentiment et et la conviction plutôt que par raison et la réflexion, reste qu'en tant qu'interprétation ils ne sont donc ni vrais ni faux. Ce qui ne m'empêche, bien sûr, de pratiquer de temps à autre une forme de rhétorique proche de la sophistique, comme tout auteur je recherche une certaine adhésion chez mes lectrices et lecteurs, moins tant aux propositions qu'à la lecture même.
Ceci pour spécifier que s'il m'arrive, et il m'arrive, de qualifier certaines propositions, les miennes ou celles que je rapporte, de truismes, nécessairement c'est faux, car il n'y a pas de “vérités évidentes en elles-mêmes”. Toute “vérité” mérite d'être énoncée, et une fois énoncée mérite d'être vérifiée. J'essaie autant que possible d'éviter la sophistique car je ne recherche pas l'adhésion aveugle de mon lectorat, donc méfiez-vous de mes propositions quand elles ont les apparences de la “vérité d'évidence” et faites comme moi: vérifiez ce qu'on vous raconte.
Fin de l'excursus.
Puissance du non-agir.
Je ne discuterai pas ici du concept de non-agir, je l'ai déjà fait dans d'autres billets, explicitement ou non. Voir notamment le billet «444: L'ataraxie plutôt que le catastrophisme», qui comme l'indique le titre oppose le “catastrophisme”, donc dans sa désignation actuelle la “collapsologie”, à une autre approche de la réalité, “non catastrophiste”. Dans certaines philosophies antiques le terme “ataraxie”, se définissait ainsi:
«Tranquillité, impassibilité d'une âme devenue maîtresse d'elle-même au prix de la sagesse acquise soit par la modération dans la recherche des plaisirs (Épicurisme), soit par l'appréciation exacte de la valeur des choses (Stoïcisme), soit par la suspension du jugement (Pyrrhonisme et Scepticisme)».
Comme je le mentionne dans ce billet, ce sont des “philosophies du non-agir”, l'usage de cette expression, “non agir” ou “naishkarmya” ou “wuwei”, ne répond pas à une nécessité conceptuelle mais à l'usure locale de ces concepts: pour des raisons explicables les “philosophies de l'agir” sont beaucoup plus attractives que celles du non-agir, d'où la nécessité de rechercher de loin en loin des philosophies ou idéologies “exotiques” (éloignées dans l'espace ou/et dans le temps), pour provoquer, par l'attrait de la nouveauté et de l'étrangeté, une reviviscence des courants locaux du “non agir”. Dans plusieurs billets je convoque certains concepts et certains symboles “taoïstes” en précisant à chaque fois que l'on trouve les mêmes concepts et des symboles similaires dans toutes les traditions, et en expliquant parfois que l'usage du “taoïsme” dans le cadre de mon espace civilisationnel a moins tant rapport au taoïsme sans guillemets qu'aux traditions locales, notamment certains courants de la philosophie dite grecque, et de certains courants “juédéos” (les philosophies et les idéologies qui s'appuient sur la Torah, donc des courants “juifs”, “chrétiens” et “musulmans”, et leurs héritiers). Soit dit en passant, dans l'espace qu'on dira “européen”, qui correspond pour l'essentiel à l'Empire romain d'Occident, à l'origine ce sont des philosophies exotiques, “orientales”, quand certains évoquent «les racines chrétiennes de l'Europe» ils causent donc de racines superficielles, moins de deux millénaires, les racines profondes étant autres et remontant à bien plus longtemps. Et au départ le “christianisme” fut un des moments de reviviscence des philosophies du non-agir. Mais donc, comme les philosophies de l'agir ont plus d'attraits cette reviviscence n'eut qu'un temps et fut assez vite recyclée par les idéologies de l'agir.
Ce n'est pas d'hier que les philosophes et idéologues les plus pertinents nous l'expliquent: la manière la plus efficace de réduire le niveau de mal dans le monde est de ne pas lutter contre lui. S'opposer frontalement au mal c'est user des armes du mal donc augmenter le niveau de mal dans le monde. Un des traités les plus réputés de polémologie, de “science de la guerre” ou du conflit, L'Art de la guerre, s'articule sur la notion que la meilleure manière de mener une guerre est d'éviter le plus possible les engagements, de préférer ceux en défense qu'en attaque, et de choisir d'autres moyens de la mener que ceux de l'adversaire. Une logique qui vaut en tous domaines et toute circonstance: on ne résout pas un problème par les moyens qui en sont la cause.
L'ataraxie, l'absence de troubles, ne s'obtient pas par l'inaction, mais par une action dirigée vers soi-même. Pour un cas concret en rapport à ce dont je ne vais pas tarder à discuter, le “changement climatique”, et ce qui va avec, la destruction des écosystèmes, la réduction de la biodiversité, la plus simple et plus efficace manière de ne pas y contribuer est... de ne pas y contribuer. De ne pas agir d'une manière qui participe des causes anthropiques contribuant à ce changement. De ce point de vue, toute solution “technoscientifique” et “productiviste” de “lutte contre le changement climatique” est d'avance vouée à l'échec. Ça ne signifie pas que ces solutions seront inefficaces en soi ni même qu'elles ne permettront pas de réaliser à terme l'objectif “ne plus contribuer” au changement climatique à cause anthropique, etc. La vie est extrêmement résiliente, et là j'emploie le terme au sens physique, non au sens psychologique ou social, précisément la résilience “dans le domaine élastique”, même si à un niveau local celle “dans le domaine plastique” est à considérer: elle peut subir une déformation très importante mais quand elle atteint ses limites de tolérance elle ne casse pas, elle “revient à l'état initial”.
La biosphère est un écosystème, donc constituée de deux ensembles, le biotope, qui constitue sa structure, et la biocénose, qui constitue son processus. Comme dans tout système du vivant, “il y a du processus dans la structure et de la structure dans le processus”: toute la part biotique participe de la biocénose et toute celle non biotique du biotope, mais en permanence la biocénose convertit du biotope en biocénose et en permanence le biotope absorbe de la biocénose, les choses “naissent” et “meurent”. Le système dans son ensemble reste identique à lui-même (entre l'époque de l'émergence de la lignée humaine, il y a environ sept millions d'années, et ce jour, il n'y a pas eu de changement significatif de l'ensemble du système Terre-Lune, ni de l'espace dans lequel se déploie l'écosystème global, la biosphère), en revanche la répartition entre biotope et biocénose a connu des variations parfois très importantes et la répartition des individus et des espèces de profondes modifications. L'entropie étant la règle dans l'univers, tout ce qui va contre la règle ne peut s'en écarter de manière trop importante. Je n'ai pas une compréhension téléologique ou eschatologique de la vie ni de l'univers, je ne m'intéresse guère aux causes premières ni aux fins dernières, de ce fait je ne puis supposer un “but de la vie” déterminé, un “sens de la vie”, en revanche je constate la vie, ne serait-ce que parce que j'en participe, et constate que depuis qu'il y a de la vie sur la Terre, elle a un but: se préserver. Pour y parvenir elle doit se maintenir dans une frange étroite de “contravention à la règle”, de néguentropie: en-deçà son mouvement propre cesserait, au-delà aussi, dans le premier cas par ralentissement excessif, dans le second par accélération excessive.
Le non-agir, l'ataraxie, est une attitude qui consiste à tenter autant et aussi longtemps que se peut de rester dans cette marge étroite. Si un sous-système, un écosystème local ou un individu, n'y parvient pas, il meurt, mais au niveau global ça n'arrive pas, du moins ça ne s'est pas produit au cours des environ quatre derniers milliards d'années et en toute hypothèse ça ne devrait pas se produire au cours des environ quatre à cinq milliards d'années à venir. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe extérieure qui anticiperait cette fin inéluctable, il se peut qu'au cours des cinq milliards d'années à venir un bolide d'une masse et d'une vélocité suffisantes percute la Terre et la transforme en une nouvelle ceinture d'astéroïdes, en revanche aucune catastrophe intérieure n'est susceptible d'un tel résultat, la vie ne peut pas tuer la vie pour une raison assez simple: aucune espèce n'est en capacité de mobiliser suffisamment d'énergie ou de matière pour parvenir à ce résultat. Prenez le cas d'une des hypothèses “collapsologiques” antérieures, la Mort Nucléaire, la destruction de toute vie sur Terre en cas de “guerre atomique” (version initiale, avec la bombe A) ou de “guerre nucléaire” (version seconde avec la bombe H). Dans une rubrique intéressante de Wikipédia, «L'Oracle», suite à une question sur le sujet, il y eut cette réponse:
- «Vitrification
- Bonjour Oracle. J'ai lu quelque part que l'arsenal atomique US permettrait de « vitrifier la planète » : Qu'en est-il vraiment, quelle surface peut-on vitrifier avec l'arsenal existant ? Eh nah? (discuter) 19 octobre 2013 à 12:32 (CEST)
- En tout état de cause, au mieux une trentaine de pourcent de sa surface, les terres émergées. Olivier ♦ Hammam 19 octobre 2013 à 12:39 (CEST)
- Non, beaucoup moins que ça - de l'ordre de 0,05 % de la surface des terres émergées. On peut voir sur ce site les rayons d'actions des différents types de bombes, d'autre part on lit dans Arme nucléaire que « En 1982, on estimait qu'il y avait environ 50 000 armes nucléaires dans le monde totalisant entre 12 000 et 14 000 mégatonnes » ce qui fait en moyenne 50.000 armes de l'ordre de 300 kt. Ce chiffre de 300 kt est un bon ordre de grandeur : des armes plus puissantes causent individuellement beaucoup plus de dégâts, mais la surface détruite par kt est moindre, parce qu'il y a une sur-destruction au centre. Inversement, à énergie égale, plus de petites armes causerait plus de dégâts en terme de km², mais représenterait un coût énorme parce que le coût d'une arme nucléaire ne dépend que faiblement de sa puissance. La zone de destruction d'une arme de 300 kt est de l'ordre de 200 km², donc si tout l'arsenal de 1982 (où il était au maximum) était dispersé de manière homogène sur un territoire, il y aurait de quoi détruire en gros 10.000.000 km². Les États-Unis ont une superficie de 9 629 048 km², donc c'est à peu près suffisant pour détruire totalement les USA, mais ça fait loin du compte pour la planète entière : les USA ne font que 6,3 % du total des terres habitées d'après Liste des pays et territoires par superficie. Le « bon » élément de comparaison, c'est que ça permet en gros de détruire toute la surface urbanisée du globe, mais en laissant les campagnes intactes. Ceci étant dit, s'il s'agit de vitrifier le sol, ça demande de le porter à des températures de plus de 1000 °C, donc le simple rayon de destruction ne suffit pas. La vitrification stricto sensu ne concernera au mieux que la zone couverte par la boule de feu, c'est-à-dire une surface de l'ordre du km² par tête. L'arsenal mondial de 1980 pouvait vitrifier un territoire de l'ordre de 50.000 km², 250x200, à peu près un territoire grand comme l'Irlande. De l'ordre de 0,05 % de la surface totale, donc. Et les irradiations, dans tout ça, me direz-vous ? En fait, l'irradiation directe ne concerne en pratique que des lieux qui sont déjà au départ dévastés par le souffle de l'explosion et grillés par les rayonnements thermiques, donc ça ne change pas grand'chose au résultat final. Dans le Bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki il y a eu de l'ordre de 200.000 morts, mais le syndrome d'irradiation aiguë n'a été constaté que pour 5 à 15% des décès, sur des victimes souvent fortement traumatisées par ailleurs (la cause de la mort est donc probablement multiple). Si les explosions sont faites trop près du sol (ce qui ne va pas dans le sens d'une efficacité militaire maximale, et tend donc à être en réalité évité), des retombées nucléaires peuvent faire plus de victime à longue distance, comme le montre l'accident de Castle Bravo. Mais les niveaux mortels ne concernent que des zones limitées, et ne sont atteints que quelques jours. Après ~ un mois, il n'y paraît plus, les « zones radioactives interdites à jamais aux générations futures » sont des fantasmes de science-fiction. En même temps, un bombardement massif de ce type déclencherait des Tempête de feu qui vitrifierait probablement le sol, donc la surface urbanisée de tout à l'heure se transformerait peut-être en désert vitrifié. Mais c'est impropre de considérer que la vitrification serait due aux explosions atomiques, parce que l'énergie correspondante viendrait en réalité de la combustion des matières locales, pas de l'explosion proprement dite ; c'est comme si on disait qu'une allumette suffit à vitrifier une forêt - en un sen c'est pas faux, mais ça ne reflète pas du tout l'énergie de l’allumette, plutôt l'inflammabilité de la forêt. Mais même en prenant cette interprétation, on ne « vitrifie » que les 6.3% de tout à l'heure, donc plus de 90% des surfaces (montagnes, plaines,...) ne sont pas directement concernées par ces explosions. C'est déjà un bon argument pour vivre à la campagne, et si l'urbanisation concerne 50% de la population en 2000, ça veut dire que la moitié de la population a des chances très raisonnables de survivre dans l'immédiat à une telle apocalypse. Ceci étant, les survivants n'auront pas dans un sort très enviable. D'une part à moyen terme, évidemment, l'anéantissement de tout le tissu industriel et urbain fait qu'ils seront condamnés à vivre à l'âge de la pierre faute de moyens leur permettant de produire autre chose comme outils et comme source d'énergie (vous savez domestiquer une vache, vous?). Ce serait suffisant en tout cas pour anéantir la civilisation (pas l'humanité, même si c'est une piètre consolation). Mais surtout d'autre part, à court terme, la suie dégagée par la Tempête de feu ci-dessus entraînerait un obscurcissement massif et durable du ciel, donc un hiver nucléaire voire peut-être un effet suffisant pour déclencher une petite ère glaciaire artificielle. L'article en:Nuclear winter est assez ... refroidissant sur ce sujet. Bref, si l'arsenal nucléaire est insuffisant pour vitrifier la planète, il est probablement suffisant pour la congeler. C'est peut-être pour ça que la course aux armements a été appelée la guerre froide, en fait ... Cordialement, Biem (discuter) 20 octobre 2013 à 11:08 (CEST)».
Par honnêteté je donne toute la section, y compris ma réponse, d'une pertinence limitée (même si sensée).
Les humains ont raison de craindre que par leur action dans le monde il peuvent le détruire, mais ils se trompent sur l'ampleur et la durabilité d'une telle destruction: ils peuvent détruire leur monde, détruire leur tissu social et directement ou indirectement une part non négligeable de leur propre population ainsi que de la population des espèces domestiques, mais non détruire tout le monde du vivant. Disons, ils peuvent produire artificiellement ce qui s'est produit spontanément plusieurs fois dans le passé, une «destruction massive des espèces», les fameuses “extinctions massives”. Lisant l'article vous verrez que cette notion d'“extinction massive” est très relative, il s'agit pour l'essentiel d'«extinctions massives d'organismes multicellulaires», ce qui a donc un effet limité sur les unicellulaires, spécialement les bactéries, à quoi s'ajoute que la durée de ces “extinctions” est longue et s'accompagne d'une “émergence” qui voit une diversification et une multiplication d'espèces jusque-là contraintes dans leur développement par la présence des espèces le plus atteintes par ces extinctions, qui au début du processus sont les espèces dominantes: il y a 66 millions d'années le phylum dominant parmi les vertébrés terrestres est celui des dinosauriens; leur disparition (sauf la lignée “aviens”) eut pour conséquence rapide une diversification dans un autre phylum jusque-là bloqué dans son évolution par la domination des dinosauriens, les mammifères. Pour citer l'article, partie «Histoire évolutive»:
«À la fin du Crétacé, durant le Maastrichtien, on n'a recensé jusqu'ici que 150 à 300 espèces de mammifères regroupées dans 27 familles, dont une dizaine de familles de marsupiaux, et une dizaine de placentaires. Alors que les dinosaures disparaissaient massivement, les mammifères placentaires et marsupiaux connaissaient une explosion radiative majeure sans équivalent dans l'histoire des mammifères».
Le “masstrichtien” va de -72Ma (millions d'années) à -66Ma, dit autrement, cette “extinction massive” est très relative: les autres types de sauriens, les batraciens et une bonne part des lignées de vertébrés marins n'ont pas subi d'extinction massive et dans le temps même où les dinosauriens “systémiques” disparaissent les mammifères prennent la même voie et deviennent “systémiques”. Enfin, comme mentionné les dinosauriens n'ont pas vraiment disparu, on sait désormais que les aviens, les “oiseaux”, sont une branche des dinosauriens. On peut faire l'hypothèse que cette branche a du sa survie au fait que les mammifères n'ont pas aussi vite et autant occupé cette “niche écologique” que constitue le ciel, contrairement à la terre et aux océans et fleuves. Bref, les “extinctions massives” ressemblent plus à une modification des écosystèmes qui défavorisent certaines lignées, n'en atteignent pas ou que peu d'autres, et en favorisent certaines. Ça ne signifie pas qu'on n'ait assisté à certains moments à une baisse significative des populations, mais les écosystèmes sont très résilients, là selon l'acception concernant les espèces, la «capacité de reproduction d'une espèce animale inemployée en raison d'une ambiance hostile, mais susceptible d'une expansion soudaine si cette ambiance s'améliore».
Après la néguentropie l'entropie.
Et bien sûr, après l'entropie la néguentropie. L'univers tend à l'entropie. Dans certains contextes limités dans l'espace et le temps il peut “s'organiser”, soit passivement (systèmes planétaires ou stellaires, galaxies...), soit activement (cas de la vie sur la Terre). Un contexte qui “fait système” instaure un équilibre dynamique, ses éléments interagissent pour le faire évoluer lentement et de manière dirigée; dans les systèmes passifs cette évolution est assez prévisible pour un assez long temps même si localement, dans des sous-systèmes, il peut y avoir des interactions assez erratiques. Je ne sais pas pour vous mais moi je vis dans un univers assez complexe et plus ou moins prévisible. Il y a des niveaux où il est entièrement imprévisible, celui de plus grande extension et ceux de moindre extension, les infiniment grand et petit; entre les deux ça varie. Enfin, pas si évident que ça varie, comme dit l'univers est fractal, ce qui vaut à un niveau vaut au niveaux inférieurs et supérieurs.
L'univers a bien des caractéristiques, entre autres il est stochastique, quand on en considère une fraction on ne peut déterminer son évolution dans le passé et l'avenir que pour un certain temps car elle est en interaction avec le reste de l'univers donc sous l'influence directe ou indirecte du mouvement d'autres fractions de l'univers. Sous un aspect l'univers est causal car tout mouvement est la conséquence d'un mouvement antérieur, sous un autre aspect il est non causal car tout mouvement est la conséquence de plusieurs causes, ce qui rend à terme ses évolutions imprévisibles, aléatoires, “de cause indéterminée”. L'univers étant fractal cette imprévisibilité est la même à tous niveaux mais sa temporalité diffère: au plan humain, perceptivement l'évolution d'un atome, d'une molécule, est extrêmement rapide donc extrêmement peu prévisible, celle d'un système stellaire, d'une galaxie, extrêmement lente donc extrêmement prévisible, factuellement le “niveau d'imprévisibilité” est à-peu-près le même à tout niveau mais dans des durées différentes. Pour vous et moi le système solaire est remarquablement stable car son évolution se mesure en centaines de millions d'années avant d'observer des changements significatifs, le système que constitue une molécule remarquablement imprévisible car son évolution se mesure en durées très inférieures à la seconde, reste que le système solaire est dans sa temporalité tout aussi imprévisible que la molécule, mais que ça échappe à nos capacités d'observation.
Ce qui nous concerne directement est d'une temporalité très inférieure à celle d'un système stellaire, très supérieure à celle d'un système moléculaire, les évolutions sur lesquelles nous avons une petite capacité d'intervention se mesurent en jours, siècles, au plus millénaires, avec assez vite un niveau important d'imprévisibilité dès qu'on dépasse, selon la fraction considérée, quelques semaines à quelques lustres. En outre ces fractions d'extension diverses ont des temporalités très diverses, donc un niveau de prévisibilité contrasté, et sont en interaction. L'entropie, la tendance à la désorganisation, est la règle, la néguentropie respecte cette règle car celle-ci est intangible, quoi qu'on puisse en croire tout système isolé tend à l'entropie mais, comme précédemment discuté, les systèmes qui nous intéressent au premier plan, les systèmes du vivant, ne sont pas réellement des systèmes isolés, factuellement ils ne réduisent pas le niveau d'entropie, on peut décrire leur action comme une “organisation du désordre”. Je cite ici de nouveau la partie «Exemple et application» de l'article de Wikipédia sur la néguentropie:
«
Interprétation en termes d'énergie
En prenant l'exemple d'une cellule, on peut voir la vie comme une forme de néguentropie. Elle tend à conserver sa néguentropie, c’est-à-dire une organisation, une structure, une forme, un fonctionnement, et cela grâce à la consommation d'énergie, venant de l'extérieur de la cellule. Une cellule morte n'entretient plus cette néguentropie, donc elle se désagrège.
Interprétation en terme d'information
Ce qui rend possible le maintien d'une structure “ordonnée” (capable de s'adapter en permanence à un environnement changeant), ce sont les voies de communication sélectives entre le corps de la cellule et son environnement. Les membranes des cellules sont poreuses, mais seulement de façon sélective; si une cellule perd cette capacité de sélection dans ses échanges avec son environnement, elle meurt rapidement, notamment sous l'effet de toxines dont elle ne peut plus se protéger.
À une échelle beaucoup plus large, la planète Terre n'est pas un système isolé: elle reçoit de l'énergie, essentiellement solaire, en réémet une partie vers l'univers, et, au passage, une partie est captée par les formes de vie sur Terre, contribuant à donner cette vision de néguentropie présentée par Schrödinger».
L'apport d'énergie dans un système du vivant devrait augmenter son niveau d'entropie, et ce serait le cas si c'était un système parfaitement isolé, donc pour lequel toute interaction, au mieux n'aurait pas d'effet sinon le désorganiserait en partie ou en totalité; comme c'est un système semi-fermé ou semi-ouvert il émet à-peu-près autant d'énergie qu'il en reçoit, factuellement il “reçoit des causes d'entropie” et “émet des effets d'entropie”, mais de telle manière que localement, dans le cadre du système formellement isolé qu'il constitue, la circulation de l'énergie s'effectue d'une manière dirigée réduisant ou maintenant le niveau d'entropie dans les limites de ce système. On peut dire que la vie est une sorte de jeu de billard, le système dispose des points perméables sur sa périphérie de telle manière que l'énergie extérieure à laisser entrer sera dirigée vers un récepteur qui la diffusera d'une manière prédéterminée, et que celle intérieure à laisser sortir sera dirigée vers un point de perméabilité prédéterminé. Le problème, à long terme, étant que le “niveau d'entropie périphérique“, celui des systèmes contigus, augmente, jusqu'au point où ce système perméable ne sera plus en état de réguler son niveau d'énergie. Ou qu'au contraire ce niveau d'entropie baisse en-dessous d'un seuil minimal permettant au système de maintenir sa structure. Pour rappel, dans les systèmes du vivant “énergie” et “processus” sont des quasi-synonymes: trop d'entropie accélère excessivement le processus interne, pas assez d'entropie le ralentit excessivement, dans les deux cas la conséquence en sera l'effondrement de la structure par excès ou insuffisance d'énergie. La mort de la cellule dans l'exemple proposé.
Excursus: Non à la pédagogie!
Ce billet ne vise pas à vous expliquer la vie et vous dire “ce qu'il faut faire”. Il a certes un aspect “éducatif”, j'essaie de donner des éléments de réflexion sur la réalité dans la limite de mes moyens, et bien sûr j'ai une visée propagandiste, diffuser un discours que je suppose favorable à ma conception de ce qu'est une société souhaitable, mais ne comptez pas sur moi pour vous inciter à considérer cette conception comme “la bonne”. Souvent mes excursus visent à cela: prévenir mes lectrices et lecteurs du fait que mes propositions ne sont pas des solutions mais des éléments de réflexion pour, dans la limite de mes moyens toujours, aider mon possible lectorat à développer sa propre réflexion. Mort aux pédagogues! Pour le plaisir du débinage je vous cite ici toutes les acceptions du terme dans la partie A de l'article du TLF:
«1. ANTIQUITÉ. Esclave chargé de conduire les enfants de son maître à l'école; par extension, à Rome, précepteur chargé de l'instruction d'un enfant de famille riche [...].
2. Vieilli ou littéraire.
a) Maître d'école ou précepteur chargé de l'éducation d'un ou de plusieurs enfants [...].
b) Péjoratif. Maître autoritaire et étroit d'esprit. Synonymes. magister (péjoratif), pédant (péjoratif) [...]
3. Par analogie, péjoratif vieux ou littéraire.
a) Personne qui fait étalage de son érudition [...].
- Emploi adjectival. Synonymes. doctoral (péjoratif), dogmatique, magistral, pédantesque (littéraire), prétentieux, sentencieux (péjoratif) [...].
b) Personne qui s'arroge le droit de censurer les autres»
Ça donne tout de suite envie de se prétendre pédagogue. Ne prenant pas mes possibles lectrices et lecteurs pour des enfants, y compris quand ce sont des enfants, je me garderai bien de faire de la pédagogie. Enseigner je veux bien, formater les esprits, non. Non que ça me préserve du pédantisme ou du dogmatisme, ni d'être prétentieux ou sentencieux, mais autant que possible j'évite d'être autoritaire et étroit d'esprit.
Fin de l'excursus.
Après la néguentropie l'entropie. (suite)
Et donc, après l'entropie la néguentropie. Comme expliqué juste avant l'excursus, la néguentropie n'est ni le contraire ni l'opposé de l'entropie mais en est un cas. L'univers tend à l'entropie mais localement il s'organise, il maintient des systèmes relativement isolés et stables; il ne sont pas proprement non entropiques ou anti-entropiques mais ont un niveau d'entropie légèrement différent de celui de leur environnement. Tout système relativement isolé a une durée déterminée, a un début et une fin; au début il s'organise, à la fin il se désorganise, entre les deux la circulation des énergies dans le système lui permet de maintenir son niveau d'entropie dans des limites qui préservent sa structure, mais dès que ce niveau dépasse certaines valeurs il se désagrège. Parfois violemment et rapidement, parfois tranquillement et lentement, il “explose” ou il “s'éteint”. Comme dit en ce qui concerne l'anomie, perceptivement l'effet de l'explosion ou de l'extinction se vaut, tel qu'on peut l'anticiper. Une étoile comme le Soleil est du type destiné à “s'éteindre”, d'autres, comme T Pyxidis ou comme T Aurigae, qui sont en fait des étoiles doubles avec une “naine blanche” et une (potentielle) “géante rouge”, se désorganisent (pour parfois se réorganiser et de nouveau se désorganiser plusieurs fois) en nova, donc par un phénomène explosif, mais dans les deux cas il y a une expansion de l'étoile qui a des caractéristiques “explosives” pour leur milieu: une nova se désorganise par excès d'énergie, une étoile comme le Soleil par insuffisance d'énergie, dans les deux cas la cohésion de l'étoile est compromise, en périphérie elle s'échauffe et elle se dilate puis se désagrège en s'étendant assez brusquement, ce qui pour les planètes qui gravitent autour a la même conséquence: ça les grille et pour les plus proches, ça les détruit.
L'entropie est l'état global de l'univers mais localement c'est un des deux états possibles. Comme le mentionne l'article de Wikipédia,
«On parle dans l'étude de système dynamique de “dysentropie”. Dans un tel système, une néguentropie partielle mène à un état d'auto-organisation de niveau supérieur par un phénomène de percolation».
Si vous n'êtes pas connaisseur des systèmes dynamiques vous n'avez pas tout compris? Moi non plus, ou moi aussi, mais ça importe peu, je cite ce passage à cause du terme “dysentropie“, qui me convient mieux que “néguentropie”. Le préfixe “dys-” indique, nous dit le Wiktionnaire, «une anomalie de formation, un mauvais état [...], une difficulté ou un mauvais fonctionnement»; une dysentropie est donc dans cette approche “une entropie en mauvais état, qui fonctionne mal”, non le contraire de l'entropie mais une “entropie dysfonctionnelle”, un cas particulier d'entropie. Pour vous et moi, qui sans la néguentropie ou dysentropie ne serions pas ce que nous sommes, des êtres vivants, cette entropie non standard fonctionne assez bien,, du moins le temps qu'elle fonctionne, mais à un niveau plus large c'est bien ce que l'on voit, une “entropie qui fonctionne imparfaitement”. On peut dire que la vie tire profit de dysfonctionnements dans le tissu de l'univers pour organiser dynamiquement, activement, la circulation de l'énergie, pour l'organiser sciemment et à son profit. Je le disais aussi, je ne suppose pas un “but de la vie” en soi, mais constate que la vie a un but, local et transitoire, préserver son autonomie, “se mouvoir de son propre mouvement” le temps que ça peut durer. Pour les individus, même les plus durables, ce temps est court, de quelques secondes à quelques millénaires, pour les espèces il est plus important mais encore assez court, au plus quelques millions d'années, et si on ne tient pas compte de certaines modifications, quelques dizaines de millions d'années, pour la vie elle-même, et bien, celle qui nous concerne directement, la vie sur la Terre, est de beaucoup plus de durée mais a aussi ses limites, à coup sûr elle a commencé il y a environ quatre milliards d'années, et à coup sûr elle cessera dans au plus quatre à cinq milliards d'années. Bien sûr on peut imaginer sa dispersion dans des temps futurs mais ça sera autre chose, une vie extraterrestre, pour la vie sur cette planète où je rédige ce texte, elle aura une fin, au plus tard celle du système stellaire dans lequel s'insère le système Terre-Lune tel qu'il existe actuellement – la transformation du Soleil en “géante rouge” ne sera pas la fin de la néguentropie locale mais la fin de son organisation actuelle, celle favorable localement à l'apparition et la continuation de la vie. Donc, la vie a une extension nettement plus grande que celle des phylums, que celle des espèces et bien sûr que celle des groupes et des individus, mais nettement moins grande que celle de l'univers tel qu'on le connaît actuellement, au moins quatorze milliards d'années dans le passé et à coup sûr au moins autant, probablement beaucoup plus de temps dans le futur.
Il y a une chose à comprendre quand on saisit que la néguentropie est un cas particulier de l'entropie, un “nœud dans la toile”, un accident dans le tissu de l'univers: il ne faut pas jouer avec le feu. Enfin si, il faut jouer avec lui, mais de manière raisonnée, avec prudence et mesure.
Gérer la rareté, une économie de guère.
Remarque incidente: les options de mise en forme des billets de Mediapart sont pauvres. Ça me désole de n'avoir que les possibilités “
intertitre gris
”, “rouge petites capitales” et “bleu petites capitales” pour mettre en évidence les titres de sections. Je pourrais bien sûr tricher, rédiger mes textes dans un autre éditeur et les copier-coller (ça m'est arrivé pour des textes repris d'ailleurs) mais c'est fastidieux, donc je fais avec mais ça me désole... Bon ben, je reprends le cours de cette discussion en m'excusant pour cette mise en forme assez pauvre.
Rien de moins rare dans l'univers que l'énergie, il y en a partout. Elle se signale par un phénomène nommé “ondes électromagnétiques”. Comme j'en traite dans divers billets je ne développerai pas ici, ni ne reviendrai sur le constat que le phénomène en question n'est pas ondulatoire, que les “ondes” découlent d'une limite perceptive. Pour une discussion sur la question de l'onde, le billet «Addendum III à “Quand les choses doivent changer...”» me semble assez précis, pour l'électromagnétisme en général, pas de billets à recommander, c'est une question qui m'intéresse mais dont je ne peux dire que je l'ai traitée d'une manière approfondie dans le cadre de ce blog. Toujours est-il, l'électro-magnétisme “ondulatoire” est la preuve de l'existence de Dieu euh pardon! La preuve de l'énergie – pour Dieu, pas de preuves décisives, pas mêmes d'indices clairs et concordants. De l'autre bord, si Dieu est réellement partout et nulle part, alors c'est un synonyme de “énergie”...
Dans mon univers, a priori aussi le vôtre, la matière est rare, l'énergie abondante.
Bon, encore une modération: la rareté de la matière est discutable, si ce qu'on raconte des neutrinos est exact, ceux-ci étant censément les particules les plus élémentaires dans le cadre de l'actuel modèle standard de l'univers, en ce cas la matière ne serait pas si rare que ça, mais d'une telle intangibilité que ça ne change pas grand chose: contrairement à ce qui se passe avec lesdits neutrinos, la matière composite, les “nucléons”, les “électrons”, les atomes et tout ce qui est composé d'atomes, interagit beaucoup avec les ondes électromagnétiques. Disons qu'on a la preuve directe de l'existence du phénomène électromagnétique alors que la preuve de l'existence des neutrinos est toujours indirecte, donc ma proposition, «la matière est rare, l'énergie abondante», est exacte même si elle n'est pas vraie. Ce qui ne me gêne en rien: je préfère l'exactitude tangible à la vérité intangible.
Donc, dans notre univers, celui perceptible par vous et moi, la matière est rare, l'énergie abondante: quel que soit l'endroit de l'univers discernable dans lequel on se trouve on peut constater l'électromagnétisme, aussi rare soit localement la matière. En revanche, l'énergie utile est rare. Et doit être rare. Autant que possible j'évite de signaler en gras et italique des segments que j'estime importants donc je m'en excuse, si j'avais un vrai talent d'écriture je n'aurais pas à le faire, mais bon, je ne l'ai pas. L'énergie utile est celle qui permet à une entité du vivant de se préserver en tant que système autonome. L'entropie étant une conséquence de l'action de l'énergie sur la matière, un système du vivant doit autant que possible limiter ses interactions avec elle. On en revient toujours à la même considération: la néguentropie ou sysentropie est une manière de gérer l'énergie de telle façon qu'elle contribue à maintenir sa circulation dans le système dans des limites et dans des orientations qui tendent à établir un niveau d'entropie constant, “nul”. Entre guillemets car l'entropie n'est jamais nulle. De la maintenir dans un écart tel qu'elle ne contribue pas à la désorganisation du système. Trop ou trop peu d'énergie circulante et il se désagrège. Or, de l'énergie il y en a en veux-tu, en voilà! Et même si on n'en veut pas, la voilà. Pas toujours et partout mais en moyenne il y en a au moins assez et en général trop. Le titre de cette partie concerne ce dilemme: l'énergie n'est pas rare, elle est même en excès, or dans les limites d'un système du vivant elle doit apparaître rare. La plaisanterie de ce titre, «l'économie de guère», un calque de ce lieu commun, «l'économie de guerre», pointe cela: pour se maintenir une structure du vivant doit limiter autant que possible la circulation de l'énergie, avoir une «économie de la rareté», que l'énergie disponible soit abondante ou non. Ne pas admettre trop d'énergie dans le cadre du système, en veillant à ne pas trop limiter son admission. Vous et moi, et tout ce qui participe du vivant, est en “état de guerre permanent”, une guerre “contre le reste de l'univers”. Certes, une guerre perdue d'avance mais ça n'empêche d'essayer aussi longtemps et aussi bien que possible. Et en cas de défaite, il faut avoir une “position de repli” et des “réserves vitales”. Le gouvernement actuel en France, et beaucoup de gouvernements par le monde, ont raison, nous sommes “en état de guerre”. Mais ça ne change rien à l'ordinaire des choses, l'univers est antibiotique non par volonté mais par inertie puisqu'il tend à l'entropie.
La guerre c'est pas mon truc mais le vocabulaire de la guerre a son intérêt. En fait, ça m'ennuie que les “polémologues” usent de mes mots, moi qui suis plutôt “irénologue”, enfin, “iréniste”, qui suis plutôt de «ceux qui croient à la possibilité de la paix perpétuelle». Enfin non, je n'y crois pas, mais du moins le projet d'une paix perpétuelle me semble préférable à celui d'une guerre perpétuelle. Ce qui ne m'empêche de considérer que nous sommes dans un état de guerre permanent mais comme dit, de “guerre contre l'entropie”. Une guerre de guérilla, pour être précis, une “guerre du faible contre le fort”, de la dysentropie contre l'entropie. C'est là le point essentiel: une guerre du faible cotre le fort. Quand on est le faible il ne faut pas user des armes du fort. Quand on lutte contre l'entropie il ne faut pas y mettre “toute son énergie” car l'énergie engendre l'entropie, il faut au contraire réduire ses dépenses, se placer dans la position de “gérer la rareté”. Peu importe que l'énergie disponible soit importante et en quelque manière inépuisable, les systèmes du vivants ont une capacité limitée d'absorption de l'énergie utile, de l'énergie dont ils peuvent user dans le but de se maintenir. La supposée “épidémie d'obésité” qui avec l'évolution des discours est devenue “pandémie de l'obésité”, donc à la fois une maladie, en outre une maladie contagieuse, enfin une maladie qui menace toute la planète – enfin, tous les humains de la planète, il faut savoir mesure garder –, illustre le fait qu'un système biotique peut absorber une très grande quantité d'énergie, une quantité bien supérieure à ses besoins, mais que ça a une conséquence délétère: le dérèglement de ce système. Bien qu'il reprenne la propagande de l'OMS, l'article de Wikipédia ne manque pas de mentionner cette évidence:
«Statistiquement, un simple surpoids (surcharge pondérale) n'est pas source de maladies particulières, mais peut être un facteur d'aggravation d'une maladie, alors que l'obésité, en plus de son retentissement social et psychologique, est directement associée à des maladies, reflétant notamment l'excès de risque de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire.
En 1997, l'OMS a classé l'obésité comme maladie chronique, et a défini “le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé”. Sa prévention est un problème de santé publique dans les pays développés.
Cet état multifactoriel est considéré aujourd'hui par métaphore comme une pandémie, bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie infectieuse».
Souligné par Ma Pomme. L'obésité n'est pas une maladie infectieuse, et même, malgré la classification de l'OMS, n'est pas une maladie, c'est tout au plus, et pas nécessairement, un état «qui peut nuire à la santé». Comme précisé, c'est un «état multifactoriel», le principal facteur étant comportemental, et découlant à la fois d'un contexte favorable et d'un tropisme Le contexte est la disponibilité d'aliments favorisant le “surpoids”, la “sédentarisation” et une faible dépense d'énergie propre – se déplacer d'un point à un autre en automobile ou en scooter, ou même en trottinette électrique, est beaucoup plus coûteux en énergie que de le faire à pied, en patin à roulettes ou en vélo, mais moins coûteux en énergie propre. Le tropisme? La crainte du manque. Les humains sont des primates qui ont une longue histoire de conditions de vie précaires, pendant très longtemps une part essentielle de leur vie fut consacrée à la recherche et la consommation de nourriture, ce qui combinait une disponibilité moyenne de ressources énergétiques – de nourriture – faible et une forte dépense de cette énergie. Il y a relativement peu de temps, environ 10.000 ans, ils ont commencé à développer des techniques de gestion de leur espace qui leur ont permis de disposer beaucoup plus facilement de ressources alimentaires qui en outre favorisaient la prise de poids “de stockage”, de graisse. Pendant assez longtemps, en fait pendant presque toute cette période de dix millénaires, la grande majorité des humains a continué à beaucoup dépenser d'énergie propre, et même pour une part non négligeable d'entre eux, d'en dépenser plus qu'ils n'en gagnaient – disettes, famines... Ce n'est que très récemment, moins de deux siècles, que s'est enclenché un nouveau processus, qui permit à une part de plus en plus importante d'humains de disposer de toujours plus de ressources d'énergie, dont les ressources alimentaires, pour de moins en moins de dépense en énergie propre. Bref, l'obésité n'est pas tant une cause qu'un symptôme, celui de la persistance dans un contexte d'abondance d'un comportement valable dans un contexte de rareté.
De fait, et contrairement aux situations passées, “l'économie de guère” ne peut plus être un comportement “spontané”, un comportement adapté au contexte, parce que la rareté, c'est-à-dire l'indisponibilité d'énergie utile, appartient au passé pour une large partie de l'humanité. Ça ne signifie pas que toute l'humanité n'est plus dans un contexte de rareté, loin de là, en revanche cette “pandémie de l'obésité” indique deux choses: que les ressources sont mal réparties, et que les politiques publiques sont menées dans une conception “pénuriste”, avec en arrière-plan la peur du manque. Je l'évoquais dans un autre billet, «Économie de guère, économie de guerre», dont je vous donne ici l'introduction et le tout début:
«Je vis dans une société d'abondance où une part importante de la population vit dans le manque ou la peur du manque. Ce qui induit un sentiment de colère. Deux mauvaises conseillères... En fait, je vis dans une société gouvernée par deux instances qui nourrissent volontairement ces deux sentiments en “organisant la rareté”, ce qui en ce cas ne signifie pas la gérer mais la susciter, puisque donc je vis dans une société d'abondance».
Possible que la suite soit intéressante mais elle a un autre sujet, même si c'est plus ou moins en rapport avec celui de ce billet. En tout cas, le titre de ce billet comme son début montrent que ces questions, “organiser la rareté” et “économie de guère”, ne m'intéressent pas que d'aujourd'hui. Ici la question “gérer la rareté”, m'intéresse plus. Ça consiste en ceci: «Un humain ça s'empêche», dixit Albert Camus ou presque, chez lui c'est «Un homme ça s'empêche», une phrase qui peut-être vient de Montaigne. Ça s'empêche d'aller vers l'excès. Les slogans «No limits» et «No future!» sont deux versions d'un même projet, le nihilisme. Même si je l'ai mis en lien, ne pas trop considérer l'article de Wikipédia sur le nihilisme qui n'est pas tant un “relativisme” qu'une autre forme d'absolutisme, d'un côté l'absolutisme matérialiste, de l'autre l'absolutisme idéaliste, pour citer l'article du TLF, c'est en philosophie une «doctrine selon laquelle rien n'existe au sens absolu; [la] négation de toute réalité substantielle, de toute croyance»; donc, comme dit, une autre forme d'absolutisme, “rien n'est réel” plutôt que “il n'y a que le réel” – le réel matériel. Ça m'ennuie d'avoir évoqué le terme, ça m'ennuie de me retrouver du côté des philosophes, et spécialement du côté Schopenhauer, de Nietzsche, de Heidegger et de Leo Strauss. Tant pis, le mal est fait.
«Pas de limites!» et «Pas de futur!» convergent en ce que construire un futur ne peut se faire qu'en se fixant des limites, précisément pour préserver la possibilité d'un futur. Non que ledit futur ne puisse advenir sans qu'on le pense, mais ça sera un futur impensé justement, genre «Après moi le déluge!». Remarquez, je ne suppose pas que l'on doive procéder ainsi, si vraiment il l'a dit, Louis XIV avait raison. Après vérification, l'attribution à ce roi semble fautive, selon cet article du Wiktionnaire,
«L’expression après nous, le déluge est attribuée par le peintre Quentin de La Tour à Madame de Pompadour à l’adresse de son amant Louis XV lors de la défaite, le 5 novembre 1757 à Rossbach, des troupes franco-autrichiennes face à l’armée prussienne du Roi Frédéric II».
Donc, la Pompadour avait raison: après Ma Pomme l'univers disparaîtra, ou moi, en tout cas nous serons à jamais séparés, donc qu'importent les temps futurs? Eh! Un monde sans Ma Pomme, pourquoi le tenir en considération? Tout ça pour dire qu'il n'y a pas plus de logique ni de nécessité à préserver le futur, ou du moins à vouloir le faire, qu'à s'en contrefiche, qu'on le pense ou non il continuera, et sans nous. Certes je ne suis pas du genre à dire «après moi le déluge» mais j'admets que ce n'est pas la seule opinion valable, en fait “penser le futur” et “s'empêcher”, se fixer des limites, ça vaut surtout pour ici et maintenant, la leçon que je retiens du passé est que la modération et l'anticipation sont deux excellents moyens de préserver son propre devenir. Que ça constitue en outre un bénéfice pour mes successeurs en humanité peut (ou non) être un effet de notre comportement ici et maintenant mais à l'évidence ça ne peut en être la cause, si j'agis “pour le bien” en ce temps je ne peux en rien préjuger qu'à long terme ça bénéficiera à l'humanité pour la raison simple que de l'avenir je ne sais rien. Ce qui certes ne m'empêche d'y songer, et “pour le bien”.
Donc, l'obésité en tant que pandémie. Surtout, en tant que symptôme. Quoi de plus logique? Les membres d'une société “en surpoids” pour cause de dépense excessive d'une énergie externe et non biotique avec pour conséquence une rétention excessive de son énergie propre, tendent au “surpoids”. Il y a cette perception fausse d'un système, la société globale, qui “va de plus en plus vite”, et cette réalité observable: il y a de l'accélération mais pour faire du surplace. Il m'arrive de décrire le comportement des humains à celui d'un cycliste d'appartement le nez dans le guidon qui “accélère le mouvement” sans se rendre compte que ça ne contribue en rien à le faire avancer. Pour la société globale elle-même c'est encore plus caricatural: le vélo d'appartement est un vélo électrique, elle a ce sentiment collectif fallacieux de “dépenser son énergie” parce que le mouvement du pédalier est de plus en plus rapide, mais ce qu'elle dépense est l'énergie apportée par les centrales électriques – d'ailleurs, cette illusion actuelle d'une “voiture propre” parce que électrique et d'une “énergie propre” parce que non produite par une “énergie sale”, l'électricité dite renouvelable, va dans le même sens: ne surtout pas réduire la dépense d'énergie, alors même que le problème est la dépense d'énergie et l'augmentation du niveau d'entropie dans le système qu'elle induit.



