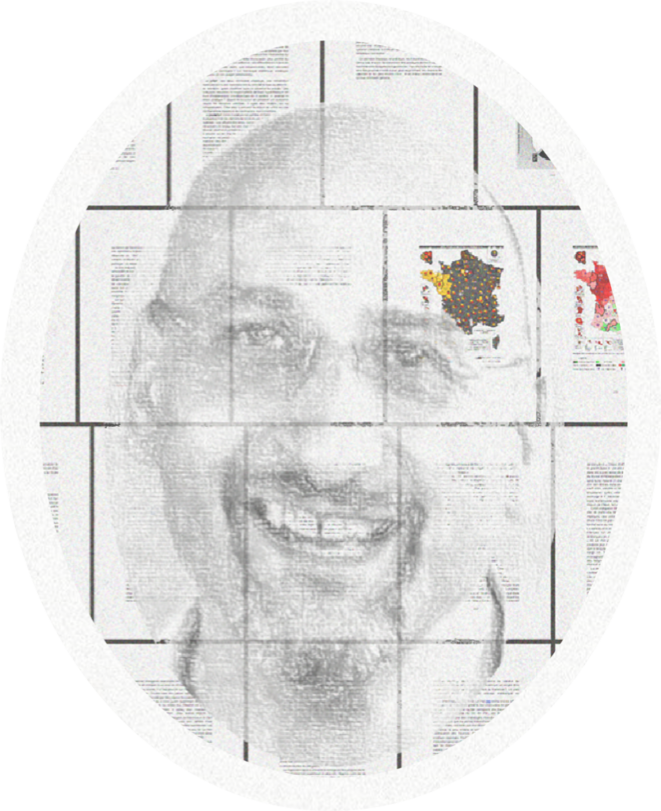- Synthèse des observations instillées au fil des précédents articles :
Les données nous ont d’abord révélé que le front républicain est à la fois dévitalisé nationalement et parfois décisif localement ( entre 84 et 169 fois ). Ainsi affleurait une cooptation républicaine sous-jacente aux conjonctures électorales ( https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/081224/legislatives-2024-front-republicain-sources-et-methodes-mesures-et-def ; https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/111224/legislatives-2024-front-republicain-impacts-en-sieges-selon-comporteme ). L’étude d’impact du front républicain a été conduite de manière dialectique, en lien avec les estimations de Data Realis Conseil ; cela en partant des circonscriptions les moins inféodées aux reports de front républicain pour arriver à celles directement acquises par ce jeu de consignes et réappropriations locales ( https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/020125/legislatives-2024-front-republicain-et-data-realis-offrit-ses-calculs ; https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/040125/legislatives-2024-front-republicain-entre-votes-de-temoignage-et-votes ). Cela donnait l’occasion de constater que des électorats s’emparent de ce mot d’ordre même quand leurs candidats le désavouent. Enfin, il s’est agi de déterminer ce que peut être un gouvernement de front républicain, entre expériences avérées sur la base de majorités théoriquement larges ( ensemble des partis ayant bénéficié d’au moins un siège de front républicain ) et simulations de majorités étroites en devenir ( https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/250125/legislatives-2024-front-republicain-se-desister-pour-un-gouvernement-r ; https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/080225/legislatives-2024-front-republicain-peuple-et-projet-bayrou-impasse-ou ). Là encore, les jeux de chiffres ne peuvent pas occulter l’absence de ligne politique des partis alliés, à commencer par une définition commune du républicanisme ; par exemple au moyen de la constitutionnalisation de la citoyenneté.
En conclusion, nous allons employer les données, encore et toujours, mais plus dans l’optique d’identifier des forces, des mouvements de bulletins et d’opinions. Nous tenterons de discerner autant que possible la nature du républicanisme ; un peu comme les astronomes observent les trous noirs par leurs incidences sur leur environnement. Il s’agit bien de considérer ce qui est observable, mais en vue de qualifier ce qui échappe aux sens, ce qui n’est à proprement parler qu’une vue de l’esprit : l’essence républicaine ou non des mouvances politiques de la France actuelle. Pourtant, les discours politiques sont tellement imprégnés de références contradictoires qu’il faut dresser un rapide bilan des sous-entendus et implications des accusations d’antirépublicanisme et revendications de républicanisme.
- Problème de régime ou de terminologie ?
Chacun peut se souvenir de la polémique née à la suite du changement de nom de l’UMP en LR : les Républicains. Cela passait pour une confiscation, initiée par la droite mais reprenant un usage populaire du terme pour désigner une forme de patriotisme. Inversement, les consignes de front républicain sont plutôt impulsées par la gauche, première éliminée en 2002 lors d’une élection majeure. Forte de son initiative plutôt bien suivie par ses sympathisants, elle s’érige volontiers en juge du bon et du mauvais républicanisme. Qu’en pense le peuple souverain ? Avant tout exposé chiffré, il faut s’arrêter sur les accusations d’antirépublicanisme. En quoi ces antirépublicanismes menacent-ils la Ve République ?
La réponse semble évidente, mais la figure d’un notable monarchiste parfaitement inséré dans le paysage médiatico-politique depuis des décennies montre que le blocage ne se situe pas où on le croit : T. Ardisson ( https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cpb86012397/a-bas-le-roi-vive-le-roi ). Lorsque le parti-pris antirépublicain, au sens propre dans le cas des monarchistes, apparaît dépourvu de risque immédiat ; lorsque les chantres de ce régime exposent leurs avis dans le cadre de la loi républicaine ; lorsque leur hostilité envers le régime reste pondérée et s’accommode du modèle de société dominant, sans prôner un retour à l’Ancien Régime ; ces antirépublicanismes animent le débat public, sans l’envenimer.
Inversement, les extrêmes droites sont souvent taxées de pétainisme, ce qui les exclurait de la tradition républicaine. Nul ne peut nier que le régime dit « de l’Etat français » avait des ambitions totalitaires, sans avoir durablement resserré son emprise sur la société française. Pourtant, de quelque nature que soit la dictature, elle n’en est pas moins étymologiquement une république. La particularité du régime de Vichy, c’est d’avoir proscrit une partie des symboles officiels hérités de la Révolution française : l’hymne et la devise. Autrement dit, le reproche qui lui est fait consiste moins à ne pas avoir été une République, ce qu’il était, qu’à avoir marqué l’avènement de la contre-révolution, assortie de collaboration avec l’occupant.
Concernant ce « passé qui ne passe [toujours] pas », d’après la formule d’E. Conan et H. Rousso en 1994 ; l’incapacité à poser convenablement les termes du débat ajoute du trouble à la confusion ambiante. Bien sûr, la période vichyste marque une rupture dans l’histoire républicaine ; cependant, elle porte moins sur la nature du régime que sur ses principes, son fonctionnement, sa tradition revendiquée. Il s’agit d’une expérience contre-révolutionnaire de 4 ans, à rebours d’un siècle et demi d’application croissante de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Nul besoin de revenir ici sur les héritages vichystes dénoncés ou avérés ; l’œuvre d’un Etat dépasse la figure de son chef ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-video-69-extremismes ). Il faut néanmoins admettre que, de nos jours, les extrêmes droites saisissent maintes occasions de dénoncer le droit-de-l’hommisme. Reste à établir s’il s’agit de velléités d’abrogation du texte fondateur de notre droit ou de remises en causes d’éventuelles perversions de la déclaration initiale, dont le citoyen était la pierre angulaire.
Entre la popularité d’un mondain monarchiste et l’épouvantail vichyste contre-révolutionnaire, il apparaît que le front républicain porte moins sur le régime stricto sensu que sur un héritage articulant Révolution originelle et enracinement tercio-républicain. Or la Ve République porte en elle, surtout depuis 1962 et le référendum de refondation, le projet de renouer la chaîne des temps, de rendre caduques de telles oppositions : Ancien Régime et Révolution, IIIe République et contre-révolution, individualisme droit-de-l’hommiste et autorité de l’Etat…
Surtout, la seconde révolution française, conceptualisée par H. Mendras, a anéanti les structures socio-culturelles de la citoyenneté républicaine française. En d’autres termes, à certains égards, être quinto-républicain reviendrait à être hostile aux cultures politiques tercio et quarto républicaines ; sans que la présente république ait réussi à réinventer de manière pérenne la citoyenneté. Celle-ci se trouve écartelée entre initiatives de terrain ( sur lesquelles nous reviendrons ) et institutions à tendance technocratique ( à titre indicatif, cf BIRNBAUM P., Où va l’Etat ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir, Seuil, Paris, 2018, 145 p. ).
En résumé, la sémantique qui légitime le front républicain apparaît très confuse. Ici, le républicanisme apparaît comme un fourre-tout assez illisible. Son précédent historique de 2002 se voulait plus clair, ne serait-ce que par son unanimisme ( https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/301124/legislatives-2024-documents-principaux-video-5-front-republicain-1-2 ). Néanmoins, j’ai montré dans mon histoire des seconds tours de la Ve République ( non publiée à ce jour ) que la percée de l’individualisme de singularité était mal comprise par les foules mobilisées dans ce front républicain paroxystique. Il en résultait une alliance dans l’opposition qui occultait la fracturation de leurs conceptions de la société. Outre les failles béantes entre manifestants de gauche et de droite, les identitaires de tous bords sapaient déjà les tentatives de régénérescence de ce corps civique.
Pour parachever cette République façon auberge espagnole, voici venir les candidats régionalistes et indépendantistes, parfaitement admis dans le jeu républicain même s’ils menacent implicitement ou explicitement le principe d’indivisibilité de la République. Ils ont leurs élus et droit de cité dans la République, qui admet les voix dissidentes pourvu qu’elles respectent les principes fondamentaux de la vie politique démocratique.
A l’opposé, hors champ électoral et légal, le ministère de l’Intérieur estime à environ 10 000 le nombre de radicalisés islamistes. Autrement dit, près d’un siècle après l’inauguration de la grande mosquée de Paris, plusieurs cercles de musulmans de France s’activent pour en faire une république islamique : cercles des activistes armés, cercles des complices, cercles des sympathisants… L’enjeu politique n’est pas leur républicanisme, mais leur dénégation des Droits de l’Homme et du Citoyen. Celle-ci outrepasse toutes les outrances des extrêmes droites françaises traditionnelles. Même si le cléricalisme a longtemps été antirépublicain et monarchiste, après avoir été ultramontain ; il n’avait jamais été théocrate en France avant les revendications islamistes. Surtout, en attaquant non pas des agents de l’Etat mais la population civile de manière indiscriminée, les terroristes islamistes ne déclarent pas la guerre à l’Etat, mais à la nation qui l’a porté ; ainsi qu’à la civilisation occidentale qui délimite leurs ambitions sur « Dar al Kufr ».
Finalement, une fois n’est pas coutume, la terminologie technocratique apparaît meilleure que les autres, en pointant les risques dits « séparatistes ». Entre séparatismes culturels et institutionnels, régionalistes et transnationaux, traditionnalistes et postmodernes ; le seul séparatisme oublié par les technocrates est sans doute le leur, celui de la sécession des élites qui pourrait, à terme, remettre en cause le socle institutionnel de la République, d’ores et déjà dévitalisé : la souveraineté populaire exprimée par le suffrage universel.
- Retour aux données : rappels des enseignements de base en matière de républicanisme.
Au premier abord, les données électorales ne devraient guère permettre de jauger la teneur républicaine ou non des cultures politiques en présence ; sauf en cas de candidature monarchiste comme celle B. Renouvin en 1974…
Le Conseil constitutionnel fournit un argument d’autorité qui ouvre une piste prometteuse, en faisant de la participation au vote « l’acte civique par excellence » ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-video-6-extremismes ). Cela n’est guère original, mais se confirme par les comportements électoraux. En l’occurrence, le président de la République, statutairement garant des institutions, obtient des scores nettement meilleurs dans les communes les plus participatives que dans les abstentionnistes. Autrement dit, l’ancrage de la République se manifeste territorialement par des options de vote stéréotypées : participation forte et prime au sortant.
Bien sûr, ces stéréotypes peuvent être critiqués, notamment au regard de l’inflexion technocratique du régime. Cependant, l’intention des électeurs ne se prête guère à confusion : il s’agit d’un certain légitimisme, comme adhésion au régime et aux autorités en place. Sur cette base, les communes métropolitaines ont été discréditées par tailles et participations plus ou moins fortes que l’ensemble du pays. L’outremer a été exclu de l’étude en raison des spécificités de ses villes, outre les inflexions liées à la distance. Cette méthode permet de discerner en métropole les sensibilités régionalistes, mais quelques territoires se démarquent nettement : les métropoles majeures, la France des bourgs et la France des tours, pour reprendre les termes de F. Ruffin. Il serait possible de leur adjoindre les banlieues chics.
Ces cultures électorales ont été classifiées comme viviers séparatistes ou socles républicains ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-videos-63-72-republicanismessyn ), pour en dégager un principe architectonique : de nos jours, en France, deux visions fortes de la République s’opposent de manière de plus en plus frontale. D’une part celle des administrations centrales et des médias, de l’autre celle « des urnes et rites », c’est-à-dire des citoyens attachés aux traditions républicaines. La première est à dominante légitimiste, malgré des inflexions de gauche ; la seconde opte pour le vote de rupture avec l’extrême droite.
Lorsque les Antilles ont basculé d’un front anti-lepéniste en 2017 à un barrage anti-macroniste en 2022, cette opposition est devenue patente. Vu d’outre Atlantique, le paysage politique métropolitain porte en lui ce clivage d’une République incapable d’embrasser tout le corps civique et toutes les dimensions de la cité. Alors que Rome parvenait, hors périodes de guerre civile, à accorder Sénat, Colisée, champ de Mars et Forum ; notre république actuelle a séparé ces fonctions par doublons antagonistes. D’une part les patriciens de la République font alliance avec le monde du spectacle pour se maintenir à force de pain et de jeux ; d’autre part les forces de l’ordre ainsi que l’armée se rallient de plus en plus ouvertement aux idées qui montent de la base populaire et agitent le débat public. Ce réalignement n’est pas achevé ni inéluctable ; cependant, l’incurie des élites aggrave la conflictualité politique et limite les possibilités de sortie de crise par le haut.
Cet article devait conclure la série dédiée au front républicain, mais la présente synthèse de ces éléments collectés au fil de l’étude des législatives 2024 incite à rédiger deux articles de taille moyenne plutôt qu’un seul qui perdrait en lisibilité. Ce récapitulatif reprend quelques idées formulées à l’occasion des présidentielles 2022, qui sont un meilleur point d’observation de l’électorat, sauf pour les régionalismes. Elles permettent également d’ausculter avec une relative précision la composition des listes électorales[1].
Même si les inscrits ont été superficiellement évoqués pour 2024 ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/291124/legislatives-2024-documents-principaux-video-2-sources ; mise à jour de données, 7’54’’ : https://www.youtube.com/watch?v=3gt1wYpWIvk&t=79s ), leur analyse détaillée n’a pas été réitérée avec la même rigueur. Les listes électorales révèlent la pratique du droit en matière de citoyenneté. Elles sont en cela très instructives sur les inflexions de notre modèle républicain, mais l’étude en a été conduite ailleurs.
Nous nous bornerons ainsi, dans le dernier article de cette série dédiée au front républicain, à établir ce que les comportements électoraux nous apprennent du républicanisme actuel, nous révèlent des étiquettes politiques au-delà des slogans de campagne.
[1] Pour aller plus loin : J. Morel, « Être inscrit sur les listes en 2022 – Citoyens de papiers, citoyens de pratiques », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 61-102.