Il existe, parmi les grandes démocraties de notre planète, un Etat dont le gouvernement est chargé de représenter le Parlement en justice. C’est en France, hélas, qu’une telle infantilisation du rôle du assemblées parlementaires, attentatoire à la séparation des pouvoirs, est institutionnalisée : devant le Conseil constitutionnel saisi de la conformité à la Constitution d’une disposition législative en vigueur, la constitutionnalité de celle-ci est défendue tout au long de l’instruction écrite et orale non pas par un représentant de l’Assemblée nationale et/ou Sénat, mais par… l’exécutif, en la personne d’un représentant du Premier ministre.
Ce n’est pas, loin s’en faut, la seule extravagance qui environne la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), créée sous le quinquennat Sarkozy par une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, précisée par une loi organique du 10 décembre 2009 et entrée en vigueur le 1er mars 2010, afin de permettre un contrôle par le Conseil constitutionnel, saisi après un filtre de l’une ou l’autre des juridictions suprêmes (Conseil d’Etat ou Cour de cassation) d’un article d’une loi applicable dans un procès (contrôle a posteriori de la loi).
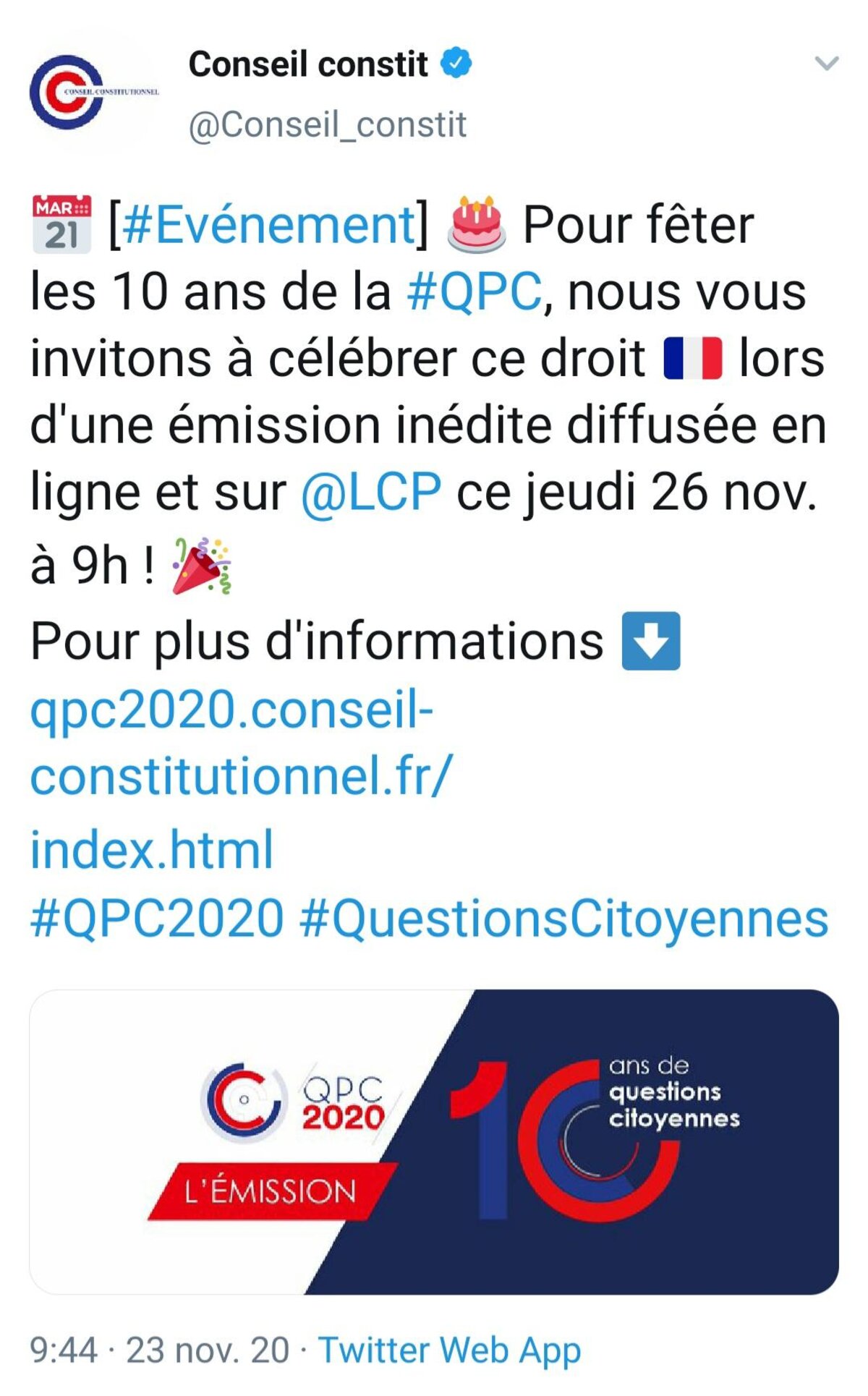
Agrandissement : Illustration 1
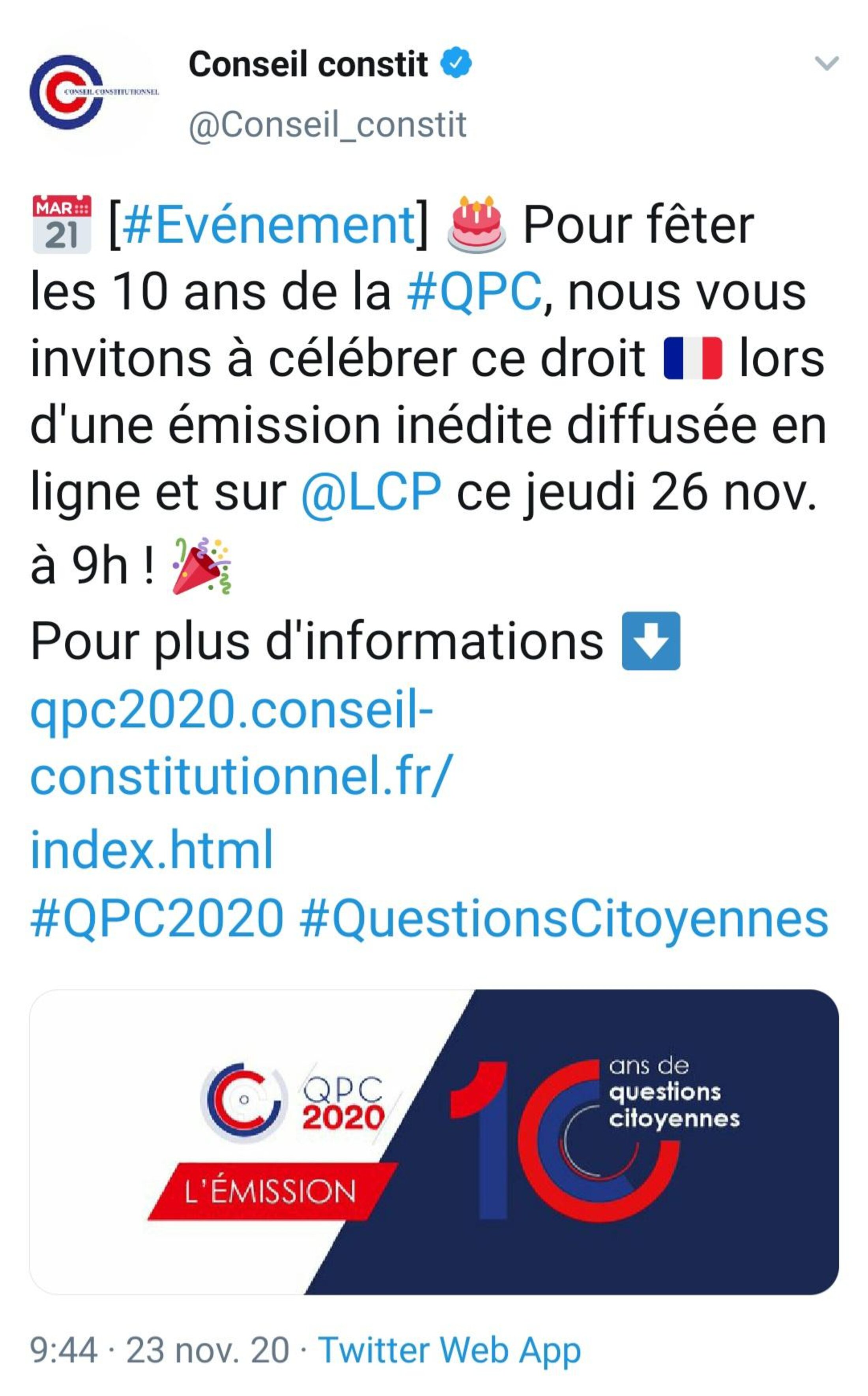
Les zélateurs les plus fervents de la QPC sont les présidents du Conseil constitutionnel – aujourd’hui M. Laurent Fabius. L’institution que ce dernier préside a à cet égard organisé le 26 novembre 2020 à partir de 9h une émission télévisée sur La chaîne parlementaire consacrée – avec une curieuse avance – au dixième anniversaire de la QPC, habilement rebaptisée pour l’occasion « question citoyenne » alors pourtant d’une part qu’une QPC peut être posée par une entreprise ou une institution publique (commune, département…) et d’autre part que les citoyens n’ont jamais accès direct par eux-mêmes au Conseil constitutionnel, lequel ne peut être saisi d’une QPC que sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. On notera d’ailleurs que le programme de l’émission télévisée du 26 novembre a fait intervenir dans un confortable entre-soi les habituels experts institutionnels parties prenantes à la QPC (première présidente de la Cour de cassation, vice-président du Conseil d’Etat…) et des dirigeants publics nationaux, mais aucun de ces « citoyens » que le président du Conseil constitutionnel porte pourtant en étendard sans les voir (les demandeurs à la QPC sont représentés par des avocats au cours des audiences publiques) ; on se demande pourquoi La chaîne parlementaire n'a par exemple pas donné la parole à l'un ou l'autre des assignés à résidence pendant l'état d'urgence sécuritaire de 2015 à 2017, qui n'ont tiré aucune garantie personnelle pratique des censures prononcées par le Conseil constitutionnel...
Cette émission n'a été traversée que par deux instants trop fugaces d'audace (toute relative...) : d'abord lorsque le Procureur général près la Cour de Cassation François Molins (à 10h25) a suggéré deux pistes de réformes ne nécessitant au demeurant qu'un ajustement des pratiques sans modification des textes : que la QPC aille au-delà de la seule matière fiscale qui est pour l'heure son terreau essentiel, et que soit créée une base de données des décisions juridictionnelles de non-renvoi des QPC au Conseil constitutionnel ; puis lorsque quelques minutes plus tard (10h40) le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a assuré que le « seul défaut (de la QPC) est de ne pas être suffisamment connue »... On va voir qu'il y a pourtant des critiques infiniment plus substantielles qui méritent d'être adressées à la QPC...
La veille de cette émission télévisée, le président du Conseil constitutionnel, interviewé dans les colonnes du Monde qui consacrait deux pages à la QPC, assurait : « la QPC est une réussite incontestable ». Une « réussite », vraiment ? Pour qui ?
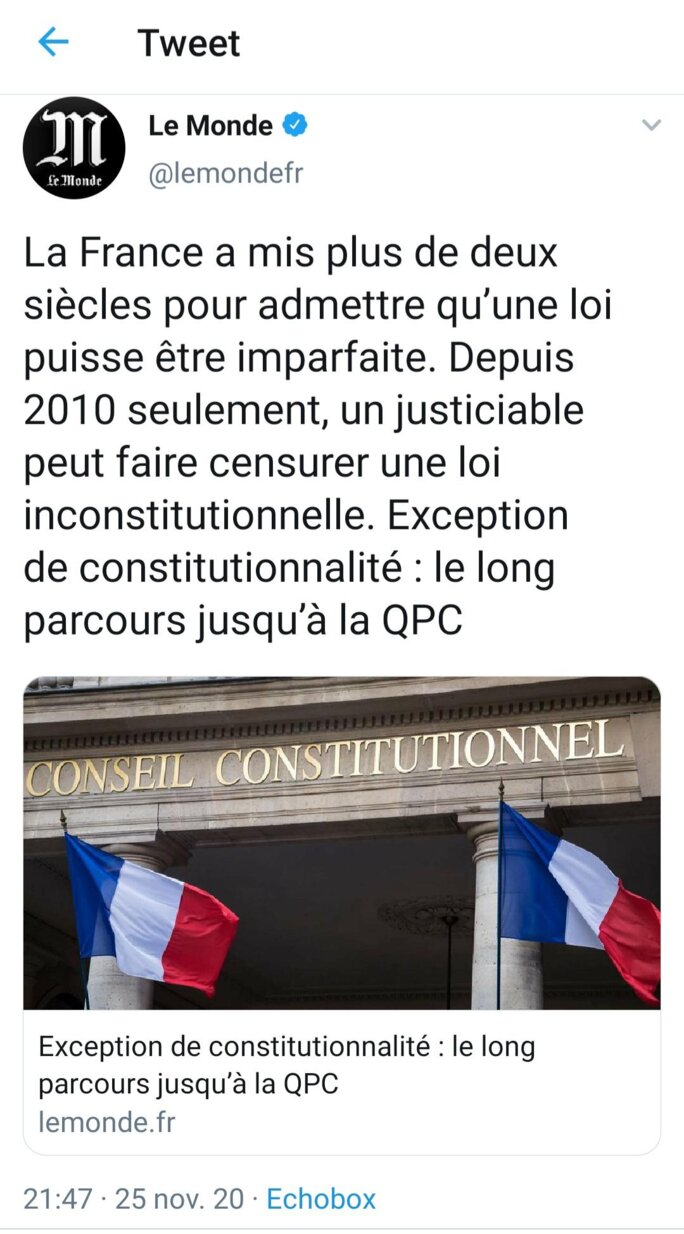
Agrandissement : Illustration 2
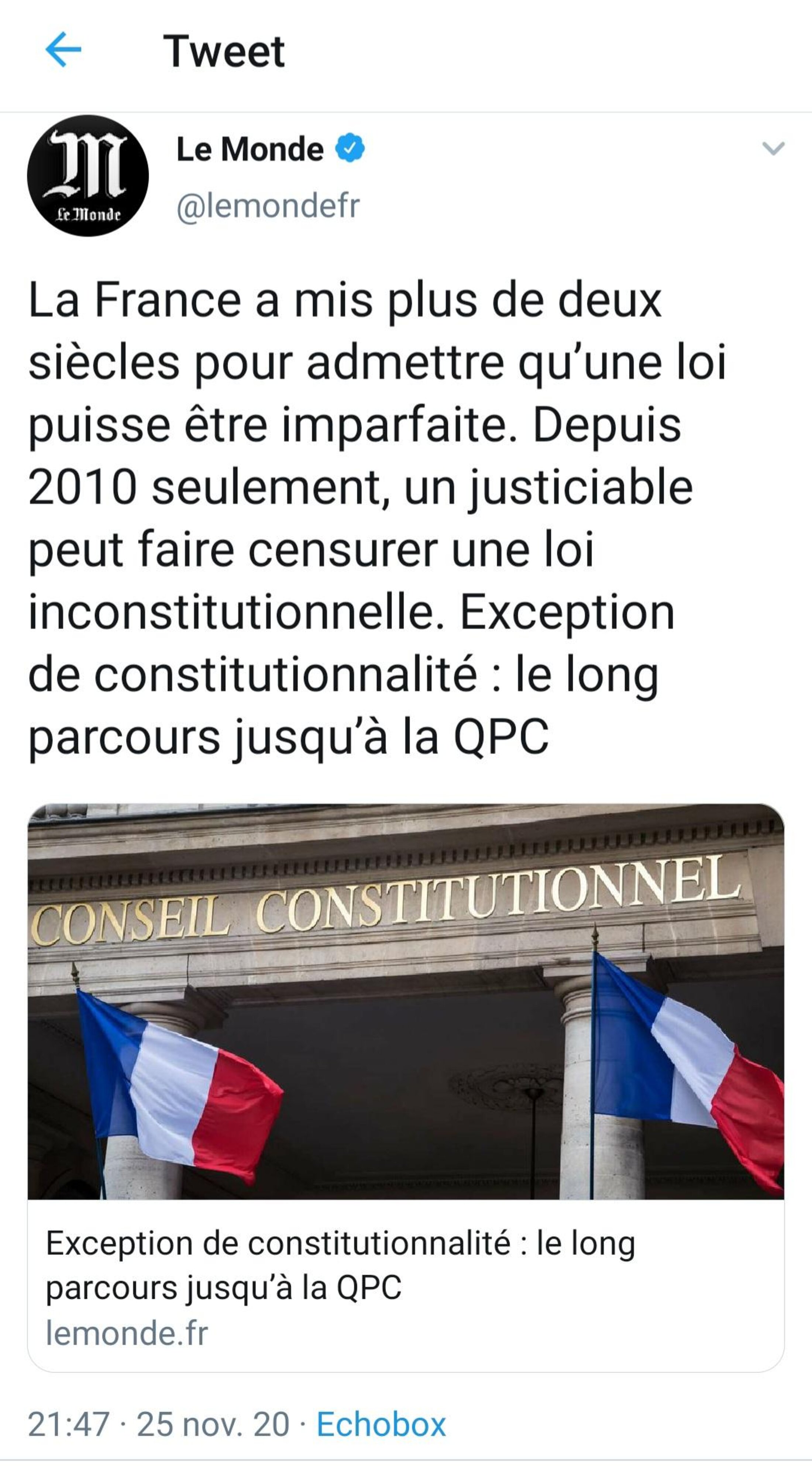
Ces louanges en forme d’auto-congratulation reposent sur un constat d’évidence : il est à coup sûr préférable pour la qualité de l’Etat de droit, pour l’autorité de cette norme suprême qu’est la Constitution, pour les personnes physiques ou morales, de mettre celles-ci en capacité de contester la constitutionnalité d’une loi en vigueur plutôt que d’en subir inéluctablement l’application, ainsi que cela était le cas avant 2010 lorsque la loi promulguée était constitutionnellement intouchable au nom de la « souveraineté » du Parlement.
Mais au-delà du nécessaire aggiornamiento réalisé par l’introduction en 2008/2009 du contrôle de constitutionnalité des lois promulguées, qui rend la France un peu plus présentable sur le terrain de la qualité de l’Etat de droit, que constate-t-on concrètement, après dix ans de pratique de la QPC et près de 800 décisions rendues par le Conseil constitutionnel ?
On constate d’abord que la QPC ne concerne qu’une partie seulement de la Constitution, les droits et libertés qu’elle contient.
Des pans entiers du texte du 4 octobre 1958 échappent donc à toute justiciabilité une fois la loi promulguée, alors pourtant que les dispositions généralement de procédure parlementaire ainsi invisibilisées, quoiqu’elles concernent les rapports entre pouvoirs publics, ont exactement la même valeur juridique que les droits et libertés constitutionnels, et donc que chaque article de la Constitution et de son préambule est fondamental.
Cette dualité constitutionnelle conduit à des résultats concrets délirants : le Conseil constitutionnel saisi par des autorités publiques (essentiellement des parlementaires) avant la promulgation de la loi détecte par lui-même (« d’office ») si cette loi comporte ou non des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire des dispositions ajoutées au cours des débats parlementaires sans lien avec l’objet du projet de loi adopté en Conseil des ministres ; mais une fois la loi promulguée par le président de la République, il n’est plus possible de soulever ce moyen à l’occasion d’un recours contre une mesure d’application de cette loi. Par exemple, la loi de programmation de la recherche votée le 20 novembre par le Parlement a créé, en violation grossière des limites au droit d’amendement des parlementaires, un délit d’occupation illégale des campus universitaires[1] ; cette violation ne peut être censurée que si le Conseil constitutionnel est saisi de la loi a priori, avant sa promulgation par le président de la République ; une fois la loi promulguée, ce moyen d’inconstitutionnalité ne peut plus être soulevé par un justiciable au cours d’un procès. Il est donc faux de dire comme l’a pourtant fait M. Laurent Fabius dans l’entretien précité que « désormais, nous sommes en mesure d’assurer la prééminence de la Constitution dans notre ordre juridique ».
Par la dissociation entre deux catégories de dispositions constitutionnelles qu’elle formalise en dépit de toute rationalité, la QPC ne constitue pas une réponse satisfaisante à cette exigence démocratique : mettre la Constitution et toute la Constitution à la disposition des justiciables, pour la raison qu’il s’agit du texte juridique le plus élevé dans la hiérarchie des normes. Au surplus, la relégation des règles de procédure parlementaire hors du champ de la QPC a eu des effets collatéraux pervers dans les litiges relevant de la juridiction administrative, puisque le Conseil d’Etat s’est appuyé sur le mécanisme de contestation des lois promulguée pour limiter la gamme des moyens pouvant être soulevés contre un acte administratif de portée générale et impersonnelle faisant l’objet d’une contestation indirecte dans un litige relatif à son application[2].
On constate ensuite que la QPC, prévue à l’article 61-1 de la Constitution, comporte une porte dérobée, sorte de logiciel procédural espion qui se révèle très favorable aux pouvoirs publics, logée au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, lequel permet au Conseil constitutionnel de repousser dans le temps les effets des inconstitutionnalités : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».
En pratique, le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC module systématiquement l’inconstitutionnalité qu’il constate, souvent pour plusieurs mois et y compris pour la personne qui a formé le contentieux, laquelle n’obtient donc qu’une satisfaction morale. Cela implique d’une part que les effets inconstitutionnels de la loi passés sont sanctuarisés (sauf à ce que la personne intéressée forme une hypothétique et chronophage action en responsabilité contre l’Etat à raison d’une loi inconstitutionnelle si le Conseil constitutionnel autorise un tel recours), et d’autre part qu’une loi que chacun sait inconstitutionnelle continue de recevoir application dans l’ordre juridique français, jusqu’à ce qu’elle soit réparée par le Parlement, lequel bénéficie donc d’un « droit à l’erreur constitutionnelle »[3]. Cette libéralité au bénéfice des pouvoirs publics (ou de grands groupes privés) est d’autant plus choquante que le Conseil constitutionnel ne motive jamais sa décision, arbitraire, sur cet aspect de la QPC[4]. Bref, tout est fait pour que la QPC soit peu ou pas effective, ou en tout état de cause qu'elle ne dérange pas trop la bonne marche des pouvoirs publics…
On constate encore que la QPC est, pour les parties au litige, beaucoup moins efficace que la technique contentieuse bien établie depuis des décennies qui consiste à critiquer une loi au regard de sa compatibilité avec des stipulations issues de traités internationaux (contrôle dit de conventionnalité de la loi).
Alors que la QPC réserve au seul Conseil constitutionnel la possibilité de décider qu’une loi est inconstitutionnelle, tout juge, toute formation de jugement peut « sans filtre » écarter l’application au litige d’une loi au motif qu’elle est contraire par exemple à la Convention européenne des droits de l’homme ou aux traités de l’Union européenne. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rendu le 2 octobre 2020 une décision généralement présentée par la presse nationale comme « historique » en faveur des détenus[5] ; mais le sens de cette décision était en réalité complètement contraint : elle n’a fait que tirer les conséquences, sur le terrain du droit constitutionnel, de la condamnation le 30 janvier 2020 de la France par la Cour européenne des droits de l’homme… L’unique valeur ajoutée de l’intervention du Conseil constitutionnel tient à ce que sa décision oblige le législateur à modifier la loi dans un sens conforme à la Constitution, sans possibilité de procrastiner ou tergiverser.
Enfin, au moins trois autres griefs peuvent être mis au débit de la QPC : d’une part, les juridictions suprêmes – spécialement le Conseil d’Etat – peuvent transformer en bouchon leur rôle de filtre de la QPC et empêcher, pour des raisons juridiquement intenables, le « citoyen » d’accéder au Conseil constitutionnel[6].
D’autre part, le monopole réservé au Conseil constitutionnel a également un coût financier pour les parties au litige, tenant à leur représentation par des avocats devant le Conseil d’Etat/la Cour de cassation d’abord puis le cas échéant le Conseil constitutionnel ensuite, ce qui explique que peu de « citoyens » parviennent jusqu’au Conseil constitutionnel, auquel peuvent en revanche avoir accès de grands groupes[7] ou des associations de défense d’intérêts collectifs.
Enfin, la QPC souffre d’un handicap congénital terrible : elle est placée sous l’égide du Conseil constitutionnel, dont la composition fait la part belle non aux juristes qualifiés ou aux personnes ayant une compétence scientifique et une indépendance établies, mais aux personnalités politiques – donc partisanes, ou susceptibles de l’être – recyclées de la vie publique – actuellement, deux des neuf membres sont d’anciens Premiers ministres[8].
Revenons alors à la raison d’être de la QPC, telle qu’elle a été présentée par le président de la République Nicolas Sarkozy dans un discours prononcé le 1er mars 2010, jour de l’entrée en vigueur de la QPC : « après avoir longuement réfléchi et observé que la loi promulguée était déjà susceptible d'être remise en cause au regard des traités internationaux, je me suis convaincu que c'était s'exposer de façon certaine, à plus ou moins longue échéance, au contrôle de la constitutionnalité des lois par le juge ordinaire, même si par respect pour les prérogatives du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation avaient toujours eu jusque-là la sagesse de maintenir la jurisprudence séculaire par laquelle ils s'interdisaient d'exercer un tel contrôle ». Tout est dit : en 2008/2009, les pouvoirs publics ont préféré anticiper l’inéluctable contrôle de constitutionnalité des lois promulguées en l'encadrant, en le canalisant, et partant en minorant son effectivité et sa portée. CQFD.
Les (presque) dix ans de mise en œuvre de la QPC le montrent : il y a encore beaucoup à faire avant que la mise en cause en justice de la loi promulguée devienne une « réussite incontestable » sur le terrain de la garantie des droits et de l'autorité de la Constitution.
[1] v. « Loi de programmation de la recherche : non à la pénalisation des blocages des campus », 16 novembre 2020.
[2] v. « Le Conseil d’Etat abime les principes de légalité et de sécurité juridique », 22 mai 2018.
[3] v. par exemple, le Conseil constitutionnel, dans une décision Ligue des droits de l’homme n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017, a donné sept mois au Parlement pour refaire une loi inconstitutionnelle, qui est demeurée applicable jusqu’au 30 juin 2018 : « Etat d’urgence : l’insupportable droit à l’erreur du législateur », 4 décembre 2017 ; v. aussi : « La neutralisation des inconstitutionnalités de la loi sur l’état d’urgence », 20 décembre 2016.
[4] v. par exemple : « Interdictions de séjour de l’état d’urgence : censure à la Pyrrhus », 9 juin 2017, et la scandaleuse décision n° 2020-843 QPC Association Force 5 rendue en faveur de la multinationale Total le 28 mai 2020 : « En République française, le gouvernement légifère », 8 juin 2020. Par cette décision du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 311-5 du Code de l’énergie devait être déclaré contraire à la Constitution jusqu’au 31 août 2013 et conforme à la Constitution à compter du 1er septembre 2013 ; puis, sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, il a décidé que la remise en cause des mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant cette date aurait, sans plus de précisions, des « conséquences manifestement excessives » de sorte que ces mesures ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Le 26 novembre 2020, invoquant le droit à un procès effectif, l'association Force 5 a formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme contre cette décision qui lui donne juridiquement raison mais... tort en pratique (Total est la société mère de la centrale de production d'électricité Direct Energie Génération, bénéficiaire de l'arrêté ministériel d'autorisation d'exploitation en cause dans le litige).
[5] « Conditions de détention : le Conseil constitutionnel exige une loi pour faire respecter la dignité humaine en prison », lemonde.fr, 2 octobre 2020.
[6] v. « Constitutionnalité du confinement: le Conseil d’Etat n’est pas sérieux ! », 23 juillet 2020.
[7] pour les litiges en matière fiscale ou pénale ; v. par exemple, pour un contentieux à 10 milliards d’euros résultant de la censure d’une taxe par le Conseil constitutionnel : « Le fiasco de la contribution de 3% sur les dividendes vu par l'IGF », 16 novembre 2017.
[8] v. par exemple : Lauréline Fontaine et Alain Supiot, « Pour une vraie réforme du Conseil constitutionnel », Le Monde, 15 juin 2017.



