Cet article s’appuie sur une visite effectuée sur les lieux, à Guise, il y a quelques mois, sur divers ouvrages et documents dont le livre de Jessica Dos Santos [JDS], L’utopie en héritage, le Familistère de Guise 1888-1968 et celui de Jean-Baptiste Godin lui-même, Solutions sociales.

Agrandissement : Illustration 1

Fourneaux de fonte et habitat social
Quand on arrive sur le site de Guise, on est surpris par l’envergure du familistère (classé au titre des monuments historiques depuis 1991). Bâtiment majestueux.

Agrandissement : Illustration 2

Il fallait loger le personnel dans des immeubles grandioses, des palais, comme l’avait envisagé auparavant Claude-Nicolas Ledoux, commissaire aux Salines de Lorraine et de Franche-Comté sous Louis XV, en construisant la Saline royale d’Arc-et-Senans, avec colonnes doriques, mise en service en 1779, selon un projet qui anticipait le phalanstère de Charles Fourier (1829).
Jean-Baptiste André Godin, quant à lui, termine le premier pavillon en 1859. La place centrale symbolise son projet, c’est-à-dire l’association du capital et du travail : cette place, où trône sa statue depuis 1889, un an après sa mort, est située entre les axes Nord-Sud du savoir et Est-Ouest du travail.

Agrandissement : Illustration 3

Jean-Baptiste Godin, né en 1817, a connu la condition ouvrière. Son père est artisan serrurier : Jean-Baptiste est scolarisé de 7 à 11 ans, il aurait voulu devenir ingénieur mais son père l’embauche dans son atelier. L'enfant a de la suite dans les idées, il suit des cours du soir, puis, pendant deux ans, fait le tour de France (sans être véritablement compagnon du Devoir). Il se fait une promesse : s’il devient un jour patron, il œuvrera pour de meilleures conditions de vie pour les ouvriers. Il s’inspire de Charles Fourier et de son phalanstère (contraction de phalange et monastère) pour créer, en faveur des familles, le familistère (le fouriérisme, même avec une approche bien moins familiale, a eu plus d’influence dans son projet que l’expérience du compagnonnage, même s’il considère que ce fut la meilleure formation professionnelle qu’il ait reçue). Il s’intéresse aux événements politiques qui agitent le pays : il se rend à Paris lors de la Révolution de 1848 et se dit profondément républicain.

Agrandissement : Illustration 4

Jusqu’alors, les fourneaux étaient en fer : la nouveauté qui va faire le succès de Godin c’est la fonte, qu’il a découverte au cours de son tour de France. Dès son retour, il dépose un brevet en 1840 et se fait livrer de la fonte avant de la chauffer au coke à 1000°. Il épouse Esther Lemaire et perçoit à cette occasion de son propre père un pécule de 4000 francs, qu’il investit dans l’entreprise installée à Esquéhéries (Aisne) pour produire les premiers fourneaux Godin. Il embauche bien vite une trentaine de salariés. Il lui faut alors une semaine pour produire un appareil de chauffage.

Agrandissement : Illustration 5

Des terres sont en vente à Guise, il les achète et installe son usine en 1846 au bord de l’Oise. D’emblée, selon la règle qu’il instaure, la journée de travail dure dix heures, six jours sur sept (le dimanche n’est jamais travaillé). Il interdit le travail des enfants en-dessous de 14 ans, alors que la loi interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans date de 1841 et en-dessous de 12 ans de 1874 (la loi de 1841 étant emblématique, une des toutes premières lois "sociales" sinon la première, où l’État, pour réduire le dépérissement de la jeunesse arrivant à l’armée et à l’usine, s'impose aux patrons et aux familles).

Agrandissement : Illustration 6

L’usine : partage des bénéfices
Godin n’est plus le propriétaire de l’usine (il déshérite ses fils, l’un le poursuivra en justice mais il décède avant son père), chaque salarié est membre et copropriétaire, et les bénéfices sont partagés. Plusieurs catégories de membres : auxiliaire (présent depuis moins d’un an), participant (depuis un an), sociétaire (depuis trois ans), et associé (depuis cinq ans, sachant lire et écrire), mais associés et sociétaires doivent habiter le familistère. Les enfants des ouvriers sont scolarisés dans les écoles du familistère, avec une préparation à une formation industrielle, les garçons pouvant devenir apprentis à partir de 14 ans (la loi ne rendra la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans qu’en août 1936). Les retraités perçoivent une pension après 15 années d’activité dans l’usine et ont le droit de conserver leur logement. Les enfants d’ouvriers sont privilégiés pour le recrutement et aussi pour l’attribution de logements (de ce fait, les nouveaux embauchés doivent trouver à se loger ailleurs, dans de moins bonnes conditions, avec des loyers plus élevés).

Agrandissement : Illustration 7

Les techniques de production ne sont pas sans danger (silicose et saturnisme). Pour les ateliers où le plomb (émail) est manipulé, des douches sulfureuses sont mises à disposition pour décoller les poussières qui collent à la peau, des distributions de lait sont organisées et les ouvriers ne restent pas plus de quinze jours sur le même poste, tous les ouvriers ont des temps de repos, selon un souci hygiéniste bien rare chez les patrons de l’époque.
Il développe l’idée de capacités (Fourier parlait de talents) qu’il veut rémunérer. Par ailleurs, les bénéfices sont répartis en proportion du salaire. Cette répartition des bénéfices revient à distribuer le capital. D’où l’idée qui court selon laquelle cette expérience serait hors lutte de classes.

Agrandissement : Illustration 8

Association, organisation, avantages sociaux
Pour transformer l’usine en petite république industrielle, « un début d’autogestion » (selon JDS), il crée une Association coopérative du capital et du travail et met en place une assurance contre les accidents du travail, une assurance maladie pour les ouvriers (avec indemnités journalières en cas de maladie). Les femmes habitant le familistère, salariées ou non, disposent d’une caisse maladie à part, selon la volonté des ouvriers eux-mêmes qui auraient redouté que les femmes, plus dépensières pour leur santé, ne coulent la caisse ! En cas d’incapacité de travail, un salarié ayant 15 ans de service minimum, perçoit une pension. En cas d’accident du travail, le droit à pension est immédiat. Ces diverses assurances sont gagées sur des cotisations, une subvention de l’Association et les amendes perçues dans l’usine pour sanctionner des retards ou des absences injustifiées. Une caisse pharmacie permet l’achat de médicaments (tous les habitants cotisent).
À partir de 1880, les ouvriers ont droit à deux semaines de congés payés (soit plus d’un demi-siècle avant que cela ne soit inscrit dans le droit français, sous le Front populaire). Une veuve ayant cinq enfants à charge ou plus est considérée comme inapte au travail et perçoit une pension jusqu’à la fin de sa vie. Les mères bénéficient d’un temps de pause pour allaiter leur bébé. La différence avec le patronat paternaliste de l’époque est que ce dernier valorisait sa propre bienfaisance et s’opposait à toute intervention de l’État, alors que Godin considère que ce qu’il met en place c’est à l’État de le faire, il est pour la résolution de la question sociale par la mise en place de services publics.

Agrandissement : Illustration 9

Godin s’immisce tellement dans tous les aspects de la vie, qu’il a conçu un berceau spécial afin de permettre au bébé de rester toujours propre (sans emmaillotage, pour ne pas le contraindre, avec un tissu troué et du son, ce qui évitait, parait-il, les érythèmes fessiers ; par ailleurs, l’utopiste n’est pas favorable au balancement du berceau pour calmer le bébé, s’il pleure il faut le calmer en le prenant dans les bras).
Il existe aussi une assurance des pensions, sorte de retraite, sans cotisation, proportionnelles au salaire perçu, abondées par l’Association et les intérêts d’un capital placé, en attendant que l’État la mette en place. Les salaires sont 20 % plus élevés que dans les autres entreprises. Enfin, les statuts fixent un revenu minimum (le « nécessaire à la subsistance ») qui est garanti si les ressources n’atteignent pas ce niveau (déterminé en fonction du nombre de personnes à charge).

Agrandissement : Illustration 10

Godin veillait à ce que ce système d’assurance ne mette pas en péril les finances de l’entreprise, par la suite ces « dépenses sociales » (terme utilisé) en progression lui font craindre une perte de compétitivité. De son côté, son successeur, Louis Colin, se plaindra de l’alcoolisme de certains ouvriers et des fausses maladies pour obtenir des jours de repos. Ainsi, selon lui, la hausse des dépenses sociales obligera d’augmenter les prix de vente (Jessica Dos Santos n’a pu vérifier cette assertion).
L’usine a bientôt 300 salariés et produit environ 100 appareils par jour. Elle exporte en Russie et en Algérie (conquise et colonisée par la France depuis 1830). Il s’est fortement engagé dans un projet de phalanstère au Texas, au point qu’il envisage un temps, après avoir consolidé Guise, de s’y rendre pour faire prospérer cette colonie, qui finalement virera au fiasco.

Agrandissement : Illustration 11

Il enclenche une seconde étape en 1859 : améliorer le quotidien des ouvriers en édifiant en brique le Palais Social (comme Fourier avait son Palais Sociétaire), plusieurs bâtiments avec cour intérieure, verrière et charpente en bois, fondé sur une vie communautaire, mettant l’accent sur les familles (il faudra 24 ans pour tout construire). Godin est un pragmatique : il ne parle pas d’utopie mais d’expérimentation. Il est dans le concret et va entrer dans les détails. Esther ne supporte pas cette promiscuité et, en 1862, elle demande le divorce : Godin s’installe alors dans un appartement du familistère avec Marie Moret, sa secrétaire et néanmoins cousine, qui parle anglais et irlandais ce qui va favoriser les échanges commerciaux. Scandale à l’époque : il vit vingt ans en concubinage avec Marie, avant de l’épouser deux ans avant sa mort.
Le Familistère : air pur, eau pure

Agrandissement : Illustration 12

Il complète les bâtiments avec le Pavillon Cambrai, le plus important, et il construit pour les ouvriers qu’il emploie dans des ateliers en Belgique, un familistère à Laeken, au nord de Bruxelles (où il a installé une usine au cas où la situation politique en France l’obligerait à fuir). Au total, en 1888, il peut loger 1800 habitants pour 1200 salariés : c’était prévu pour 2000 habitants, mais cela n’a jamais été atteint, car les appartements sont modulables. En effet, les appartements, plus grands et plus confortables que dans les cités ouvrières, moins chers (15 % du salaire), plus lumineux (car ouverts sur l’extérieur et sur la cour permettant une bonne aération), comprennent en principe deux pièces pour quatre personnes (45 m², soit 11 m² par personne, alors que la loi exige aujourd’hui au moins 9 m²), mais si la famille s’agrandit on perce une porte dans une cloison pour relier deux appartements et obtenir quatre pièces. Les deux pièces sont composées d’une cuisine avec poêle (Godin bien sûr) et une charbonnière décorée (réserve à charbon de bois). Une trappe à balayure permet dans chaque appartement d’évacuer les ordures ménagères.

Agrandissement : Illustration 13

Les arrivées d’eau potable sont au bout de la coursive (avec réserves d’eau dans les combles), ainsi que les bains et WC, les modifications se font donc sans se préoccuper de canalisations (à une époque où l’eau n’arrivant pas aux éviers, il fallait la chercher à une fontaine éloignée). Chaque appartement comprend obligatoirement une cage de canaris (pour repérer une éventuelle émanation de gaz toxique). Pour ne pas maintenir de l’humidité dans les appartements, le linge ne doit pas être lavé ni séché à l’intérieur, une buanderie est installée près de l’Oise. L’eau utilisée pour refroidir les machines est envoyée à la buanderie (lavoir et séchage du linge) et à la piscine (dont le fond en bois, mobile, monte ou descend pour s’adapter aux tailles des enfants). L’objectif est de faire en sorte que chacun sache nager car à l’époque le taux de mortalité par noyade est important.

Agrandissement : Illustration 14

L’habitat est pour Godin le premier élément contre la pauvreté : l’hygiène, le divertissement, l’éducation sont inaccessibles si le logement n’est pas sain. Un des critères sera la luminosité. Les fenêtres ont une surface de plus en plus réduite plus on monte en étage pour que l’ensoleillement soit égal pour tous. Les cours sont ventilées : chaque bâtiment a une verrière qui peut s’ouvrir sur les côtés. Pas de hiérarchie dans les logements. L’aile gauche a été en partie détruite par des bombardements allemands durant la guerre de 14-18, lors de la reconstruction ont été rajoutés des balcons, que l’on ne retrouve pas ailleurs, ce qui fausse l’équité voulue par Godin. S’il y a des logements installés dans les combles, c’est à l’encontre de son projet qui était opposé à l’habitat indigne.

Agrandissement : Illustration 15

L’habitat est conçu selon un projet collectif : dès que l’on sort d’un appartement, on est sur une coursive, aussitôt en lien avec les autres habitants, c’est l’objectif du familistère. Une sorte de surveillance que Godin revendique : une amende est prévue pour les mauvais locataires qui ne respectent pas l’hygiène, mais plutôt que le panoptique du système carcéral (analysé par Michel Foucault, qui le qualifie de « technique moderne d’observation » et de surveillance), il s’agit de créer une atmosphère d’émulation et d’autodiscipline. Il n’y a pas de concierge, chacun a totale liberté d’aller et venir. Pour Godin, gérer ensemble c’est savoir vivre ensemble. Il n’y a pas de règlement intérieur, c’est l’architecture qui favorise ce que d’aucuns ont nommé "autogestion". Au début, les pavillons ne sont pas remplis à cause du montant des loyers trop élevé, ces loyers seront baissés pour qu’il n’y ait pas de défections. Après la mort de Godin, aucun logement ne sera construit.
Économats, théâtre, jardin

Agrandissement : Illustration 16

Si le logement était pour Godin primordial, il avait d’autres préoccupations : les économats assuraient, sous forme de coopérative, l’épicerie, la boulangerie, la boucherie, le débit de boissons (par achat direct aux producteurs, sans intermédiaires, pour s’assurer de la qualité et de prix réduits surtout pour les denrées de première nécessité). Les magasins sont ouverts à tous, y compris à des habitants qui ne relevaient pas du familistère, quant aux bénéfices ils sont redistribués aux clients.

Agrandissement : Illustration 17

Un théâtre, temple de la culture, accueille des conférences le dimanche matin sur des thèmes variés (philosophie, religion, valeurs républicaines, socialisme, l’idée d’association). Un jardin d’agrément, pour l’air pur, est placé près des ateliers, pour les temps de pause (car les ouvriers sont confrontés à des fours à 1300°). Les vents dominants soufflent nord-ouest et emmènent les fumées hors des lieux habités. Godin se préoccupe de la vie de la cité : il sera élu au conseil municipal de Guise (du fait de tensions entre la commune et le familistère, ce lien sera rompu après la mort du fondateur).
Chaque ouvrier peut avoir un petit jardin individuel. Godin envisageait un jardin collectif mais a cédé à la demande des ouvriers de disposer de jardins individuels.
Ecole mixte et gratuite

L’école est gratuite, mixte, parce que privée, car la préfecture n’aurait pas accepté qu’une école publique soit mixte, des inspections avaient lieu régulièrement dans le but de faire cesser cette mixité. Le clergé lui-même combat cette mixité de même que la proximité entre les appartements, tandis que les commerçants protestent contre les prix réduits instaurés par l’économat. Les patrons font campagne contre Godin qui offre des salaires trop élevés.
Par contre, pas de chapelle (à la différence de l’utopie fouriériste). Godin ne veut pas d’influence de l’Église dans son projet, car s’il est croyant, déiste, pour lui, Dieu nous a créés pour le travail, la culture, pas pour l’implorer.
« Aristocratie ouvrière »
Le Palais social a souffert de toutes les guerres : il a été occupé par les Allemands en 1870, en 14-18 (où il a subi des dégâts et a dû être en partie reconstruit) et durant la Seconde Guerre mondiale.

Agrandissement : Illustration 19

Godin se prononce bien pour augmenter le nombre de logements, mais les associés s’y opposent, s’orientant vers une approche plus individualiste. Cette évolution vers une « aristocratie ouvrière », d’après ce qui est dit aujourd’hui au familistère, aurait été l’amorce d’un déclin : on va fonctionner en cercle fermé ; pour économiser, on va moins financer la recherche et le développement. Du fait de cette relative autarcie, l’âge moyen des ouvriers augmente et les familles ont moins d’enfants ce qui conduit à fermer des classes. Louis Colin se plaint en 1908 de l’« affaiblissement physique » des enfants qui étaient, selon lui, jadis plus résistants. Dérogeant aux principes du fondateur, il est même réticent à la scolarisation qui détourne les garçons du travail manuel.
Il existe un conseil du familistère, un conseil de l’industrie et un conseil de gérance, dont l’administrateur gérant est élu (ce sera longtemps Godin lui-même et, après sa mort en 1888, Marie Moret durant six mois, puis un administrateur gérant sera élu, cinq occuperont le poste jusqu’à la fermeture). Godin a des conceptions concernant les femmes relativement rares à l’époque : il défend le principe de la parité, il favorise leur investissement, mais elles sont peu nombreuses à l’échelon des associés.
Déjà à la fin du 19ème, les fourneaux Godin ont perdu leur domination, des concurrents apparaissent comme les fourneaux Rosières, puis la célèbre "Salamandre" des usines Chaboche. Pourtant, au niveau de la production, les progrès sont constants : à la veille de la Première Guerre mondiale, les fourneaux Godin fonctionnent « au bois, à la houille, au gaz, à l’électricité, au pétrole, à l’alcool, à l’eau chaude et à la vapeur » (JDS).

Agrandissement : Illustration 20

Entre les deux guerres, un mouvement de contestation se fera jour avec la CGTU (communiste) avec mot d’ordre de grève. Après 1945, l’usine n’est plus du tout concurrentielle, elle est devenue obsolète et va péricliter, faute d’investissements. Après la fin de la société en juin 1968, l’usine est reprise par Le Creuset puis la société Cheminées Philippe depuis 1988 (l’usine actuelle est identique à ce qu’elle était à l’époque Godin, à part la voie ferrée électrifiée qui aujourd’hui longe l’usine à l’Est). Les logements sont alors vendus en copropriété dans les pavillons Cambrai et Landrecies. Un programme Utopia réhabilite ces logements à partir de l’an 2000, 300 personnes y vivent toujours. Un restaurant, aidé par le Département, fonctionne. Des programmations ont lieu dans le théâtre. Les écoles sont reprises par la ville de Guise.
Finalement, Godin recula sur de nombreux projets, constatant un investissement insuffisant des ouvriers, ce qui le conduisit à revenir en 1880 à une structure hiérarchique. Il a l’intuition que ce que l’industrialisation impose, avec sa cohorte de pauvres, nécessite une réponse globale (salaires, habitat, éducation) et non pas des aménagements au coup par coup. Le projet qu’il élabore n’est ni un rêve, ni une utopie mais il lui donne corps. Il prévoit la possibilité de sortir de la pauvreté non pas en trois générations mais en deux. Mais il s’est trouvé confronté sans cesse « au dilemme qui oppose la démocratie à l’efficacité ».

Agrandissement : Illustration 21

______

. L’utopie en héritage, Le Familistère de Guise, 1888-1968, par Jessica Dos Santos, 2016, Presses Universitaires François-Rabelais de Tours (il s’agit d’une transcription de sa thèse de doctorat en histoire contemporaine, préface de Jean-François Eck). L’autrice, après avoir consacré une centaine de pages à la réalisation de Godin, s’emploie à étudier l’évolution du familistère, les changements survenus au fil des ans. La période ayant suivi la mort de Godin ayant été peu étudiée, l’historienne souhaitait se concentrer sur l’héritage et l’appropriation de l’œuvre par les successeurs. Elle montre combien la guerre de 14-18 a affecté l’entreprise : réquisitions, destructions et personnels tués au combat. Puis la concurrence s’accrut et la rationalisation de la production tarda à se faire jour, d’où une perte de compétitivité. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, perturbe le fonctionnement de l’usine et la spécialisation, le défaut de diversification des produits, conduisent à des difficultés menaçant la survie de l’entreprise. Les ouvriers sont embarqués dans les grèves du printemps 68, en vain : l’association est dissoute en juin 1968, pour devenir Godin SA, rachetée en 1970 par la Société Le Creuset.
L’écriture de l’ouvrage est limpide, très accessible même sur des questions plus complexes (de gestion par exemple) : l’autrice renvoie toujours son propos à la réalité sociale. Les paragraphes et les chapitres s’enchaînent de façon fluide. Je recommande la lecture de cet ouvrage.
. Solutions sociales, Les Éditions du Familistère, 2010 [19,50 € au Familistère, 36 € sur certains sites, 3 € mon exemplaire acheté chez Emmaüs il y a quelques années]. Le livre est copieusement annoté et commenté par deux spécialistes.

Godin a publié ce livre de 670 pages en 1871 afin de coucher sur le papier d’une part sa morale, sa philosophie sociale, d’autre part des aspects techniques précis pour mettre en œuvre et réussir une telle utopie. D’aucuns ont rendu leur verdict, Godin serait naïf, son ouvrage ne serait pas de la grande littérature. Il les a aidés à parler ainsi puisque d’entrée de jeu il précise que « ce livre n’est pas une œuvre littéraire ». Il demande même au lecteur d’être indulgent. S’il fait manifestement des efforts pour que sa pensée soit reconnue et qu’elle permette le salut de la Patrie, il est pragmatique, donc sa théorie n’est pas abstraite, elle se fonde sur une réalité qu’il s’est coltinée. Vivre auprès des gens de labeur ne permet pas d’acquérir « l’art de bien dire » mais cela permet d’approcher le sort des masses : « c’est là que gît la question sociale de notre temps ». Il a préféré agir dans le silence avant de rendre compte et de s’exprimer.
Son idéalisme le conduit à mettre des majuscules à de nombreux mots : Paix, Patrie, Vie, Œuvre, Créateur, bien sûr, mais aussi Salaires, Produits, Ouvrier, Nécessité… Il y a une sorte de religiosité dans cette glorification des mots, et surtout dans ce qu’ils recouvrent.
Il veut « démontrer comment le présent peut créer le bien-être au profit de ceux qui sont privés du nécessaire, sans rien enlever à ceux qui possèdent la richesse ». C’est en tant qu’ouvrier qu’il veut améliorer la vie des ouvriers. Il réfléchit à la question du travail (et à l’association fondamentale du travail, du capital et du talent) avant de penser au logement. Choqué par l’« anarchie des salaires », il rejette le travail à l’heure, estimant que ce qui doit être payé c’est « le produit du travail ». Avec un tarif débattu, du coup l’ouvrier est maitre de son temps. Il dénonce une aristocratie fondée sur le « travail salarié » qui a remplacé après la Révolution celle qui était fondée sur le « travail servile ». Il ne se contente pas d’une « justice redistributive » car elle ne permet pas une « répartition équitable ». L’égalité ce n’est pas une part égale mais une part proportionnée à ses besoins. Son livre est une sorte d’encyclopédie (ou un inventaire à la Prévert) où il traite non seulement du travail et des salaires mais aussi des caisses de secours, de la démocratie politique, de la démocratie sociale, (« inséparable de l’idée de fraternité »), du socialisme, du saint-simonisme, de l’habitat, des femmes, du « pouponnat » et du « bambinat », de l’agriculture, de l’industrie, des services domestiques, des fêtes, de la richesse, du commerce, du crédit, de l’éducation, de l’organisation politique et administrative, des lois, des mœurs, de la police et de la guerre. Pour arriver au familistère et au logement souhaitable, il va suivre tout un chemin partant des huttes et des cavernes, des cases et des maisons, du château féodal et des maisons d’ouvriers.
L’historien André Gueslin, grand spécialiste de la pauvreté et de l’exclusion sociale, a écrit que le familistère était du « paternalisme de gauche ». Jessica Dos Santos a contesté dans un article cette analyse, considérant que l’œuvre de Godin, visant l’émancipation ouvrière, le situait face à la question sociale à un tout autre niveau que les paternalistes, et ne pouvait être assimilé au conservatisme et au paternalisme rigoureux de Frédéric Le Play.
Godin a été élu député de l’Aisne le 8 février. Trois mois plus tard, il boucle Solutions Sociales, le 8 mai 1871 à Versailles, le jour-même où Thiers envoie un ultimatum aux Parisiens leur demandant de mettre fin à l’insurrection de la Commune, sinon il enverra l’armée prendre possession de la ville.

Agrandissement : Illustration 24

. Friedrich Engels, dans La question du logement (1872) où il décrit l’habitat déplorable des quartiers ouvriers et le logement comme lieu de reproduction de la pauvreté et de l’exploitation, a fait une allusion au familistère de Guise. Il écrit qu’il a été construit « par un fouriériste, non comme une affaire rentable, mais comme une expérience socialiste ». Mais, en 1886, avant la mort de Godin, il ajoute dans une réédition que cette expérience est devenue finalement, comme ailleurs, « un simple foyer d’exploitation ouvrière » ! Sans avoir révolutionné le monde ouvrier, il est certain que l'utopie réelle tentée par Godin a conforté un idéal visant à améliorer la condition ouvrière (revenus, habitat, protection sociale) et à mettre en oeuvre à terme la démocratie sociale.
Extinction du paupérisme :
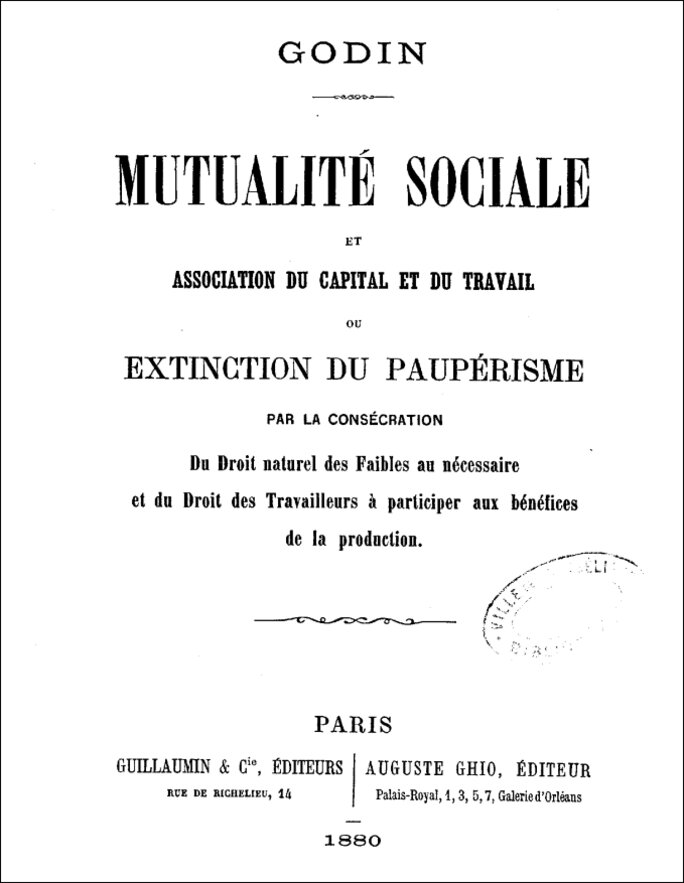
Agrandissement : Illustration 25

En 1880, Godin publie un document de 275 pages où il reproduit tous les textes et règlements qui régissent le Familistère (ici) sans oublier de citer en préambule les valeurs morales déjà défendues par Zoroastre et Confucius ! En 1883, en tant que député, il dépose à la Chambre un projet visant à créer une Mutualité sociale, où, après avoir remis en cause l’héritage, l’accaparement des richesses par quelques-uns, il appelle les législateurs à faire en sorte que ce soit l’État qui hérite des « terres, maisons, fermes, ateliers, usines, actions capitaux et biens mobiliers », car « la propriété a ses limites de droit naturel au-delà desquelles elle tombe dans l’abus ».
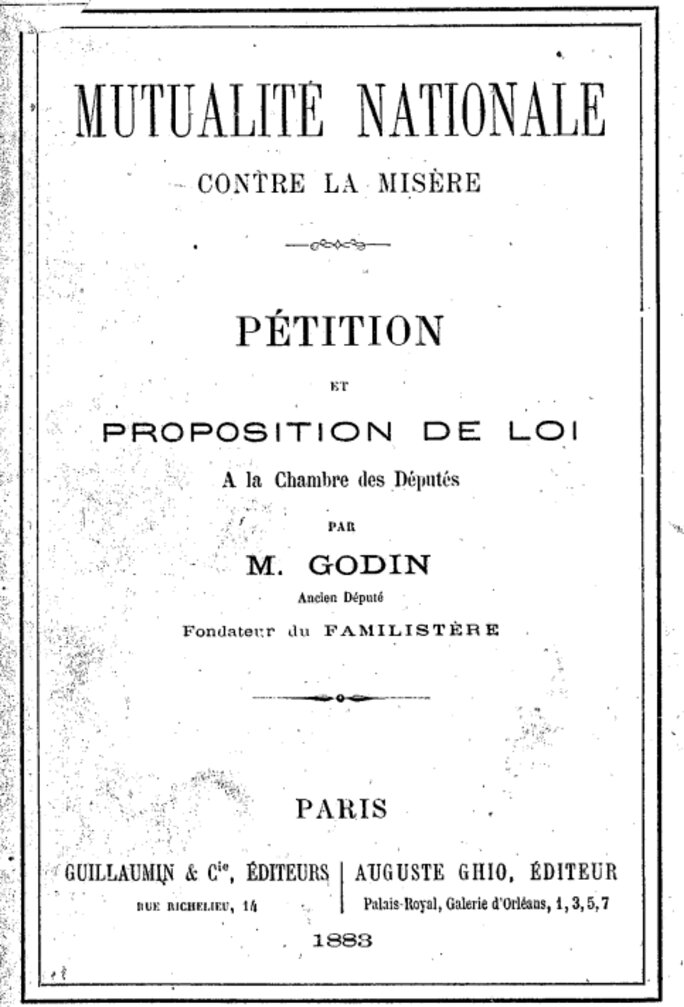
Agrandissement : Illustration 26

Ainsi l’État pourra mettre en œuvre la réforme sociale la plus urgente : « l’extinction du paupérisme » et l’organisation de la mutualité au profit de tous les citoyens des deux sexes (« faire de la loi un instrument de prévoyance sociale qui puise à la richesse publique même, de quoi anéantir la misère »).
. Pétition et proposition de loi, 1883, Mutualité sociale contre la misère.
_____
. La visite effectuée à Guise en septembre 2024 s’inscrivait dans le cadre d'un voyage d’études dans la région sous la houlette de Jacques Alexandre, président de l’Association Cria-Parangonneurs, réseau d'échanges de bonnes pratiques de management sociétal et d'innovation.

Agrandissement : Illustration 27

Billet n° 857
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).
Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook



