
Agrandissement : Illustration 1

Rien à perdre
Delphine Deloget a réalisé des documentaires dont certains empruntaient à la fiction (comme Voyage en Barbarie qui décrit la traite des êtres humains, jeunes Erythréens torturés dans le nord-est du Sinaï). Dans le dossier de presse, elle déclare que Rien à perdre est dans la suite logique de son travail : fiction ou documentaire, il s’agit toujours de « rendre une histoire universelle ».
Sylvie Paugam* (Virginie Efira) élève à Brest ses enfants comme elle peut, leur laissant beaucoup d’autonomie, persuadée qu’ils sont débrouillards et qu’ils n’ont pas besoin d’elle à tout instant. Sauf que lorsque l’un d’eux, Sofiane, en l’absence de sa mère, met le feu à l’appartement avec une friteuse et qu’il se brûle, il montre complaisamment ses blessures à tout le monde. Il a été conduit à l’hôpital qui a mis trois heures avant de pouvoir joindre la mère. Les services sociaux sont informés et une assistante sociale, Madame Henry (India Hair), s’en inquiète et procède à une visite à domicile. Elle est évidemment mal reçue, d’autant plus qu’elle arrive avec un document du procureur, assistée de deux policiers : Sofiane doit être placé dans un foyer.
Sylvie est si colère qu’elle casse la cuisinière à coup de masse. Elle renoue avec son frère Alain (Mathieu Demy) pour qu’il l’aide : la mort dans l’âme, parce qu’elle a fait tant de conneries qu’elle est, selon lui, la honte de la famille. Il accepte de faire une lettre pour la défendre : en vain, le juge des enfants décide un placement de six mois, avec visite médiatisée, tous les mercredis. Pour tenter d’améliorer son image auprès des autorités, Sylvie dégage tous ses amis, à cause de leurs enfants qui mettent du désordre. Elle se rend à un groupe de parole où on échange entre parents d’enfants placés, dans le but de s’entraider pour combattre ces décisions judiciaires. La plupart sont défaitistes car on ne connait pas de cas où des parents auraient gagné en appel. Il y a les dociles et les révoltées, les unes pensent que l’action judiciaire n’est pas déclenchée pour un rien, les autres affirment le contraire : pour des peccadilles, la justice est actionnée. Certaines (car ce sont surtout des femmes) sont dans les procédures depuis deux ans, huit ans, douze ans. L’une donne cette consigne : lave tout à la Javel, ton appart… et ta vie. Elle les engueule, leur reprochant de rester le cul sur leur chaise, avant de claquer la porte.
Son frère l’aide à trouver du boulot pour avoir ainsi une meilleure représentation mais elle ne respecte pas le contrat, alors même que des collègues se sont montrés solidaires pour qu’elle puisse prendre son mercredi et voir son fils. Ce dernier est mis sous Ritaline, elle accuse les éducateurs de le mettre ainsi sous camisole de force pour se protéger eux. Scène déchirante : lors d’une visite médiatisée, Sofiane est emmené de force car il refuse de quitter sa mère : il s’accroche désespérément à ses cheveux.
Un ami de la mère, Hervé (Arieh Worthalter), la rassure : au foyer il va pouvoir faire du voilier. Lui-même, jadis, a été placé en foyer, il a bien aimé. Elle pique une colère : tu oses me comparer à tes parents. Lui tente d’expliquer la démarche de l’ASE : « ils ont un doute, il faut penser au gamin ». Lors d’une autre colère, elle se bat avec des policiers : ils lâchent prise quand elle leur montre ses seins ! A un autre moment, elle tente d’écraser l’assistante sociale. Un jour où elle pète les plombs, un de ses proches dit : « elle est en pleine crise d’ado ».
Entre lieux communs et tentative de compréhension

Agrandissement : Illustration 2

Si ce film a été réalisé pour documenter la question des enfants placés, cela amène aux remarques suivantes. Avec les éléments qu’on nous fournit, il est peu probable qu’un enfant serait placé par un juge dans un tel contexte (sachant qu’on ne voit pas vraiment ce qui s’est passé avant et qu’à aucun moment l’école n’est sollicitée). Bien sûr, il faut faire abstraction, pour se prononcer, du facteur de sympathie que l’on peut éprouver pour l’actrice et donc pour le personnage. Mais cette mère est batailleuse, sauf cas d'extrême danger, la justice aurait lâché prise. Certes, il y a des éléments d’inquiétude, mais, si je peux me permettre un diagnostic virtuel, un suivi socio-éducatif à domicile aurait suffi (contrairement au propos tenu : « plus tu te débats plus on t’enfonce »). On sent que le scénario balance entre lieux communs et volonté de ne pas être trop caricatural, entre misérabilisme et approfondissement du sujet. Une mère, au groupe de parole, confie qu’on voulait lui prendre son enfant avant qu’il naisse sous prétexte qu’elle avait, elle, grandi dans un foyer. Pas sûr que cette affirmation soit perçue pour ce qu’elle est sans doute, à savoir un moyen de défense (je pense à tous ces adultes que j’ai rencontrés, anciens enfants placés, en difficulté avec leurs propres enfants, témoignant qu’ils avaient été placés autrefois parce que leurs parents avaient un appartement trop petit). Il va de soi que si toutes les femmes ayant été placées voyaient leurs enfants destinés à la pouponnière avant même de naître, ça se saurait (et les pouponnières seraient nettement insuffisantes pour tous les accueillir).
L’assistante sociale, qui est une "demoiselle", cherche à être conciliante mais ne respire pas l’empathie. Elle fait une visite à domicile : le logis n’est pas très bien entretenu, Mlle Henry, comme en 40, n’hésite pas à ouvrir les placards, à demander à Sylvie : « est-ce qu’il y a quelqu’un dans votre lit ? ». A contrario, Sylvie accuse le service social de lui avoir dit que ce serait bien qu’elle ait un compagnon ! Un jour, on entend une voix off menacer : « vous voulez qu’on vous menotte ? » (on préfère imaginer que c’est la policière qui a parlé, pas l’assistante sociale). La visite médiatisée est, comme le reste, quelque peu simpliste : une éducatrice prend ostensiblement des notes sur un cahier, interdit d’aller dehors, du coup la mère ironise demandant la permission de prendre son fils sur ses genoux. A ses proches, elle dira : on n’a pas le droit de pleurer, d’apporter des cadeaux. Les propos des éducs sont du style : votre fils est dans un conflit de loyauté, il ne peut accepter le placement sans vous trahir ; non non, le droit de visite n’est pas supprimé, il est juste suspendu. Devant une assertion apparemment contradictoire (en gros, c’est mieux que Sofiane soit loin de sa famille pour pouvoir renouer avec vous), la salle (de cinéma) grommelle. Petite note syndicaliste, les professionnels sociaux se plaignent d’être en sous-effectifs.
Par contre, à plusieurs reprises, il y a une tentative d’expliquer la dureté de la protection de l’enfance : quelqu’un dit qu’un jour, l’ASE ayant été trop conciliante, un drame a eu lieu, un enfant est mort. L’avocate sait qu’« ils ont peur de passer à côté d’un enfant battu », que l’on peut placer un enfant pour carences éducatives, pas forcément pour maltraitance physique, mais elle se dit également prête à porter plainte contre l’ASE qui voulait retirer les droits parentaux, et même à saisir la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme. Même Sofiane semble comprendre que pour l’ASE ce n’est pas lui qui est perturbé mais sa famille.
Le risque pour un film transcrivant une réalité sociale c’est de tenter d’être plus ou moins proche de la réalité, de lister un peu tout ce qui la caractérise pour ne rien oublier. Du coup, ça fait un peu catalogue et simplification (cf. L’Abbé Pierre qui essaye de coller au parcours du personnage au détriment d’une réflexion approfondie sur le caritatif et la solidarité). Il y aurait cependant une autre manière de percevoir ce film, compte tenu de la qualité de jeu de Virginie Efira qui, comme toujours, se donne à fond : c’est le combat que mène une mère prise dans un tas de contradictions, avec sa famille (son frère qui la perçoit comme le canard boiteux), avec ses enfants qui entravent sa liberté, avec les hommes, avec elle-même. Et là Virginie Efira remplit le contrat.
* Paugam est un nom fréquent à Brest, pas seulement le patronyme d’un sociologue renommé spécialiste de la solidarité et de la précarité.
. Film vu en avant-première au Festival Indépendance(s) & Création de Ciné 32 à Auch (Gers), début octobre.
Bébés placés, la vie devant eux
France 2 a diffusé le 15 novembre un documentaire de Karine Dusfour sur les enfants accueillis en pouponnière, suite à une situation familiale les mettant en danger. Certains d’entre eux, parce que nés sous X, sont adoptés. Le documentaire montre d’une part les enfants accueillis en pouponnière ou en famille d’accueil (et les professionnels qui s’occupent d’eux) et la procédure d’accueil par les parents adoptants. Il est rare qu’un film rende compte de ces situations que seuls quelques professionnels approchent.

Agrandissement : Illustration 4

Ayant eu à connaître, dans mon activité professionnelle, le dispositif d’adoption (enquête d’agrément, commission d’évaluation avant le conseil de famille) et plus précisément le travail approfondi entre assistante familiale, assistante sociale et parents adoptants, je me suis dit dans le passé qu’il serait souhaitable que soit montré au public ce travail effectué avec finesse, avec constance selon une procédure bien rodée, vigilante à ce que cela soit le moins traumatisant pour l’enfant. C’est ce que ce film, pour partie, montre, avec respect (dans le propos et dans les images) envers l’enfant, envers la mère, l’assistante familiale, les travailleurs médico-sociaux : le film étant co-produit par Mélissa Theuriau, c’est ce que l’on pouvait attendre d’elle, connaissant la qualité de ses engagements (sérieux, pas racoleurs, contrairement à tant d’autres, comme elle l’a montré, par exemple, avec un documentaire ancien sur les femmes incarcérées).
On suit quelques enfants (prénoms changés) : Anne-Lise, Basile, Manon, et les adultes (professionnelles) qui les entourent, avec chaleur, leur tenant des paroles rassurantes, leur parlant comme si le bébé pouvait comprendre (il comprend l’attitude qui le met en sécurité). On peut imaginer que ce n’est pas simple pour les professionnelles d’être filmées dans ces conditions, mais le projet atteint son objectif : montrer une réalité méconnue. Dans un contexte politique où il est de bon ton de discréditer sans nuances l’Aide sociale à l’enfance (ASE), il est appréciable qu’une documentariste n’ait pas cherché à faire le buzz habituel, c’est-à-dire à prendre un malin plaisir à jeter le discrédit sur l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance.

Agrandissement : Illustration 5

Le débat qui suivit mettait en présence Charlotte Carpentier-Lecocq, ancienne chef d’entreprise (conseil aux entreprises et aux associations), députée Renaissance, présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et Lyes Louffok « ancien enfant placé, éducateur spécialisé, poursuivant des études de droit ». Ce dernier contestait l’idée que les conditions d’intervention seraient aussi idylliques que ce que montre le film (manque de personnel, normes d’encadrement inexistantes, enfants laissés trop longtemps à l’hôpital avec syndrome d’hospitalisme, manque criant de familles d’accueil, jeunes majeurs encore renvoyés de l’ASE à 18 ans, malgré la loi de 2022). Marie Drucker ne donnait pas le sentiment de maîtriser grand-chose du sujet et se satisfaisait de la contestation assez virulente de Lyes Louffok (ce qui lui permettait d’abonder en donnant du coup le sentiment qu’elle en connaissait un rayon).
De son côté, Madame la députée, sous les coups de boutoir de Lyes Louffok, était bien en peine pour rétorquer qu’'il ne fallait pas dramatiser. Elle avait certainement révisé quelques fiches, mais sa fonction ne lui permettait pas d’être à la hauteur, on se demande d’ailleurs bien pourquoi c’est une députée qui était invitée puisque l’ASE relève de la compétence des Départements (ce qui insupporte Lyes Louffok qui milite pour une recentralisation). Cela permettait au moins à Marie Drucker de dire qu’il y a « une crise majeure de la protection de l’enfance » et d’en donner doctement la raison (erronée) : parce qu’une partie est gérée par les Départements, une autre par l’État ! Et qu’il faut donc la refonder, Lyes Louffok approuvant en notant que des dizaines de milliers de mesures ne sont pas exécutées, les Départements préférant… construire des ronds-points. Marie Drucker semblait avoir lu tout récemment le livre de Lyes Louffok (Dans l’enfer des foyers, paru il y a bientôt dix ans) et avait répertorié tous les cas de violences qu’il évoque. Lui-même considère que son histoire c’est « celle de la majorité des enfants ». Le mystère perdure : d’autres anciens enfants placés ont écrit sur leur histoire, jamais la télé ne les invite pour qu’ils et elles témoignent, certainement parce que leurs témoignages, émouvants, ne sont pas misérabilistes, sans pour autant passer sous silence les drames vécus.

Agrandissement : Illustration 6

Un point aurait mérité approfondissement : 10 000 enfants sont en pouponnière actuellement en France. Ce chiffre me parait excessif : il mêle pouponnières à caractère social et foyers de l’enfance (ces derniers ne limitant pas à 3 ans l’accueil). Il n’empêche qu’il était dit qu’il y avait aggravation des situations familiales et augmentation des placements. Parce que la "prévention", disait Charlotte Carpentier-Lecocq, permet de mieux déceler les maltraitances (et de mieux aider des parents défaillants, tout de même). Aucune réflexion sur ce qui pourrait expliquer que les situations familiales s’aggravent justifiant davantage de suivis et de prises en charge. Qu’est-ce qui fait que notre société va mal ? Pas sûr que les promoteurs de ces soirées télévisées aient envie de le savoir : ce qui compte pour eux ce n’est pas de s’interroger sur le mal-être qui règne ni de montrer comment on peut aider des parents à mieux exercer leur fonction de parents, pas seulement par l’accompagnement éducatif, social et psychologique, mais aussi par une conception solidaire du développement social, sans enfermer les citoyens dans l’individualisme et la compétition. Mais ça c’est trop leur demander. En attendant, Bébés placés, La vie devant eux est un documentaire qui montre comment des professionnel·les, disposant de moyens, peuvent travailler au bien-être des enfants.
. en replay jusqu'au 23 mai 2024 : Bébés placés, La vie devant eux.
. Karine Dusfour a réalisé le documentaire Bouche cousue, diffusé sur France 2 en novembre 2020 : voir mon article Bouche cousue ou la parole aux enfants.
. Faut-il recentrer l’Aide sociale à l’enfance ?
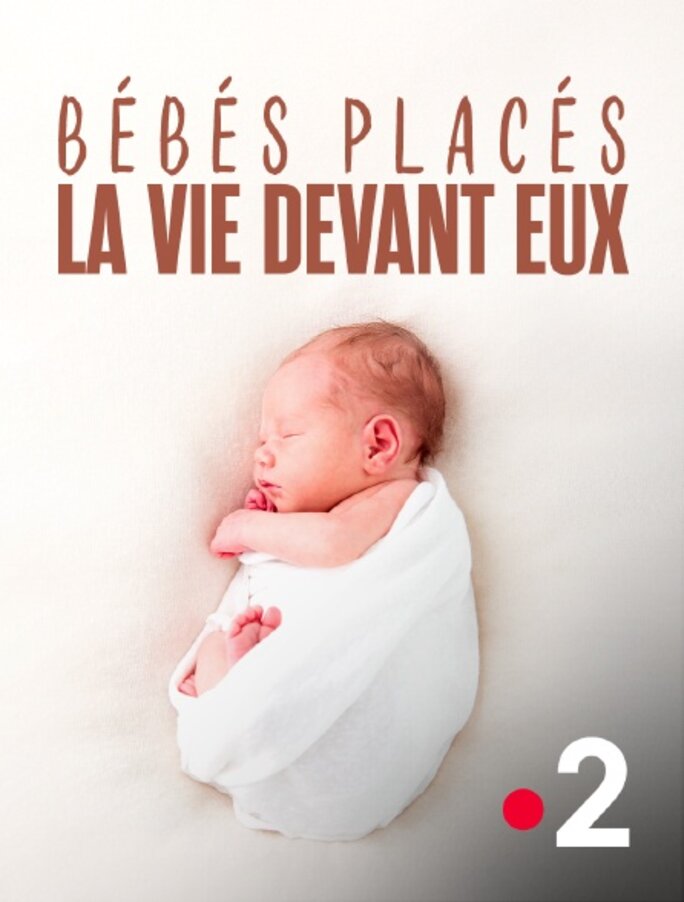
Billet n° 771
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



