
Agrandissement : Illustration 1

Résumé de l'article :
L’histoire de Stella : dans le film, très bien fait, des institutrices s’inquiètent pour cette enfant, souvent absente, et présentant des traces sur le corps pouvant être attribuées à des coups. La saisine de la Justice tarde, les services sociaux attendent les conclusions de l’enquête de gendarmerie qui, finalement, ne conclut à rien. L’affaire est classée : puis les parents annoncent la disparition de leur enfant. Il s’avèrera qu’ils l’ont tuée.
L’histoire de Marina : le film raconte assez fidèlement ce qu’a vécu Marina. Je reviens sur cette affaire dramatique qui a défrayé la chronique et reste emblématique d’une mort d’enfant qui aurait peut-être pu être évitée, car il y avait de nombreux signes avant-coureurs. Ayant étudié un rapport de 93 pages sur l’affaire, je démontre non seulement la complexité de la situation, mais apporte des précisions que les médias à l’époque, comme souvent, ont totalement négligé, plus soucieux de critiquer le dispositif de Protection de l’enfance, c’est-à-dire, finalement, de trouver à mettre en pâture à l’opinion publique un coupable qui ne soit pas seulement les parents, tant l’acte qu’ils ont commis est abominable.
Le débat : après le film, France 2 a organisé un débat qui, comme c’est souvent le cas, ignorait carrément les professionnels de la Protection de l’enfance : travailleurs sociaux, juges des enfants, responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Une gendarme décrivait judicieusement sa façon de travailler, une psychologue la sienne, dans le cadre d’une enquête judiciaire. Deux témoins racontaient leur histoire personnelle. Mais une représentante d’association, qui a pour habitude de mettre en cause les travailleurs sociaux, quitte à les poursuivre en justice, faisait étalage de sa flagornerie envers le ministre Adrien Taquet. Ce dernier, comme souvent quand il apparaît dans une émission, était ménagé par des intervieweurs qui connaissent peu le sujet sinon de façon affective : là, il n’a pas eu un mot à propos des professionnels de l’éducatif et du social qui œuvrent chaque jour dans des conditions difficiles, pour la protection des enfants, sans que cette politique sociale ne soit réellement portée par les pouvoirs publics.
_______
L’histoire de Stella

Agrandissement : Illustration 2

Le film raconte l’histoire d’une petite fille, Stella, qui présente régulièrement à l’école des traces d’ecchymoses qui inquiètent les enseignantes. Mais l’enfant trouve toujours une explication banale (elle tombe souvent), elle s’accuse et ne met jamais en cause ses parents. Le père a réponse à tout, donne le sentiment verbalement de se préoccuper de sa fille, tout en expliquant les traces aux poignets ou aux chevilles par les actes maladroits de l’enfant. Malgré ses engagements, il tient rarement parole, rate des rendez-vous, dit avoir perdu le carnet de santé, affirme à tort qu’il a conduit Stella à l’hôpital. Quand elle est absente, ce qui est fréquent, il y a toujours un certificat médical à l’appui, même si ce n’est jamais le même médecin. Mais il donne le change : au collège, il est très apprécié, très engagé, il s’occupe bénévolement d’une équipe de handball.
Un médecin scolaire sollicité ne semble pas se préoccuper outre mesure des informations données par les institutrices. Quand il finit par l’ausculter il ne prend même pas la peine de la déshabiller. Il suspecte un retard mental, expose ses a priori (ce sont les mères les plus maltraitantes) et reproche à l’institutrice de vouloir lancer une « machine infernale » en signalant. Il lui oppose cet argument plutôt pertinent : « mais si vous êtes si convaincue, pourquoi vous n’avez pas fait de signalement pour absentéisme inquiétant » (à l’Inspection d’Académie) ?
La réalisatrice, Eleonor Faucher, traite avec finesse le scénario, avec une montée crescendo : Céline, l’institutrice (Isabelle Carré, merveilleuse dans ce rôle), est incertaine : faut-il signaler ou pas, ne risque-t-elle pas de se tromper. Elle sollicite l’avis d’une collègue. Stella est capable d’affirmer qu’elle a reçu plein de cadeaux à son anniversaire, sans être capable d’en décrire aucun. Céline finit par téléphoner au rectorat, mais la famille disparaît : elle a déménagé dans un autre département. La directrice de cette nouvelle école, Emma (Émilie Dequenne, déterminée), informée de tout ce qui a précédé, reçoit les parents, ne se laisse pas impressionner par le comportement flagorneur du père, et décide de saisir l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) qui informe le Procureur. Ce dernier fait convoquer l’enfant dans une unité médico-légale. Stella est alors examinée : ses plaies dans le dos, elle les attribue à des chutes de vélo, de skate board. Stella présente 19 lésions, mais elle en donne, pour chacune, la raison : la médecin-légiste estime « qu’on ne peut pas exclure des mauvais traitements ». Stella est entendue par la gendarmerie, mais là le film est très discret sur ce que l’enfant a pu déclarer. On comprend simplement que l’affaire a été classée sans suite par le Parquet, sans en informer une responsable de l'ASE qui attend pour agir de connaître les conclusions de l’enquête judiciaire et qui a bien d’autres urgences : « des priorités, je n’ai que ça ».

Agrandissement : Illustration 3

Mais la situation de Stella se dégrade : elle est blessée aux pieds, elle est donc hospitalisée. Les personnels soignants constatent non seulement une surinfection douteuse de la plante des pieds, mais aussi le comportement sans affection des parents, qui viennent peu lui rendre visite ou ne s’attardent pas, à la stupéfaction de la mère d’un autre enfant hospitalisé dans la même chambre. L’hôpital Necker examine une fracture, avec suspicion de maltraitance. La travailleuse sociale de l’ASE est prévenue et se rend au domicile où elle est reçue avec hospitalité : elle visite la « jolie » chambre de l’enfant. Elle propose l’intervention de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), et la possibilité d’envoyer les enfants en vacances (grâce aux bons CAF). Manifestement, on nous dit que les services éducatifs et sociaux font confiance aux parents, tandis que la directrice de l’école leur reproche de se laisser enfumer : l’ASE promet d’appeler tous les jours pendant les vacances et d’envoyer une aide à domicile à la rentrée de septembre.
Les parents, qui prennent très mal ces suspicions, s’en vont à nouveau dans un autre département pour fuir toute surveillance puis ils signalent à la police que leur fille a disparu. Ils éclatent en sanglot, une Alerte enlèvement est lancée. La police ne semble pas être informée d’emblée que cette famille a déjà un dossier lourd (enquête de la gendarmerie). Finalement, la suspicion qui pèse sur eux oriente les interrogatoires, et le couple finit par avouer « une correction qui a mal tourné ». Pendant plusieurs jours, la police a été trompée, l’opinion publique aussi par les larmes des parents devant les objectifs des caméras.
Ce film est très bien construit, tourné avec humanité, joué par des acteurs de talent, dont Damien Jouillerot (le père) et l’enfant, Elsa Hyvaert. Cette « fiction » est de meilleure qualité que bien des documentaires, comme Enfance en souffrance… la honte, d’Alexandra Riguet (France 5, 2014) ou celui qui a été diffusé, sur France 3 également, en janvier dernier, Enfants placés, les sacrifiés de la République, présenté par toute une propagande comme étant à l’origine de la création du poste de secrétaire d’État à la Protection de l’enfance. Certains auraient préféré que soit nommée à ce poste une députée LREM, pour la raison qu’elle a été jadis une enfant placée. Cette supériorité de la fiction, j’avais déjà été amené à la relever, suite à la sortie des films La Tête haute ou Les Invisibles.
L’histoire de Marina
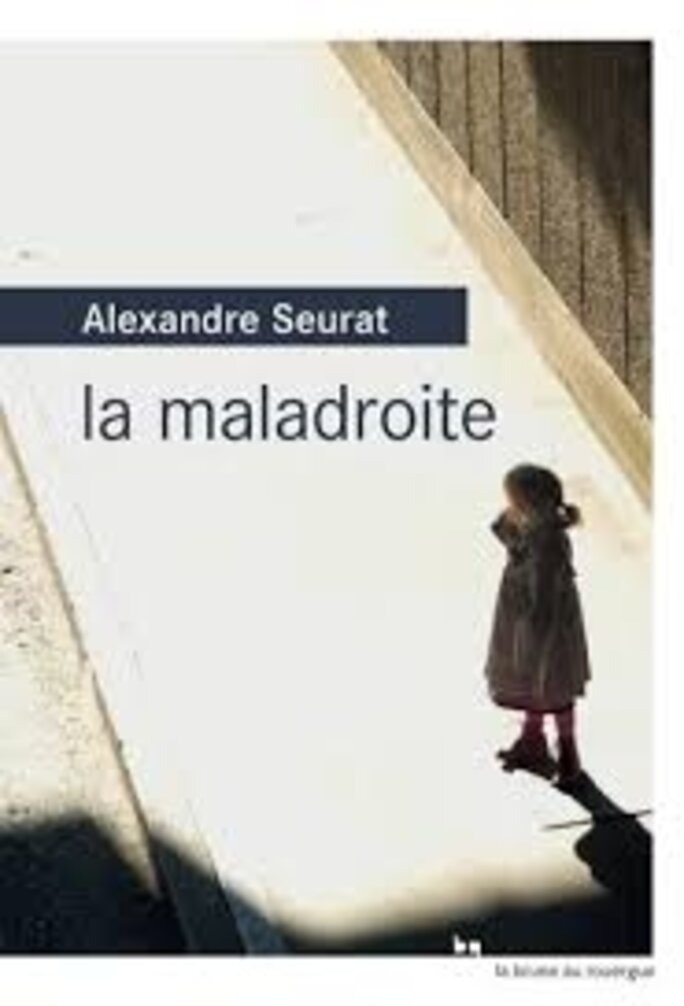
Le récit est particulièrement fidèle à l’histoire vraie de la petite Marina, même si le film s’appuie plus précisément sur le roman éponyme d’Alexandre Seurat qui lui-même retraçait l’affaire. Le scénario met l’accent sur la vigilance des instits qui rapidement comprennent que l’enfant est maltraitée, ainsi elles ont été les bons éléments pour les médias et pour le film, ce qui n’est pas le cas des autres professionnels, même si la réalisatrice démontre sa volonté de ne pas caricaturer.
L’affaire de la petite Marina Sabathier (Sarthe) a défrayé la chronique, car elle a fait l’objet de plusieurs procès. Des bribes d’informations ont été abordées dans la presse, les médias répétant les mêmes choses, souvent les mêmes erreurs. Par exemple, il a été immédiatement admis que le médecin scolaire avait mal réagi (ce que le film corrobore) : or un rapport détaillé, quelques années plus tard, a permis de constater que l’information avait été bien souvent simplifiée sur cette affaire. Le médecin scolaire a profité de la visite dite « des 6 ans » pour voir l’enfant, les marques sont anciennes, il ne constate rien d’inquiétant, mais demande aux institutrices de signaler l’absentéisme à l’Inspection d’Académie, ce qu’elles ne feront pas et ce qui ne sera jamais évoqué dans les comptes rendus de presse. Quand leurs craintes s'accroîtront, elles ne saisiront jamais la justice. On est un peu dans le cas de figure du film de Bertrand Tavernier, Ça commence aujourd’hui, où le directeur d’école maternelle (Philippe Torreton) devait se battre, face à la misère des familles, contre l’administration et l’assistante sociale (en somme, l’assistante sociale c’était lui). Tavernier racontait l’histoire d’un ami personnel, Dominique Sampiero, écrivain, poète et scénariste, ancien directeur d’école maternelle.

Agrandissement : Illustration 5

Les services sociaux mettent en place rapidement un suivi : visite de la puéricultrice, proposition d’intervention d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) mais la mère refuse. Quand l’ASE finira par savoir que le Parquet a classé l’affaire, le service social du département se rendra plusieurs fois au domicile. Marina est présente, s’exprime avec aisance, très souriante. Le logement a été entièrement visité, ce qui est rare et ce qui est en total décalage avec un certain discours qui prétendait que le service social n’avait pas bougé. Lorsque la fillette est hospitalisée, le personnel hospitalier note l’attachement de l’enfant à ses parents, il y a suspicion de maltraitances mais aucune certitude, ce qui fait que l’hôpital fait part à l’ASE de ses interrogations sur les conditions de vie de l’enfant sans fournir de certificat médical, et donc sans saisir les autorités judiciaires.
Pendant l’été 2009, la famille n’est pas joignable puis, lorsqu’elle revient de vacances, l’enfant n’est jamais là. Finalement, c’est la disparition de Marina et sa mort.
Un des points clé de l’affaire est le fait que la gendarmerie a mené l’enquête, a interrogé la fillette, l’a filmée, comme la procédure le prévoit (pour éviter à l’enfant de répéter dix fois le même témoignage qui servira de preuve au procès) mais les enquêteurs, après 44 minutes d’interrogatoire avec une enfant « détendue », « en confiance », ne décèlent aucune maltraitance. Au moment du procès, la bande-son sera diffusée (elle est reprise dans le film en voix off) : interrogée pour savoir si elle est battue, Marina avait répondu que non, sauf ses frères et sœurs. A la question précise « personne ne te fait du mal ? », elle répond alors : « sauf maman et mon papa », ajoutant aussitôt : « mon papa, il tape pas et maman aussi ». Cette formulation ambiguë sera présentée par certains comme la preuve qu’elle avait dit aux gendarmes qu’elle était battue et qu’ils n’en avaient rien fait. Ils s’étaient rendus à domicile : la maison était bien tenue, les enfants en bonne santé. Ils avaient alors conclu : « il ne ressort aucun élément susceptible de présumer que Marina S. a été victime de maltraitance ».
Le Procureur classe sans suite mais n’en informe pas les services sociaux, qui attendent avant d’agir de connaître la conclusion de l’enquête diligentée par le Parquet. En effet, il est arrivé que certains procureurs et services d’enquête prennent très mal que les services sociaux interfèrent dans une enquête policière (interviewé sur le sujet, j’ai été amené à en rendre compte sur les antennes de France Culture en avril 2013). Quand le service social reprendra le suivi, on ne sera plus loin du dénouement final.

Quand on visualise La Maladroite, on connaît ce dénouement final, on sait que l’enfant va mourir. Sauf que dans la réalité, il en est tout autrement. Sans nier qu’il y avait dans cette affaire des éléments vraiment inquiétants, que constataient les institutrices, que relevaient plusieurs observateurs, personne n’imaginait que l’enfant puisse mourir. La preuve est tout de même que la Gendarmerie n’a rien décelé, que le Procureur a classé, que l’hôpital n’a rien signalé à la Justice, que les institutrices n’ont pas signalé l’absentéisme, que les voisins n’ont rien vu, que l’entourage familial n’a rien dit (il prétendra le contraire sans jamais en apporter la preuve) et que le seul signalement à la Justice a été fait selon la procédure non urgente, via l’ASE (alors que quiconque, en cas d’urgence, peut signaler directement au Parquet). Ceux qui, loin des faits, considèrent que tout était clair n’ont bien souvent jamais rencontré de situations familiales difficiles, dans lesquelles les parents s’y prennent très mal avec leurs enfants, sans que pour autant on se précipite pour procéder au placement immédiat de leurs enfants. Par contre, là, connaissant la fin de l’histoire, ils proclament : c’était évident ! Ils utiliseront une photo de l’enfant pour dire que manifestement elle avait le visage d’une enfant battu.
Le film dit rien des autres enfants de l’école (à part qu’on en voit se comporter de façon rejetante envers Stella). Mais y avait-il d’autres enfants en difficulté, présentant aussi des traces suspectes, ou était-elle, comme cela semble être le cas, seule à vivre une telle situation ?
Je ne développe pas davantage ici : voir les nombreux articles que j’ai publiés sur ces questions graves, que j’ai eu à approcher durant plusieurs années au cours de ma carrière professionnelle, entre travail d’accompagnement éducatif des familles pour les aider à savoir mieux prendre en charge leurs enfants mais aussi contribution à des retraits d’enfants dans des cas graves, sans attendre qu’ils soient à l’article de la mort, beaucoup de placements d’enfants se faisant avec un maintien de liens avec les parents.

Agrandissement : Illustration 7

Débat sur France 3 :
Comme on parlait d’enfance maltraitée, il importait bien sûr qu’aucun éducateur ou assistant social ne soit invité, ni aucun juge, aucun responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance. C’est ce à quoi a veillé la chaîne, comme tant d’autres avant elle. Pensez donc, si vous voulez surfer sur la sensibilité du téléspectateur, il faut surtout pas avoir des professionnels de la protection de l’enfance qui approcheraient cette dernière dans son ensemble et non pas seulement à propos des cas les plus sordides.
Il y a Adrien Taquet, secrétaire d’État à la Protection de l’enfance (normal), une psychologue d’une unité médico-judiciaire, deux témoins (Thierry Beccaro et Laurence Brunet-Jambu), une gendarme formée au recueil de la parole des enfants et Martine Brousse, présidente de La Voix de l’Enfant. Cette dernière est présentée par Carole Gaesler, qui anime le débat, comme engagée depuis 40 ans dans ce combat. Son livre avec Carole Bouquet est cité : Enfants maltraités, Occupons-nous de ce qui ne nous regarde pas (Cherche-Midi, 2019). Il ne sera pas dit, car on n’est pas là pour polémiquer, que Carole Bouquet s’est beaucoup servie de cet engagement pour parfaire sa notoriété d’actrice, et que toutes deux ont milité à la tête de l’association Enfance et Partage, de triste mémoire, puisque l’association de leur époque fut l’objet de poursuites judiciaires quant à l’utilisation des fonds.

Agrandissement : Illustration 8

Martine Brousse va tout au long du débat tenter d’occuper le terrain, coupant la parole à d’autres. On découvrira que la psychologue c’est elle qui l’a amenée (elle milite aussi à La Voix de l’enfant), ce qui conforte l’ambiance d’entre-soi de ce genre d’émission. Elle ne va cesser d’encenser Adrien Taquet, qui lui renverra la balle mais, les flagorneries pleuvant comme à Gravelotte, il a dû finalement considérer qu’elle en faisait un peu trop. Selon elle, tout va bien dans le secteur depuis qu’il est arrivé au ministère. Elle semble avoir accompagné le ministre dans une visite du 119 : elle souhaite qu’un retrait d’enfant soit possible à partir d’un signalement au 119 (cela suppose une évaluation sur le terrain, sinon c’est totalement irresponsable). Elle a prôné la tranversalité : ce qui est souhaitable, mais pour ma part, je dirai plutôt la complémentarité (car chacun n’est pas dans les fonctions de l’autre), la confusion générale n’est pas le meilleur moyen d’améliorer les interventions. Ce qui est sûr c’est qu’il importe de débriefer les erreurs afin de ne pas les renouveler. Et évidemment, les intervenants doivent rapprocher leurs conceptions, c’est ainsi qu’un référentiel commun de repérage des enfants en danger, tel qu’annoncé par Adrien Taquet, est une bonne chose, même si l’on peut d’emblée imaginer que la mise en pratique ne sera pas simple, car il y a toujours un fossé entre l’idée et l’acte, entre le principe et la réalité concrète.
Martine Brousse scandait : « il n’est pas question de culpabiliser », glissait que son association suivait 60 dossiers ( !), dont, dans le passé, celui de l’affaire Marina, mais elle évitait de dire que, dans cette affaire dramatique, son association et celle de l’Enfant bleu avaient porté plainte contre le Conseil Général de la Sarthe (donc indirectement contre les travailleurs sociaux qui avaient eu à connaître de l’affaire), plainte classée sans suite pour la raison suivante : si les personnes ainsi mises en cause avaient conscience de la gravité de la situation de Marina, aucune n’avait refusé de réagir. Deux autres associations, Innocence en danger et Enfance et partage, avaient porté plainte contre l’État (dysfonctionnement de la Justice), plainte écartée, le tribunal de grande instance de Paris n’ayant pas reconnu de faute lourde. Ces quatre associations ont pris l’habitude depuis longtemps de se porter partie civile, moins contre les parents que contre les travailleurs sociaux qui, eux, sont tous les jours confrontés aux dures réalités de terrain et qui ne traitent pas 60 situations à l’échelle nationale, ce qui est peanuts, mais des milliers de cas. La mise en cause des services sociaux lorsqu’une affaire dramatique est révélée est surtout possible parce qu’il y a un effet de sidération sur les professionnels et que les directions et administrations font le choix de faire profil bas, donnant pour consignes aux professionnels de se taire (j’ai souvent eu l’occasion de dire que ce n’est pas une bonne stratégie : je défends l’idée que les intervenants doivent s’expliquer, même si, je l’admets, ce sera difficile car le débat public dans ces cas-là est simplifié à l’extrême).
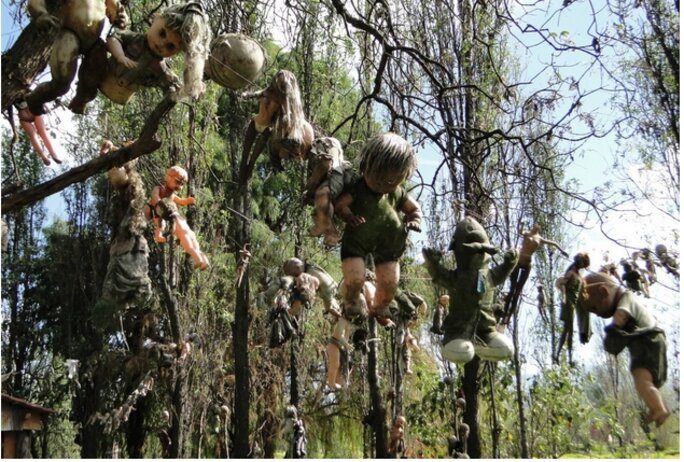
Agrandissement : Illustration 9

Adrien Taquet a constaté que deux appels sur trois au 119 nécessitaient de rappeler plus tard. Tout allait très bientôt changer, grâce à une subvention, comme si le quinquennat n’avait pas déjà deux ans et demi. Il explique que des dispositifs ont été instaurés depuis l’affaire Marina : loi de 2007 (qui date en réalité d’avant ce drame qui a eu lieu en 2009), décret de 2013, loi de 2016, référentiel premier semestre 2020, formations communes (Éducation nationale, travailleurs sociaux, forces de l’ordre), possibilité depuis le mois dernier pour les juges des enfants de décider à deux dans certains cas (car Carole Gaesler s’étonnait que le juge soit seul). Il critique le fait « qu’on ait privilégié le lien biologique à tout prix », élément de langage qui satisfera un courant idéologique sur le sujet, mais ce propos est prononcé à la légère. En effet, on peut toujours reprocher à la Protection de l’enfance de favoriser les liens parentaux, mais non seulement parler de « lien biologique » est simpliste et inapproprié, mais en plus ce ne sont pas les travailleurs sociaux, les responsables de l’ASE qui agiraient ainsi selon leurs caprices, mais la loi qui depuis des décennies les incite à le faire, ainsi qu’une Convention internationale. Il y a suffisamment d’enfants placés (176240 en 2017), dont 72 % par les juges des enfants, pour démontrer que ce lien parental n’est pas privilégié envers et contre tout.
Le ministre a poursuivi par l’hommage appuyé rendu aux associations disant lutter contre la maltraitance, affirmant qu’ « elles ont été moteurs » dans la mise en place des dispositifs des unités médico-légales, précisant que ces associations sont au nombre d' « une soixantaine ». Outre que ce chiffre me parait exagéré, il y a une certaine irresponsabilité pour un ministre à louer ainsi des associations dont la plupart sont surtout préoccupées à faire le buzz, dont l’engagement auprès des enfants maltraités reste davantage dans la communication publique que dans un travail concret de terrain (certaines envoient leurs avocats pour débattre à la radio tellement leurs dirigeant(e)s sont incapables de le faire), qui passent beaucoup de temps à collecter des fonds, et qui, comme on l’a vu, se permettent d’engager des procès à l’encontre des professionnels qui, eux, sont réellement sur le terrain, au quotidien. Cette irresponsabilité est d’autant plus grande qu’une fois de plus le ministre ne dit pas un mot de ces professionnels : on ne cesse d’encenser le travail des soignants dans les hôpitaux, mais pas celui des professionnels du social. Puisqu'il faut bien des coupables quand des parents se comportent de façon à ce point criminel avec leur enfant, ces parents coupables ne suffisant pas pour soulager la colère, alors, comme on stigmatisait jadis « la DDASS », on cloue au pilori « l’ASE » et on jette le discrédit sur des travailleurs sociaux qui sont au premier rang pour assurer la protection de l’enfance. Il va de soi que si le ministre réussit plus ou moins ses sorties médiatiques (sachant qu’il est ménagé par des intervieweurs qui connaissent peu le sujet, comme ce fut le cas chez Ruquier), c’est aussi parce qu’il cherche à rester sur le terrain de la maltraitance, forcément consensuel : alors il peut prendre un air malheureux, manifester sa compassion, mais il sait que la politique sociale gouvernementale a peu de chance d’être attaquée sur ce terrain (d’autant plus que ce n’est pas elle qui est essentiellement actrice en ce domaine).

Agrandissement : Illustration 10

Adrien Taquet a annoncé qu’avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ils avaient décidé la mise en place d’une unité médico-légale dans chaque département (actuellement il n’y en a que 60 dans toute la France). Très bien, mais il ne faudrait pas oublier que dans le cas de Marina, l’évaluation en audition filmée par la gendarmerie et par un médecin légiste n’a rien donnée. Pire, cela a plutôt freiné les interventions sociales qui étaient suspendues à ces conclusions et se retenaient d’agir, comptant sur une décision autoritaire de la justice qui ne vint pas.
Le débat finalement valait pour ce qu’a dit de son expérience personnelle Thierry Beccaro (un père en état d’ébriété qui battait ses enfants mais était « un papa formidable »), mais aussi Chantal Capdeville, gendarme, qui expliquait les méthodes pour entendre les enfants en déposition, et Laurence Brunet-Jambu (auteur de Signalements, livre paru en octobre dernier) qui a mené le combat pour que sa nièce lui soit confiée : elle dénonçait la façon dont le danger a été minimisé par les professionnels (qui se concertaient pourtant). Elle contestait que les Départements aient à gérer l’Aide Sociale à l’Enfance. On imagine qu’elle allait dire que l’État serait plus à même d’assurer une gestion cohérente (on sait que dans le débat actuel certains défendent une gouvernance centralisée, revendication qui ne tient compte ni des raisons profondes qui ont présidé à une approche de proximité, et donc décentralisée, ni des manques notoires dont faisait preuve l’Etat avant la décentralisation). Mais elle n’a pu développer, interrompue aussitôt par le ministre qui ne tient pas à récupérer le bébé (à une recentralisation de l’enfance en danger) et qui a argumenté en citant le « référentiel » qui réglerait tout. Il a sorti des lieux communs (« il faut remettre l’enfant au centre ») comme si on avait attendu M. Taquet pour dire que l’intérêt de l’enfant (si difficile à définir au demeurant) devait être prioritaire. Il déroulait quelques affirmations approximatives sur le secret professionnel des médecins, sachant qu’il n’est pas simple dans un débat public d’être précis sur un tel sujet.
Il dit, ce qui est vrai, que dans l’affaire Marina, la mère avait d’abord abandonné son enfant et qu’elle s’est rétractée comme la loi le lui permet, mais sans qu’elle ait fait l’objet d’un accompagnement particulier : ce point, qui a été laissé un peu de côté au moment du procès, est fondamental. Le ministre dit que, depuis, dans de telles situations, un accompagnement spécifique est désormais obligatoire.

Agrandissement : Illustration 11

Carole Gaesler semble avoir voulu éviter au début que l’on fasse le lien avec la petite Marina, mais finalement elle ne cessera de dire au cours du débat que c’est son histoire. Elle précise d’entrée de jeu que 50.000 enfants sont victimes de violences dans le huis-clos familial (je me permets d’indiquer qu’une circulaire officielle du 9 juillet 1985 donnait déjà exactement ce chiffre que l’on retrouve depuis sans cesse dans les déclarations publiques). Elle rappelle qu’un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents, chiffre que reprendra Martine Brousse, présidente de l’association La Voix de l’enfant et Adrien Taquet le secrétaire d’État à la Protection de l’enfance (lui ajoutera, comme à chaque fois : « peut-être deux par semaine »). On doit cependant reconnaître que c’est un progrès car dans le landerneau on a longtemps affirmé que c’était deux enfants tués par leurs parents chaque jour. C’était évidemment faux, corroboré par aucun chiffre, chacun le savait : cette statistique inventée (étaient annoncés exactement 730 enfants tués par an, soit du coup, comme par hasard, deux par jour) était colportée par le ministère, par les médias et par les associations dites de défense des enfants maltraités, comme La Voix de l’enfant, jusqu’à ce que mon ami Laurent Puech, assistant social, publie en 2018 une longue étude sur le site du sociologue Laurent Mucchielli démontrant que ce chiffre invoqué pour mobiliser la société était faux et avait un effet contre-productif puisqu’il incitait à penser qu’il n’y avait rien à faire ce chiffre étant très élevé et ne variant jamais. C’est lui, Laurent Puech, avec force démonstration, qui montra que chaque année 57 enfants étaient tués (dont 43 par un membre de la famille). Le chiffre officiel désormais, pour 2016, est de 67 infanticides commis dans le cadre intrafamilial. Il y a 5 ans, dans un article sur ce blog de Mediapart j’écrivais, sans avoir mené d’enquête approfondie et donc sans prétendre que mon chiffre était l’absolue vérité : « je pense que s’il y en a 70 (dont pour moitié des « bébés secoués ») c’est bien sûr 70 de trop. Je n’ai pas besoin d’afficher un chiffre, non prouvé, dix fois supérieur pour m’en préoccuper. Je rappelle que Bertrand Boulin, psychologue, prétendait sans vergogne dans les années 70, pour être entendu, qu’il y avait 8000 enfants tués chaque année dans leur famille ! »
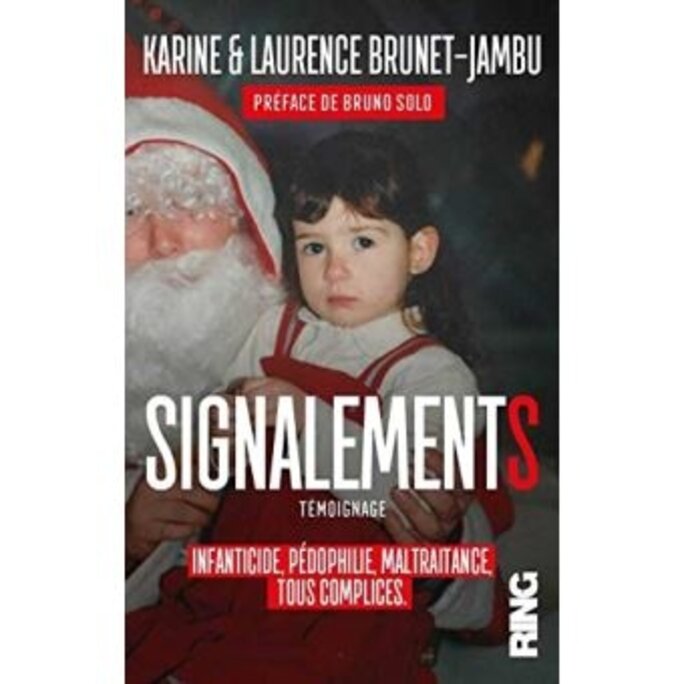
Enfin, Laurence Brunet-Jambu réclamait que la Protection de l’enfance soit repensée, affirmant que des enfants ne sont pas placés alors qu’ils devraient l’être et que d’autres sont placés sans raison. Elle réclamait un travail en amont avec les familles. Ce propos faisait ainsi la synthèse des reproches adressés au dispositif de protection de l’enfance en France : soit les uns l’accusent de trop procéder à des placements d’enfants, soit les autres de ne pas assez retirer les enfants à leurs parents défaillants. Les professionnels de l’éducatif et du social se sont faits une raison : ils savent qu’ils ne cesseront d’entendre ce genre de griefs. Ce qu’ils voudraient c’est pouvoir justement mener ce travail en amont des placements, auprès de familles en difficulté dans l’éducation de leurs enfants, sans être pour autant (et pour le moment) maltraitantes. Cela suppose que ce secteur soit pris en compte plus sérieusement dans les politiques publiques, sans chercher à satisfaire de façon démagogique une opinion publique prolixe sur le sujet mais au contraire en menant un travail d'explication et d'information approfondie. Et en donnant aux équipes professionnelles un cadre et des moyens leur permettant d'agir, et non pas en les invitant à gérer la pénurie.
Pour en savoir plus :
. Compte rendu de la mission confiée par le Défenseur des droits et son adjointe, la Défenseuse des enfants à M. Alain Grevot, Délégué thématique sur L’Histoire de Marina (93 pages) : ici.
Revue Empan :
. Enfants martyrisés : les « sociaux » coupables, par Yves Faucoup dans Empan, 2015, n°97 [article en accès libre sur Cairn.info].
Sur ce blog :
. Enfance en danger : entre dure réalité et recherche d’audience, 22 janvier 2019.
. La protection de l’enfance : un parcours d’obstacles, 20 novembre 2018.
. Drame du petit Bastien : les « sociaux » témoignent de leur action, 14 septembre 2015.
. Mort de Marina : l’exploitation de la tragédie, 4 octobre 2014.
. La mort de la petite Marina : la culpabilité des parents ne suffit pas, 12 avril 2013.
Le Monde :
. Affaire Marina : qui est responsable ?, par Yves Faucoup, Le Monde, 27 juin 2012.
Billet n° 512
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup
[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans le billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, les 200 premiers articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées. Le billet n°400, correspondant aux 10 ans de Mediapart et de mon abonnement, fait le point sur ma démarche d'écriture, en tant que chroniqueur social indépendant, c'est-à-dire en me fondant sur une expérience, des connaissances et en prenant position. Enfin, dans le billet n°500, je m’explique sur ma conception de la confusion des genres, ni chroniqueur, ni militant, mais chroniqueur militant, et dans le billet n°501 je développe une réflexion, à partir de mon parcours, sur l’engagement, ou le lien entre militantisme et professionnalisme]



