Le magazine Alternatives économiques a organisé les 24 et 25 novembre à Dijon les Journées de l’Économie autrement, dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire. Dans un premier article, j’ai présenté quelques interventions, dont celles de Marylise Léon (CFDT) et Sophie Binet (CGT), un débat sur le non-recours aux droits sanitaires et sociaux et un autre sur le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. Je tenais à rendre compte de deux interventions particulières : celle de Serge Paugam, sociologue, sur l’attachement social (titre éponyme de son dernier ouvrage) et Dominique Méda, sur "le monde post-croissance".
. voir L’économie autrement ou construire un avenir désirable, 8 décembre 2023, et La Solidarité ou nos quatre modes d’attachement social, 28 décembre 2023.
***
Dominique Méda est sociologue et philosophe. Elle est surdiplômée et a mis ses compétences au service du progrès social (École normale supérieure, ENA, agrégation de philosophie, habilitation universitaire en sociologie, elle a été membre de l’Inspection générale des affaires sociales [IGAS], responsable à la DARES, études et statistiques, actuellement professeure de sociologie à l’université Paris-Dauphine, où elle est par ailleurs directrice de l’Irisso, Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales qui accueille des enseignant·es et des chercheurs·ses, sociologues, politistes, économistes, dont les recherches portent sur les mondes de l’économie, le travail, l’action publique et la politisation).
Aux Journées de l’Économie autrement à Dijon, Dominique Méda, présentée comme une des rares personnes qui réfléchissent à la façon de bâtir un monde viable, avait pour mission d’aborder ce qu’est le monde "post-croissance". Elle était interviewée par Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques. Ce qui suit est tiré des notes que j’ai prises lors de cette conférence ainsi que d’un échange que j’ai eu avec elle ultérieurement.

Agrandissement : Illustration 1

D’emblée, Christian Chavagneux lui demande où en est le combat pour le climat : selon lui, on ne peut pas dire qu’il ne se passe pas rien mais c’est loin d’être suffisant. Dominique Méda considère qu’il y a des alertes de plus en plus fortes. On assiste même à de véritables régressions (exemple du glyphosate dans l’Union Européenne).
Pour les climato-sceptiques (qui se nomment eux-mêmes climato-réalistes), qui se font de plus en plus entendre, le changement climatique serait un vaste complot visant à permettre aux USA de réduire à néant l’industrie européenne. Les lobbys d’industriels s’organisent pour vendre leur discours. Des politiques résistent, les riches aussi (cf. Cash investigation sur les ultra-riches) et même les plus pauvres qui ont autre chose à penser, ainsi que les techno-solutionnistes et certains économistes. Il y a 50 ans, le rapport [Dennis et Donatella] Meadows, sur Les limites de la croissance, est précurseur mais il n’a pas été pris en compte et a même été discrédité par William D. Nordhaus, économiste américain, qui a bloqué, encore en 1983, la prise en compte d’un tel rapport qui mettait en évidence la gravité de la situation du climat [ce qui ne l’a pas empêché de se voir décerner le Prix dit Nobel d’économie en 2018 pour avoir intégré le changement climatique dans l’analyse macroéconomique de long terme].
Sicco Mansholt, vice-président de la Commission Européenne [CE], découvrant le rapport Meadows, écrit en 1972 une lettre au président de la CE lui proposant un programme de bifurcation radicale de l’économie, face à une crise climatique qu’il prédisait car certains indices étaient déjà visibles : il faut arrêter la croissance. Mais il n’est pas entendu. On lui tombe dessus, Georges Marchais (PC) s’oppose à l’Europe en invoquant justement cette lettre de Mansholt.
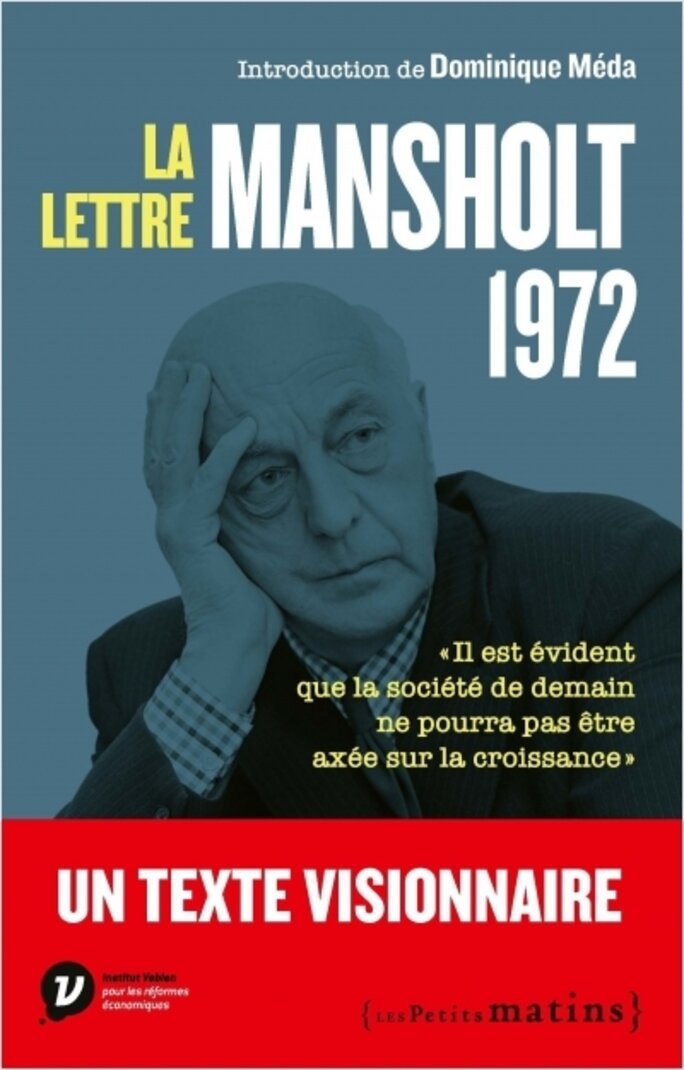
Agrandissement : Illustration 2
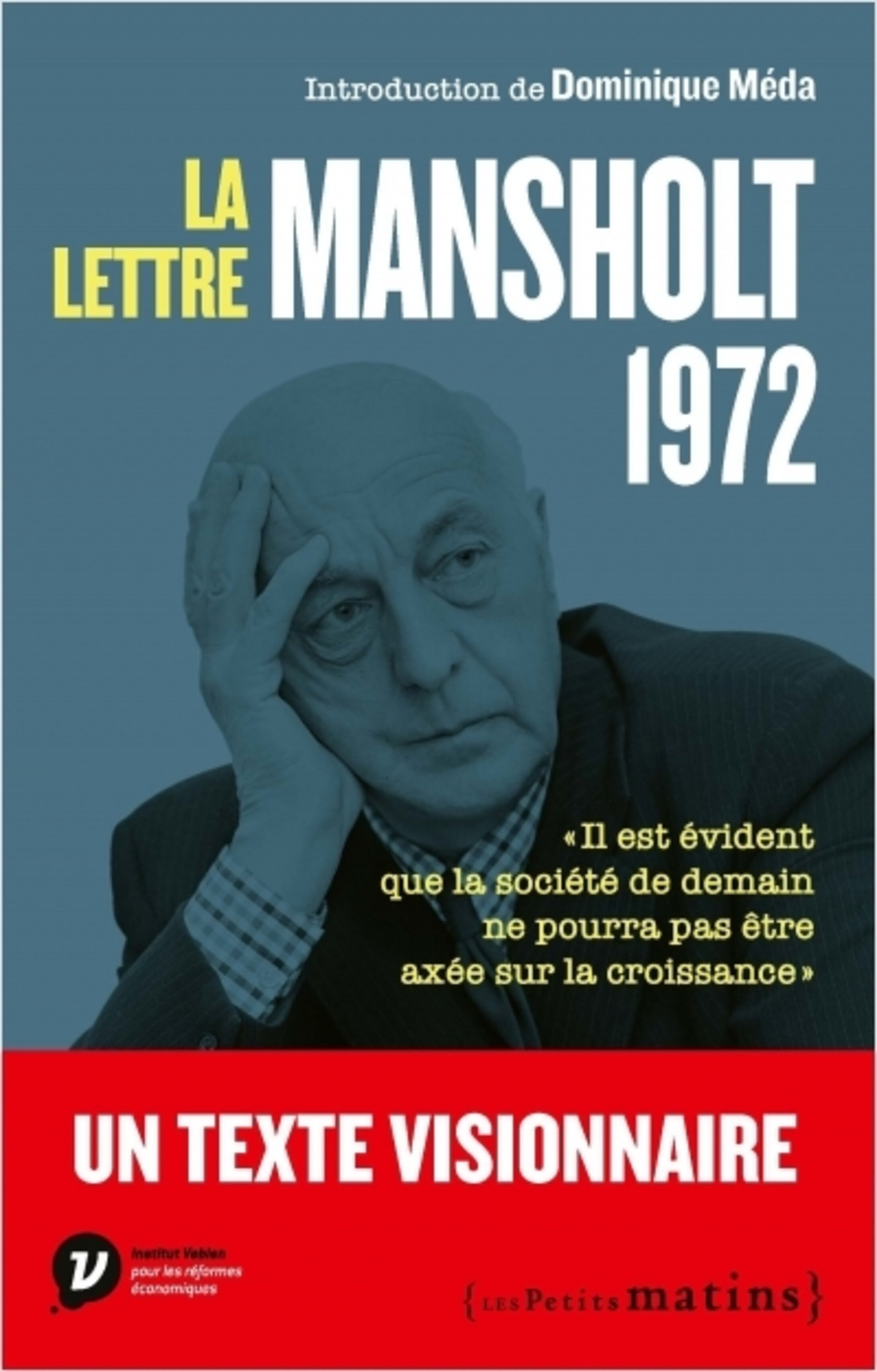
. voir La lettre Mansholt 1972, avec une préface de Dominique Méda, Les Petits matins, 80 pages.
Répondant à Christian Chavagneux qui lui demande si ce sont aux ultra-riches de faire un effort et de réduire leur consommation, Dominique Méda répond par l’affirmative : « car ils sont dans une consommation ostentatoire » (formule utilisée et démontrée par Thorstein Veblen, économiste et sociologue américain). Une partie de notre consommation nous permet de nous différencier, de marquer notre appartenance à un groupe : il n’y a pas de limites. Jean-Baptiste Say disait que la consommation est un acte si important que si on la limite l’homme devient comme une bête, une brute. Selon lui, consommer nous civilise.
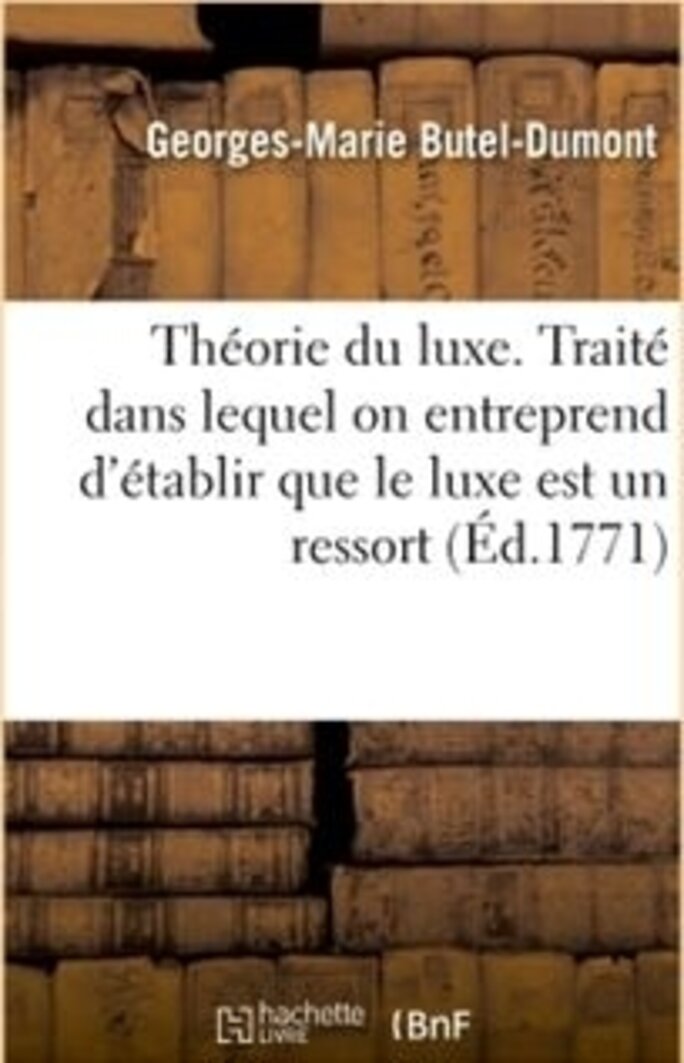
Or selon Oxfam, la question des riches n’est pas seulement celle de la consommation mais aussi des placements non vertueux, d’une consommation abusive (comme l’aviation). Par ailleurs, "les plus riches" ce sont aussi les pays les plus riches dans lesquels il importe de revoir complètement le système productif, ce qui suppose un basculement des valeurs semblable à celui qui est advenu au 18ème siècle. Jusqu’au 18ème siècle, la tempérance, la modération, l’auto-limitation étaient des vertus, tant antiques que chrétiennes. Le 18ème siècle est le moment d’un immense basculement des valeurs, comme en témoigne la Fable des abeilles de Mandeville et plus tard, les réflexions d’Adam Smith. Georges-Marie Butel-Dumont [1725-1788, économiste, auteur d’une théorie du luxe] considère que c’est produire plus qui assure la stabilité de l’État et que l’enrichissement individuel est bon pour le bien public.
Pour un basculement
Aujourd’hui, nous avons besoin d’un basculement de même ampleur : on ne pourra réduire la consommation si on reste dans un cadre où tout nous incite à consommer (cf. le Black Friday et le spot en retour de l’Ademe mettant en scène des "dévendeurs" qui invitent à ne pas acheter de matériels peu utilisés mais à les louer).
Christian Chavagneux se demande quels sont les besoins essentiels sur lesquels il faudrait se recentrer et s’ils ne vont pas être du coup plus chers ?
Pour Dominique Méda, il faut se détacher du PIB : cesser de vouloir augmenter la croissance du PIB à tout prix, adopter d’autres indicateurs de richesse, viser la satisfaction des besoins essentiels de tous. Les Économistes Atterrés ont écrit sur le sujet. Martha Nussbaum a proposé une liste des dix capabilités essentielles. Plusieurs articles ont mis en évidence qu’il était possible d’assurer tous les besoins essentiels qui font la vie bonne dans le monde entier en restant dans les limites planétaires. Mais cette notion de satisfaction des besoins essentiels de tous dans le monde est complexe car les niveaux de revenus et les conditions de vie sont aujourd’hui radicalement différents dans le monde : Pierre Concialdi a calculé qu’en France, un individu avait besoin de 1650 euros pour mener une vie normale. A l’évidence ce niveau de vie n’est pas universalisable : l’idée de decent living standard du GIEC suppose donc une redistribution gigantesque, dans notre pays et entre le Sud et le Nord. Pour répondre à la question : oui dans un premier moment le coût des produits élaborés dans le respect des critères environnementaux risque d’être plus élevé. Mais l’obligation, pour tous les produits, de respecter les normes environnementales et sociales et l’augmentation des quantités peuvent permettre de limiter cette augmentation.

Agrandissement : Illustration 4

La transition écologique, si elle est bien menée, devrait permettre à la fois de créer des emplois et de changer le travail. Dans son modèle de 2020, l’Ademe évalue à 600 000 le nombre d’emplois supplémentaires qui pourraient être créés grâce à la transition écologique. Le WWF et Ernst and Young évoquent, eux, le chiffre de 1,8 millions (à condition que les investissements nécessaires soient réalisés). Le Shift Project parle de 500 000 emplois nouveaux rien que dans l’agriculture. Mais il insiste aussi sur la diminution des emplois dans la construction neuve et l’automobile. Nous manquons d’études permettant de réaliser des projections incluant les relocalisations, les transferts d’emplois… sur l’ensemble du territoire. Le Plan de programmation des emplois et des compétences, élaboré en 2019, est insuffisant. Il y a un manque criant d’études sur les emplois nécessaires, sur l’aménagement du territoire nécessaire, sur les reconversions professionnelles qui adviendront et qui devraient absolument être anticipées.
Christian Chavagneux lui rappelle un de ses articles parlant d’anti-déversement. De quoi s’agit-il ? Dominique Méda explique qu’Alfred Sauvy avait proposé le concept de « déversement » : déversement de la main d’œuvre du secteur primaire vers le secteur secondaire, puis du secondaire vers le tertiaire… Nous allons peut-être assister à une forme d’anti-déversement : en effet, nous aurons besoin de plus d’effectifs dans l’agriculture (le bio est plus intensif en main d’œuvre que l’agriculture conventionnelle), on aura aussi besoin de main d’œuvre dans une industrie relocalisée. Globalement nous aurons besoin de plus de travail humain. La transition écologique est une opportunité pour créer des emplois mais aussi pour changer le travail. En effet, aujourd’hui les conditions de travail en France sont très mauvaises, comme l’ont mis en évidence la dernière vague de l’enquête française sur les conditions de travail ou la vague 2021 de l’enquête européenne sur les conditions de travail passée auprès de 75 000 personnes dans 36 pays. Le scénario que nous connaissons depuis une vingtaine d’années, consistant à démanteler le droit du travail a aggravé ces conditions.

Agrandissement : Illustration 5

Le scénario de la révolution technologique n’est pas plus vertueux. Celui qui nous permettrait de sortir notre pays de la double crise du travail et de l’emploi est le scénario de la reconversion écologique. Il pourrait permettre de désintensifier le travail. Comme Fourastié l’avait bien remarqué, nos sociétés industrielles font des gains de productivité en accroissant la domination humaine sur la nature. Nous devons prendre conscience des dégâts provoqués. D’où le terme de reconversion. On a besoin d’une conversion des mentalités, de nos représentations, de nos indicateurs, de nos politiques, de nos pratiques. Tous les acteurs sont concernés, Etat, ménages, entreprises. Certaines entreprises, par exemple celles rassemblées dans la Convention des entreprises pour le climat s’engagent dans cette reconversion. La directive européenne CSRD (sur les rapports de développement durable des entreprises), applicable au 1er janvier 2024, va contraindre les entreprises à définir leurs enjeux sociaux et environnementaux. Des entreprises s’interrogent sur l’impact qu’elles ont sur le climat, sur ce qu’elles peuvent mettre en œuvre en interne, certaines s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (Crédit Mutuel Arkéa, avec engagement d’une baisse de l’empreinte carbone de 25 % dans ses opérations, entre 2019 et 2024).
Cette reconversion consiste aussi à rompre avec l’obsession de la croissance, de la croissance du PIB. Depuis des années, Dominique Méda travaille, avec Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice sur cette idée de post-croissance. Il s’agit de changer d’indicateurs de richesse (enserrer la production dans l’empreinte carbone et l’indice de santé sociale) mais aussi d’engager des politiques publiques innovantes. En matière de transport par exemple, qui représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, de nombreuses propositions sont faites par le Forum Vies Mobiles, notamment en ce qui concerne les alternatives à la voiture individuelle et la possibilité de relocaliser des productions et des emplois dans les villes petites et moyennes. Trop de petites villes françaises sont devenues des déserts, privées de commerces de proximité et de services publics.

Agrandissement : Illustration 6
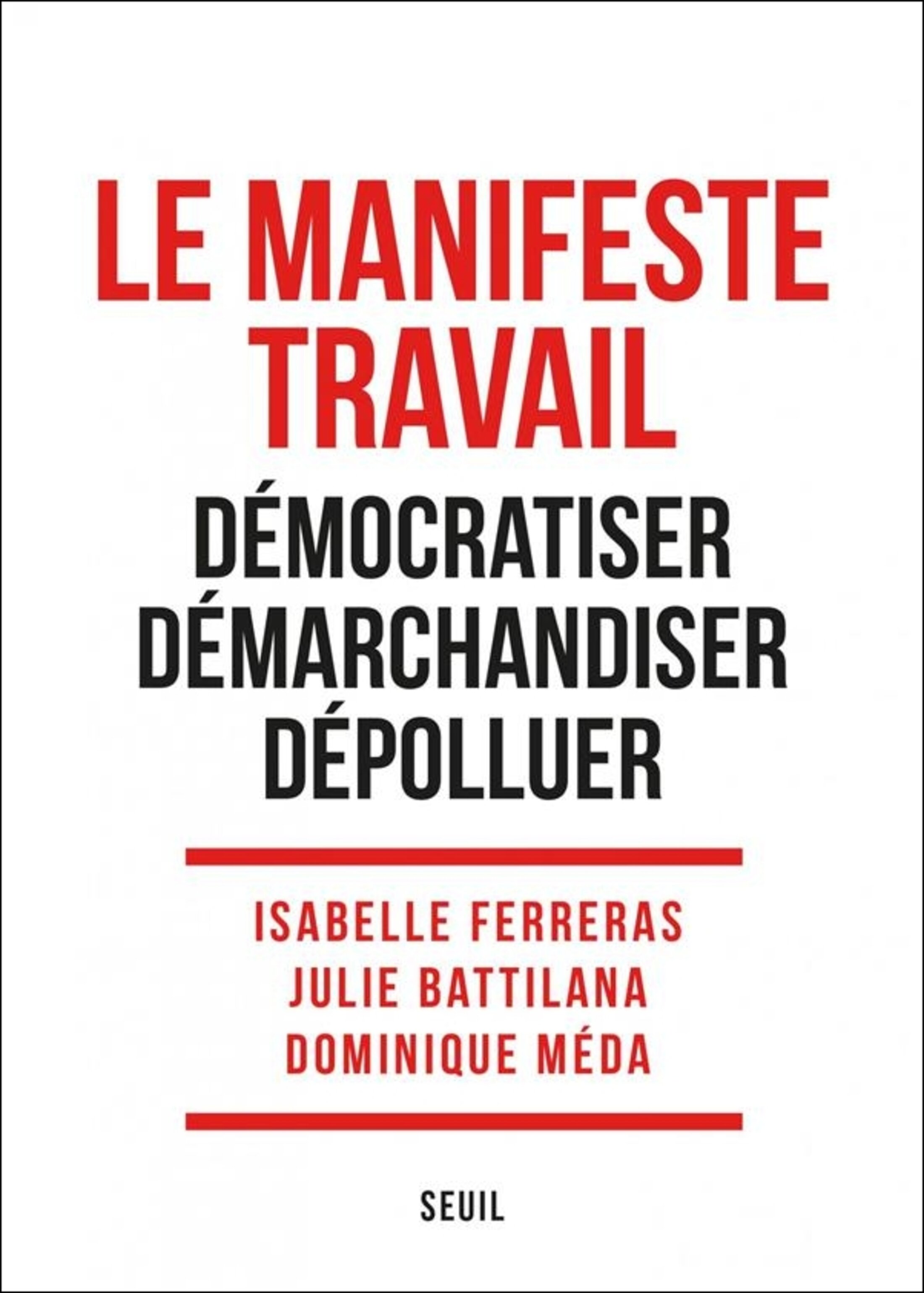
Sur la participation des salariés aux décisions des entreprises, Dominique Méda cite l’ouvrage qu’elle a écrit avec Isabelle Ferreras et Julie Battilana, Le Manifeste travail, dans lequel elles défendent l’idée qu’actionnaires et salariés soient représentés dans les instances dirigeantes à 50/50, comme en Allemagne et dans les Pays nordiques. En Allemagne, dans les plus grosses entreprises, actionnaires et salariés sont à égalité en nombre, même si les représentants des actionnaires ont une voix prépondérante. Elle cite une enquête menée par les Amis de la Terre, l’Institut Rousseau et l’Institut Vleben auprès de 266 salariés du secteur pétrolier et gazier : ils ont exprimé une inquiétude face à la crise du secteur, une prise de conscience aigüe du changement climatique et une forte volonté de reconversion. Cela suppose que les entreprises et l’État s’en chargent, ça doit être planifié nationalement et localement. Il faut un plan à 20 ans sur la façon de procéder pour réduire les gaz à effet de serre, dans quels territoires en priorité. Emmanuel Macron, lors de son discours à Marseille, en avril 2022, avait annoncé que la planification écologique serait directement rattachée au premier ministre, mais ça ne suffit pas. Sicco Mansholt parlait de planification nationale et européenne.
Christian Chavagneux, qui a été chargé de mission au Commissariat au Plan, valorise la façon de travailler de cette institution [à l’époque : il l’a quitté en 1988]. Dominique Méda constate que l’État a perdu de sa puissance. On avait de grandes entreprises de service public qui avaient des moyens. Ce n’est plus le cas : EDF, SNCF, l’État est désarmé, il doit sans cesse solliciter des investisseurs privés. Elle cite Une autre voie est possible écrit avec Éric Heyer et Pascal Lokiec (le capitalisme financier n’a pas su gérer ses dysfonctionnements, alors il a imposé l’austérité et accru les inégalités). Sans aller jusqu’au 75 % de taxation sur les hauts revenus (retoquée par le Conseil constitutionnel), il faudrait ajouter une ou deux tranches de revenus et un impôt sur le patrimoine ainsi que 5 % sur les 10 % les plus riches (comme le propose l’économiste, Jean Pisani-Ferry, qui fut proche de Macron).
Christian Chavagneux rappelle les utopies de la fin du 19ème siècle. Dominique Méda pense que la sobriété peut devenir un objectif partagé : pour celles et ceux qui gaspillent et surconsomment, il y a une certaine joie à sortir de la dépendance, avec de multiples co-bénéfices pour la santé, le lien social, le rythme de vie, les conditions de travail.
Au terme de décroissance, Dominique Méda préfère celui de post-croissance. Même si aucun des deux ne convient parfaitement. Elle revient à Sicco Mansholt : il parlait de « bonheur national », de « croissance positive », de croissance de la prospérité.
Bibliographie :
Dominique Méda est l’autrice d’un très grand nombre de livres, une trentaine, seule ou en collaboration. Ses travaux tournent autour du travail, des politiques sociales et de la transition écologique. Impossible de tous les citer ici.

. C’étaient les années Macron, éd. Flammarion, 2022, le dernier paru. Il s’agit du recueil de ses chroniques toujours passionnantes et informatives parues dans Le Monde chaque mois pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Dans l’avant-propos, elle livre des confidences qui expliquent bien son parcours : son souhait non pas seulement d’interpréter le monde (philosophie) mais de le transformer. Elle comptait sur l’ENA [promotion Liberté-Égalité-Fraternité] mais l’enseignement visait juste à être de bons gestionnaires des enveloppes imparties. Puis ce fut l’IGAS, par intérêt pour les questions sociales et la DARES, direction de la recherche, des études et des statistiques créée en 1993 par Martine Aubry, afin de contrebalancer les expertises de Bercy. Dans ces chroniques mensuelles, de nombreuses thématiques sur l’entreprise, la dérive du management français, le capitalisme, le salariat, les inégalités hommes-femmes, l’hôpital, la Sécu, les Territoires zéro chômeur, le changement climatique. Son propos est toujours compréhensif envers les citoyens victimes des inégalités sociales et prône, on s’en serait douté, une croissance respectant « la voie de la sobriété ».
. Le Manifeste travail – démocratiser, démarchandiser, dépolluer, Julie Battilana, Isabelle Ferreras, Dominique Méda, Le Seuil, 2020. A l’origine, il s’agissait d’une tribune que les trois autrices devaient publier dans Le Monde sur le jour d’après le premier confinement. C’est devenu un manifeste signé par 3000 scientifiques et publié dans 43 journaux sur cinq continents en mai 2020. Le modèle économique doit être changé face aux pandémies qui menacent, aux gouvernements autoritaires qui prolifèrent, aux inégalités sociales qui dénaturent l’idée même de démocratie. Cela passe, entre autres, par un pouvoir partagé à égalité entre travail et capital, des rémunérations en phase avec l’utilité sociale des salariés et une sécurité sociale de l’emploi.
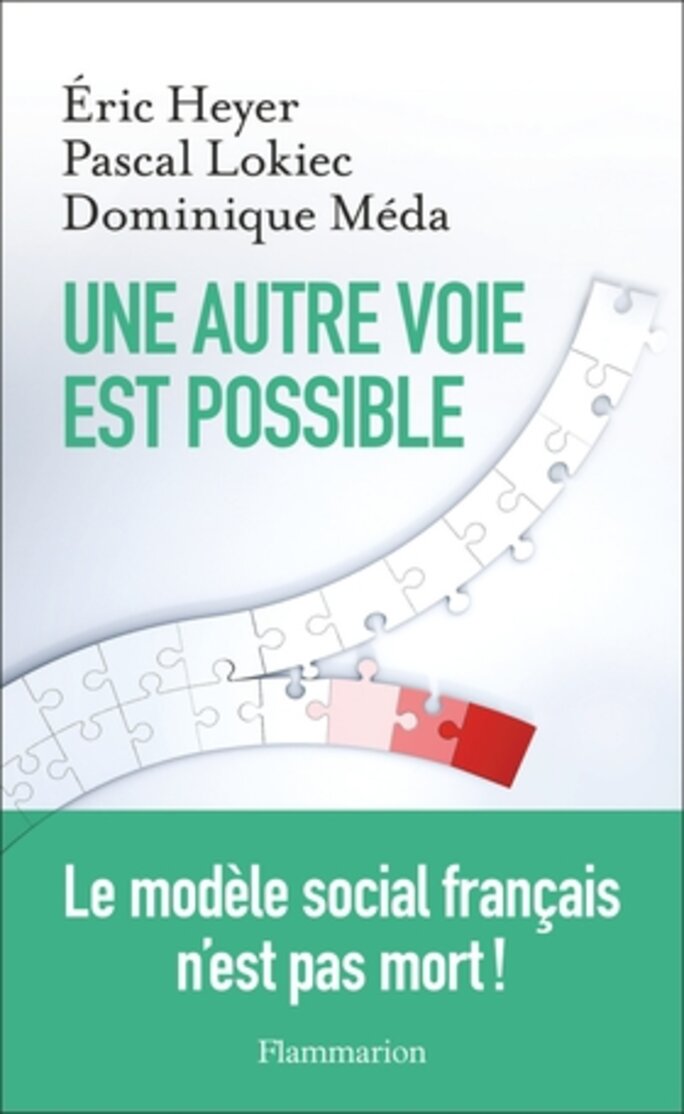
. Une autre voie est possible, Éric Heyer, Pascal Lokiec, Dominique Méda, éd. Flammarion, 2018. Cet ouvrage collectif démonte un certain nombre de lieux communs sur le chômage, la croissance, le Code du Travail. Les auteurs se prononcent clairement pour un État social qui accompagne à l’insertion sociale et professionnelle sans lésiner sur les aides financières nécessaires. Ils considèrent comme particulièrement injuste le fait d’accuser les populations qui souffrent de la crise (financière après 2008) d’être responsables de leur sort. Ils s’appuient sur la Déclaration de Philadelphie chère à Dominique Méda qui l’invoque souvent : 1947, l’Organisation internationale du travail, l’OIT, y proclame que le travail n’est pas une marchandise et que la sécurité sociale est un droit de l’homme. Les mesures d’exonérations (comme le CICE) ont eu pour effet d’abaisser le coût du travail, elles devaient favoriser la compétitivité et améliorer donc l’emploi, sauf que, pour compenser leur coût, elles ont été menées en parallèle à des prélèvements et des réductions de dépenses publiques qui ont affecté le pouvoir d’achat des ménages.
Notre modèle social est souvent mis en cause par ceux qui voudraient l’abattre et qui invoquent abusivement la crise pour expliquer les déboires économiques et les injustices sociales, au lieu d’avouer leurs erreurs. Les auteurs documentent la piètre qualité de l’emploi français et les causes de l’aggravation de la fracture sociale. L’ouvrage, qui, cinq ans plus tard, mériterait d’être mis à jour pour certaines données chiffrées, fait des propositions qui, elles, restent d’actualité, comme « investir dans l’humain et la cohésion sociale », avec le principe, par exemple, d’un socle commun pour tous les minima sociaux et une révision du financement de la protection sociale : un chapitre rappelle que, contrairement aux idées reçues, la dépense en matière de santé est bien supérieure aux États-Unis qu’en France et émet le vœu d’un cinquième risque pour la dépendance [je précise qu'il s'agit là d'un serpent de mer : Macron l’avait promis, il a préféré perdre du temps et restreindre les droits avec sa réforme des retraites, plutôt que de s’attaquer, malgré ses annonces, à ce grave dossier, urgent, de la dépendance des personnes âgées].
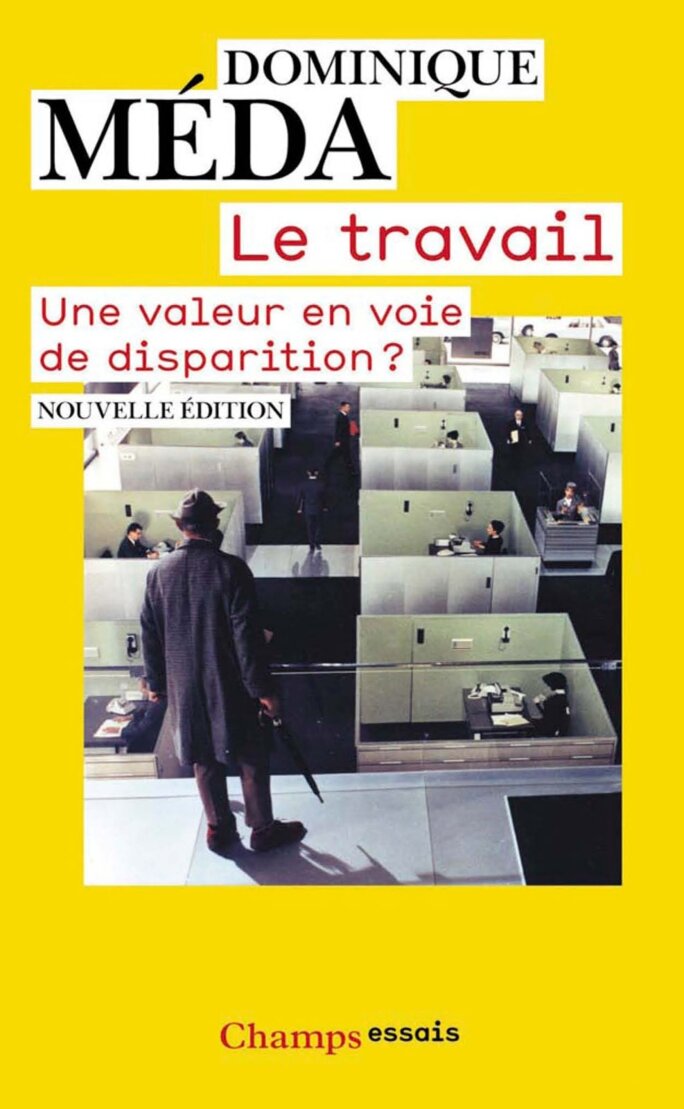
Agrandissement : Illustration 9
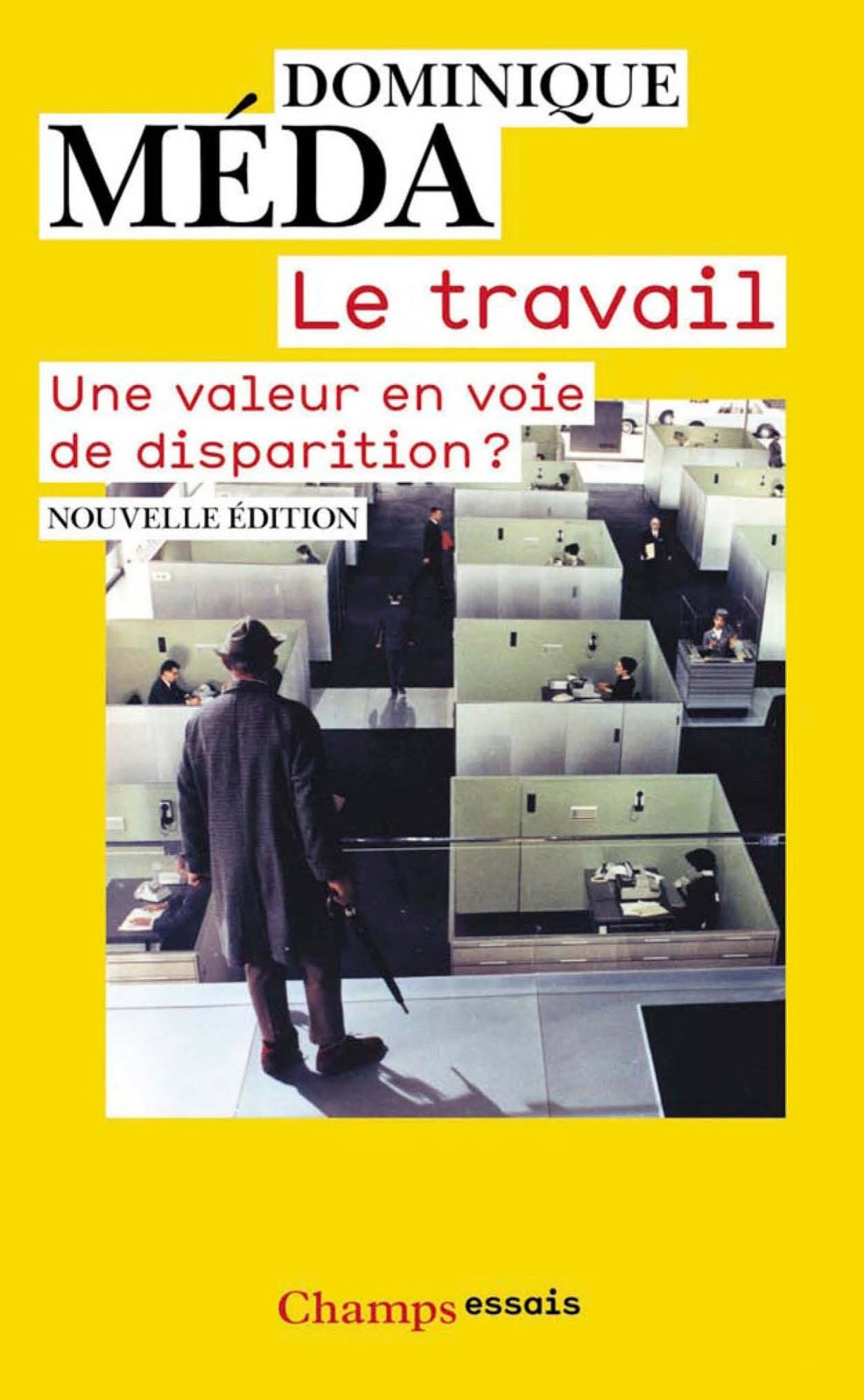
. Le travail, une valeur en voie de disparition ?, éd. Aubier en 1995, Flammarion en 2010. La première édition a fait scandale car le titre ne comportait pas de point d’interrogation, ainsi Dominique Méda est apparue comme contestant toute valeur au travail. Du coup, des ouvrages sont parus pour contester ce point de vue (Contre la fin du travail, de Dominique Schnapper par exemple). Lors de la journée d’étude consacrée à Toulouse aux liens entre travail, néolibéralisme et subjectivité, Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, spécialiste de la souffrance au travail, interrogé par une déléguée CGT du Gers, a reproché à Dominique Méda, proche de Martine Aubry, soutenait la réduction du temps de travail, une erreur selon Dejours. Cela allait dans le sens d’André Gorz (Adieu au prolétariat), alors que pour lui, « le travail est un médiateur de l’accomplissement de soi, […], il n’y a pas de civilisation s’il n’y a pas de travail » (1).
Or, Dominique Méda s’en explique dans la préface de l’édition de 2010 : son livre décrivait l’évolution du travail, comment il est devenu « un fait social total » (sous l’effet de l’analyse marxiste, entre autres), mais aussi comment il « a pris trop d’importance dans notre société ». Le capitalisme ne permet pas que le travail soit une œuvre. La sociologue-philosophe relève que « les individus qui prennent le plus de plaisir à leur travail […] sont aussi presque universellement les mieux payés ». Il importe donc de repenser le travail, le « reciviliser ». Et elle le fait dans cet ouvrage par une analyse critique et réflexive prenant appui sur la philosophie. Partant des différentes conceptions existantes, elle situe le problème dans un espace plus vaste : celui du lien social, de la cohésion sociale, des inégalités. En parcourant Hegel, Rawls, Tocqueville, elle en vient [il y a bientôt 35 ans] à élaborer une réflexion sur une société qui saurait allier d’une part la communauté dans laquelle les individus s’expriment et décident, d’autre part l’État qui ne serait pas la somme des individus, ni un pouvoir accaparé, à la légitimité non reconnue, mais une instance capable d’animer le débat social et de définir l’intérêt général. Dans ce contexte, l’économie est inféodée à la politique et non l’inverse.
_____
(1) Voir mon compte-rendu des propos tenus par les conférenciers, qui ne se fait pas l’écho de cette critique exprimée ensuite lors du débat avec la salle : Néolibéralisme et impact du travail sur notre psychisme, 3 février 2023. Ce désaccord profond n’a pas empêché Christophe Dejours de signer le manifeste évoqué ci-dessus, dont Dominique Méda était une des initiatrices.
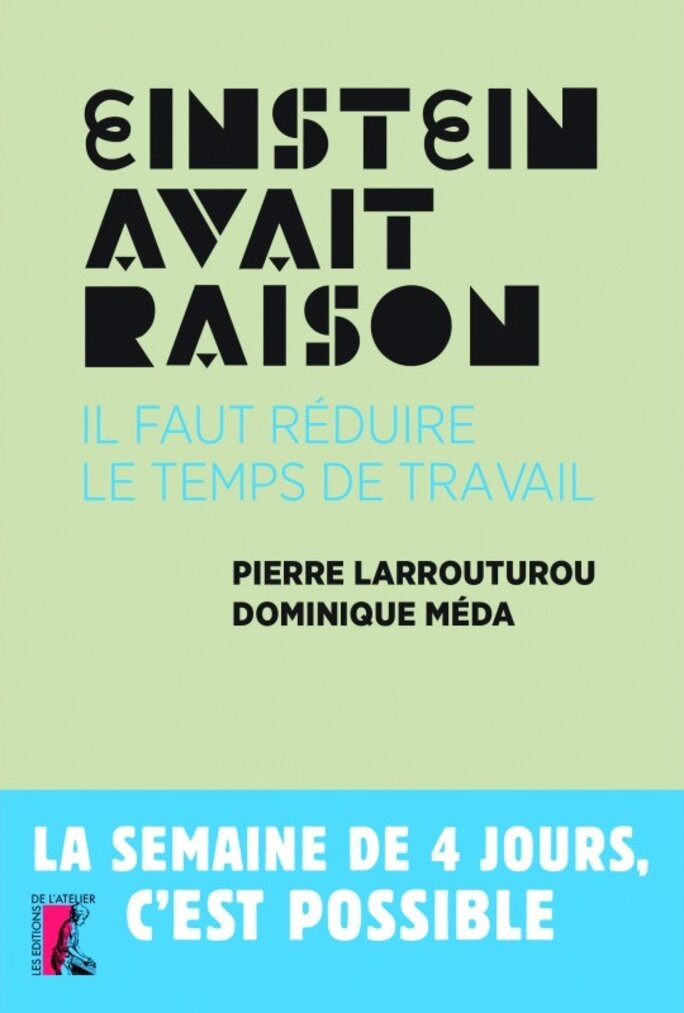
Agrandissement : Illustration 10
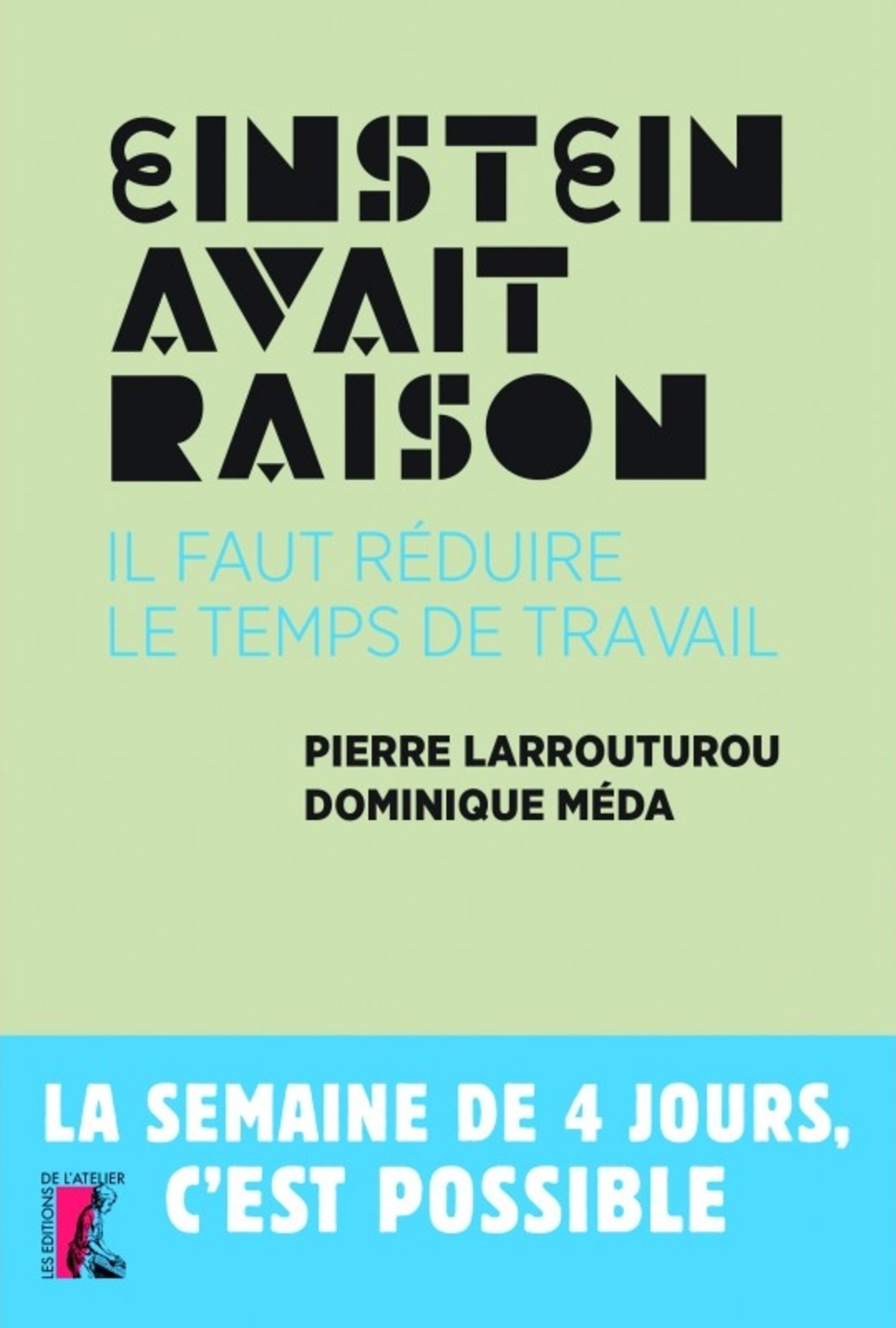
. Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail, Pierre Larrouturou et Dominique Méda, les éditions de l’atelier, 2016. Cet ouvrage portant bandeau "la semaine de 4 jours est possible" prolonge l’ouvrage de 1995, dans une version pragmatique. Einstein, lors de la crise de 1929, avait fait plusieurs propositions dont la réduction du temps de travail pour réduire le chômage (dans la mesure où une seule fraction de la main d’œuvre devient indispensable). Les auteurs, avec exemples à l’appui, montrent que cette organisation du travail sur quatre jours, avec dégagement de temps libre, est souhaitable et possible.
Billet n° 780
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



