Dijon, le 25 novembre, sous les lambris dorés du Palais des Ducs de Bourgogne * :
Serge Paugam, interrogé par Laurent Jeanneau, rédacteur en chef d’Alternatives économiques sur la hausse de la pauvreté constatée récemment par l’Insee, après le flottement des statistiques dû à la période pandémique, confirme : les statistiques de l’Insee ne sont pas les seules, le constat des associations caritatives est aussi là pour attester d’une dégradation de la situation. Il indique que lorsqu’il a commencé à étudier la pauvreté le taux de chômage était élevé, on disait que c’était lui qui nourrissait la pauvreté. D’où la mise en place du RMI (pour des chômeurs ayant perdu leurs droits). Or ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui : il existe un halo de vulnérabilité, de fragilité alors même que certains travaillent : contrats courts, situations professionnelles jamais stabilisées, stagnation des salaires. L’insécurité n’est pas seulement liée au chômage mais à la difficulté à s’insérer. Le travail n’est pas suffisamment sécurisant. Beaucoup ne se sentent pas reconnus. On fait des efforts mais on n’y arrive pas, des personnes travaillent et sont pauvres, c’est ce qui alimente le populisme. C’est ce qui a provoqué la crise des Gilets jaunes.

Agrandissement : Illustration 1

Interrogé sur le lien social comme protection et reconnaissance (thème de son dernier livre), Serge Paugam explique comment le travail est une protection (conventions collectives, protection sociale) et une reconnaissance. Sauf qu’aujourd’hui la souffrance au travail est grande : l’individu ne se sent pas utile, valorisé. On retrouve la notion de protection et de reconnaissance dans d’autres types de liens : la famille et la citoyenneté (non choisis), les groupes affinitaires (choisis). La solidarité n’est pas qu’une question de prélèvements sociaux : elle renvoie à ces quatre types de liens. La solidarité doit être vue comme l’attachement social, c’est-à-dire l’entrecroisement de ces quatre liens. C’est la forme idéale, mais dans les faits cet entrecroisement est inégal c’est ce qui conduit à des processus de disqualification sociale.
Déjà la probabilité de rupture de lien est inégale selon les classes sociales : 27,9 % des ouvriers ne rencontrent jamais ou rarement leur père et 21,3 % leur mère, contre respectivement 4,3 % chez les cadres supérieurs et 3,6 %. Les classes supérieures obtiennent davantage de reconnaissance, tandis que les ouvriers éprouvent le plus le sentiment de droits non respectés. Dans les quartiers populaires, les liens sociaux sont affaiblis, le lien organique et de citoyenneté est faible (pas d’emploi), les liens structurels se sont effondrés, sentiment de discrimination et de rejet. Conflits de voisinage, pas d’attachement au quartier.
Dans une société solidaire, tout devrait être fait pour tisser des liens qui nous libèrent : on est bénéficiaire et contributeur de la solidarité, c’est la condition pour que ces liens soient libérateurs. Mais ce n’est pas toujours le cas, ils n’apportent pas toujours le potentiel de libération. Ils nous oppressent ou nous fragilisent.
Quelle politique permettrait de renforcer ces liens ?
L’intervention sociale, selon les professionnels et les bénévoles, apporte de la protection mais pas de la reconnaissance. Serge Paugam témoigne que des travailleurs sociaux lui disent que leur travail consiste à mettre des gens dans des boîtes, des dispositifs, d’effectuer un travail administratif, ce qui conduit à une bureaucratisation de l’action sociale, au lieu d’échanges et de complémentarité. Les 15 heures d’activité imposées par la loi Plein emploi va instaurer un "bénévolat obligatoire", installant de fait un contrôle social, disqualifiant l’intervention sociale. Il évoque des expériences où les intervenants sociaux cherchent à valoriser les personnes reçues, afin qu’elles ne se vivent pas comme assistées. Car l’accès aux services sociaux est une démarche difficile qui fait entrer dans un processus assistanciel, avec mauvaise réputation à la clé. En zone rurale, il n’est pas simple de solliciter la mairie pour obtenir une aide.
Une étude comparée internationale des liens de filiation met en évidence que la proportion des jeunes (24-35 ans) vivant chez leurs parents est de 50 % en Grèce, 3 % au Danemark, 11 % en France. En Grèce, Italie, Espagne, les jeunes ne se sentent pas dévalorisés de vivre chez leurs parents, alors qu’en France on a prôné l’autonomie des jeunes et disqualifié leur cohabitation tardive. Dans chaque pays, il y a un lien prééminent. En France, le lien organique (le travail) est premier : 95 % des emplois sont couverts par une convention collective, aux USA c’est 11 %. C’est l’emploi qui protègera nos enfants, on avait intériorisé ce fait, mais ce n’est plus certain.
On avait relevé depuis longtemps (Tocqueville s’en faisait déjà l’écho) que les étudiants aux États-Unis sont incités à s’engager dans des associations, ils sont bénévoles, sans rétribution. On constate aussi aux USA la mobilisation dans des quartiers (empowerment) ou la solidarité communautaire (Community organizing, chère à Saul Alinsky, voir « Radicaux, réveillez-vous ! »). À travers cet engagement, on fait société. Mais les Américains s’inquiètent car l’engagement associatif est en baisse. Robert Putnam a décrit ce phénomène dans Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community [2000, seulement le bowling, l’effondrement et la renaissance de la communauté américaine].

Agrandissement : Illustration 2

Attachement Universaliste :
On peut qualifier d’attachement universaliste une société où le lien de citoyenneté est prééminent, ainsi que les liens organiques et de citoyenneté (par contre liens de filiation faibles). Les pays qui affichent le plus cet universalisme sont les pays du Nord [Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Pays-Bas], l’Allemagne, la Suisse, Australie. Lorsque ces trois types de liens sont entrecroisés alors il y a une meilleure prospérité pour les citoyens, on constate une réduction des inégalités. Par contre, les inégalités de genre, là où elles sont les plus élevées c’est dans le régime familialiste.
Dans un ouvrage, à la question dans quel pays aimeriez-vous vivre ?, les chercheurs ont répondu le Danemark. Pour les pauvres c’est différent, car cela dépend de leur organisation, comme en Amérique du sud où il existe des mouvements associatifs, communautaires, l’isolement des pauvres est moindre au Brésil qu’au Danemark où il y a un fort contrôle social. Il a étudié ces paradoxes dans les Formes élémentaires de la pauvreté : il est difficile de vivre la pauvreté dans un pays où il y a moins de pauvres.
À la question de savoir si l’on peut envisager la solidarité à l’échelle internationale, il invoque Durkheim, qu’il cite dans son livre, qui se demandait quel était le type d’attachement qui permettait d’être le plus heureux. Il pensait que cela pouvait être l’attachement à l’humanité toute entière, sauf qu’il n’était pas possible d’envisager un gouvernement global de la solidarité. C’est une thèse qui revient aujourd’hui au-devant de la scène avec le risque climatique, seul moment de sa conférence où Serge Paugam va aborder la question environnementale. « Quand la forêt amazonienne brûle, ça concerne le patrimoine mondial, citoyens du monde, nous avons été choqués quand Bolsonaro l’a laissé brûler ». Les inégalités, comme Thomas Piketty l’a bien montré, sont criantes, entre individus d’un même pays, et entre les nations. C’est le défi du siècle : penser la solidarité pas seulement à l’intérieur de nos frontières mais avec une visée universelle.
* voir L’économie autrement ou construire un avenir désirable (compte rendu partiel des conférences et tables rondes autour de l'Economie Sociale et Solidaire, ESS, avec interventions sur le syndicalisme avec Sophie Binet-CGT et Marylise Léon-CFDT, sur non-recours aux prestations sociales, sur les déserts médicaux et les classes moyennes).
L’Attachement social, Formes et fondements de la solidarité humaine
Cet ouvrage de plus de 600 pages paru au Seuil a manifestement été pensé par ce sociologue spécialiste de la solidarité comme une somme permettant d’approfondir le concept et d’en proposer une compréhension fondamentale, un cadre théorique à partir d’une recherche à grande échelle, s’inspirant d’une sociologie compréhensive, aux frontières d’autres disciplines des sciences humaines, reposant sur une méthodologie affirmée, élaborant des indicateurs sociologiques démonstratifs, en articulant niveau individuel et niveau collectif. L’individu ne peut vivre sans attaches, c’est ce constat qui va conduire l’auteur à retenir le terme attachement pour exprimer cette solidarité naturelle aux multiples facettes. Il distingue quatre liens fondamentaux qui s’entrecroisent (tel un tissu) : le lien de filiation (qui s’impose), le lien de participation élective (qu’on choisit), le lien de participation organique (au travail) et le lien de citoyenneté. Ces liens correspondent respectivement à quatre régime d’attachement social : le régime familialiste, le régime volontariste, le régime organiciste et le régime universaliste, décrivant la façon dont ils se déclinent dans la société (y compris avec la morale, se présentant sous trois formes : domestique, professionnelle et civique).
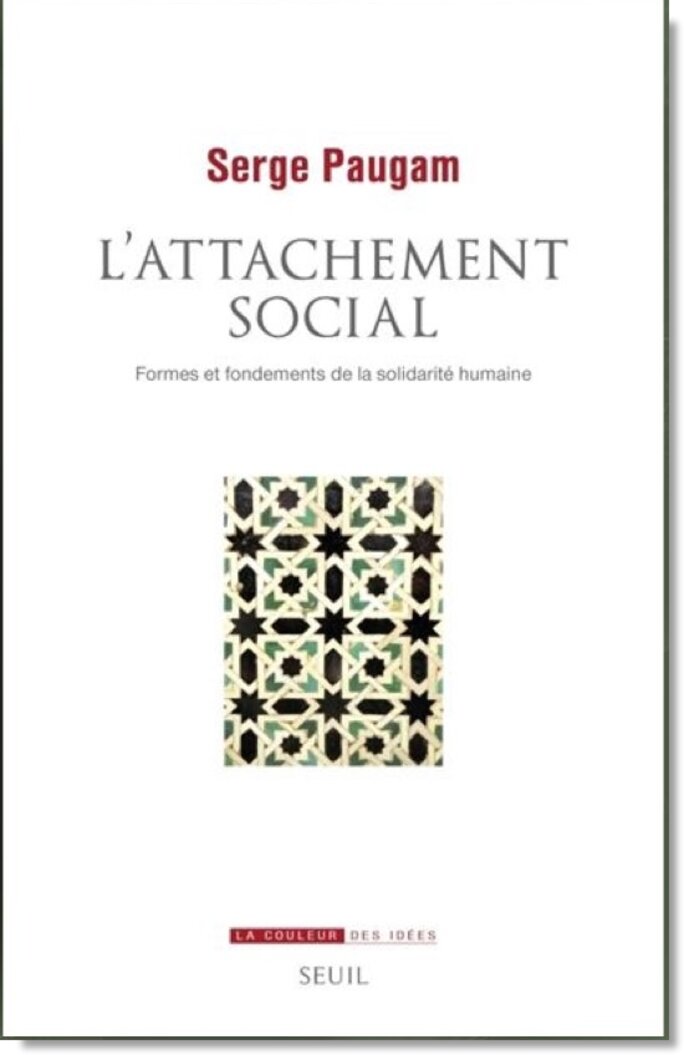
Agrandissement : Illustration 3

Il se réfère à de grands auteurs dont le plus important pour lui est Émile Durkheim, fondateur de la sociologie qui inventa une théorie de l’attachement, mais aussi Weber, Simmel, Elias, Bourdieu. Il note au passage que Durkheim est passé totalement à côté des assurances sociales, tout axé qu’il était sur le travail. Il évoque le Solidarisme de Léon Bourgeois, ainsi que ses propres recherches et convoque ainsi "la disqualification sociale", titre d’un de ses premiers livres (sous-titré Essai sur la nouvelle pauvreté). Il s’appuie sur divers travaux sur le chômage, la pauvreté, l’assistance et l’inutilité sociale. Il considère que les liens sociaux sont toujours à l’œuvre même lorsqu’ils semblent se déliter. Pour se faire, il s’appuie sur une bibliographie copieuse (1). Il relève ce paradoxe : si la modernité fait que les individus sont plus autonomes, il n’empêche qu’ils dépendent davantage encore de la société. Il peut glisser ici ou là une pique comme lorsqu’il critique les raisonnements tautologiques, citant l’exemple des psychologues « qui expliquent la psychopathie par les traits du psychopathe ».
Il étudie les mouvements sociaux (au travail ou dans la société, comme les chaussonniers de Fougères en 1906, les Molex à Villemur-sur-Tarn en 2009, Moulinex, avec une petite incidente sur Lip ou les Gilets jaunes) dont l’impact repose sur l’interaction entre les liens sociaux. Il décrit d’autres faits sociaux comme celui des enfants placés ou de l’assistance sociale (et le contrôle social). Il fournit en quelques pages une documentation copieuse sur le devenir des enfants placés. Contrairement à moult commentaires qui ressassent une étude ancienne de l’Insee, souvent pour discréditer systématiquement l’Aide sociale à l’enfance (ASE), montrant qu’une part importante des SDF en serait issue, il apporte des précisions selon lesquelles si ces adultes ont connu des maltraitances et des événements traumatiques dans l’enfance, cela « ne signifie pas pour autant que le placement soit en lui-même un facteur explicatif des difficultés vécues à l’âge adulte » (ces quelques pages, fouillées, mériteraient à elles seules une présentation particulière).
Il compare l’entre-soi des quartiers populaires (qui ne sont plus les quartiers ouvriers de jadis) et celui des quartiers riches pour constater, avec beaucoup de nuances, que les premiers sont disqualifiés et les seconds réunissent des habitants sur une base affinitaire, même si le réseau d’amitié pour les riches va bien au-delà du quartier. Il compare, dans de longs chapitres, différents pays (développement économique selon les groupes d’attachement social), dans certains d’entre eux les inégalités sont considérées comme naturelles, ayant toujours existé (on parle de fatalisme de la pauvreté ce qui n’empêche pas les pauvres de disposer aussi « de ressources morales, matérielles et stratégiques pour faire face aux épreuves qu’ils endurent au quotidien »). Il suit le parcours des sans-abri, SDF et autres « indésirables » mis à distance, mendiants perçus comme isolés (car la mendicité ne fonctionne pas à plusieurs), mais moins seuls qu’on ne croit (les alliances de survie).
La théorie ne suffit pas à expliquer pourquoi nous sommes attachés les uns aux autres et à la société, ce qui le conduit à faire lien entre attachement social et habitus (ou la coïncidence constatée par Bourdieu entre structures sociales et structures mentales). Mais il préfère quant à lui parler d’entrecroisement des différents liens plutôt que d’un habitus englobant.
Dans ce tissage des liens sociaux, Serge Paugam en note les effets : la protection et la reconnaissance. Ce qui le conduit à décrire l’évolution du principe de protection sociale, de l’assistance, du welfare, de l’État providence, modèle libéral, continental ou social-démocrate (la classique opposition entre Beveridge et Bismarck). Il constate, comme c’est souvent le cas, que l’on a commencé à parler de société salariale quand elle a commencé à s’effriter (je dirais de la même manière que l’on a commencé à parler de responsabiliser les ayants droit de l’action sociale quand la crise fut venue et qu’il était d’autant moins possible de mobiliser, chez eux, une responsabilité). Citant Robert castel, il note que la question sociale n’est plus seulement à la marge mais dans l’effritement du monde salarial. Il tord le cou à l’idée que la protection généralisée provoquerait une rupture dans les liens familiaux ou communautaires : au contraire, cela les rend plus authentiques. Il creuse ce qu’implique la rupture de chacun des liens et, compte tenu de leur entremêlement, de leur tissage, le risque (d’effilochage) qu’entraîne une rupture sur l’ensemble de l’étoffe.
Les liens sont consubstantiels à l’être humain, nécessaires certes, mais s’ils peuvent libérer, ils peuvent aussi fragiliser, sinon oppresser (thème abordé dans un chapitre Les anxiétés de l’attachement). Il décrit le Community organizing, cher à Saul Alinsky, visant à impulser un « pouvoir collectif pour changer le monde dans le sens de la justice sociale », mais ce volontarisme serait menacé, selon Robert Putman [évoqué ci-dessus lors de la conférence de Dijon]. Cela donne l’occasion à Serge Paugam de minimiser cette baisse en s’appuyant sur une étude des liens sociaux dominants selon les États (par ex. : liens de filiation plus prégnants dans les États du Sud).
Il fait un détour par les pays nordiques, Suède, Danemark et surtout Norvège, faisant preuve de cohésion et d’inclusion. Si la fin du modèle nordique a été annoncée par plusieurs chercheurs, sous la pression du libéralisme économique, ce ne serait pas encore le cas. Sauf que la question de l’immigration bouscule ces sociétés restées longtemps homogènes sur le plan ethnique, elles durcissent leur politique en la matière, en particulier au Danemark et ce depuis 2010-2011 (avec des quotas par quartiers, un système de protection sociale destiné à protéger les autochtones). On sait que le Danemark cherche, contre l’avis de l’UE, à traiter ses demandeurs d’asile en les contraignants à passer par le Rwanda. Tout cela n’augure rien de bon. La Grande Bretagne veut lui emboîter le pas.
Il se prononce en conclusion pour une « voie universaliste ». Il verrait bien un « attachement à l’humanité » et c’est ainsi qu’à la page 604, comme lors de sa conférence de Dijon, il aborde la crise écologique (le réchauffement climatique, fonte des glaciers, inondations, montée des mers, incendies de forêts), menaces qui dépassent les frontières. L’assurance sociale est née d’individus des pays industriels confrontés aux aléas de la vie, désormais il serait temps que les êtres humains s’associent solidairement face aux menaces : environnementale et sanitaire (pandémie), et même terroriste. Les moyens de communication ont évolué de telle sorte que les interdépendances sont aujourd’hui maximales. La culture également devient transnationale. Enfin, les migrations provoquent tout à la fois un rejet des uns dressant des murs autour de leur pré carré, et des élans incroyablement fraternels des autres [collectifs d’aide aux migrants]. Le sentiment d’interdépendance grandissant permet d’imaginer que « les êtres humains seraient attachés les uns aux autres par les quatre liens sociaux vitaux » (définis dans ce livre). Cela suppose qu’avec Alain Supiot on rappelle l’esprit de Philadelphie (Déclaration de 1944) pour un nouvel ordre économique mondial fondée sur la justice sociale. Il émet le vœu selon lequel connaître les formes et fondements de la solidarité humaine aide à élaborer un avenir commun. Il précise qu’il ne confond pas le rôle du sociologue avec celui du réformateur social mais espère tout de même que le cadre théorique de l’attachement social ouvrira des perspectives, pas seulement dans le secteur traditionnel de la solidarité, à savoir l’action sociale. Il m’a dédicacé son livre ainsi : « comprendre ce qui nous tient ensemble et en vie ».
_____
(1) Étrangement, il ne cite pas Ce qui nous relie, ouvrage coordonné par André Micoud et Michel Peroni, paru aux éditions de l’Aube en 2000. On y trouvait, entre autres, les signatures de Jacques Ion (le sociologue du travail social), Christian Laval, Évelyne Serverin, Bertrand Ravon. J’ai le souvenir que ce livre m’a été utile pour comprendre que le discours catastrophiste sur les liens sociaux qui se délitaient ne prenait pas suffisamment en compte la façon dont les acteurs de terrain agissaient pour qu’il en soit autrement et comment ces liens prenaient finalement d’autres formes tant il est vrai que l’homme ne vit qu’en lien avec autrui. Serge Paugam, avant de creuser la question des liens d’attachement, avait privilégié la notion de délitement du lien social.
. Dans l’interview accordé à Laure Adler sur France Inter, L’Heure bleue, Serge Paugam se confie sur les raisons personnelles qui l’ont amené à être chercheur sur la solidarité et la pauvreté. "C'est par ces liens sociaux qu'on devient un être social", 6 mars 2023 (53 mn).
. Site de Serge Paugam, accès à divers documents : ici.
. dans les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 17 février 2023, Serge Paugam donne des pistes aux travailleurs sociaux dont l’engagement professionnel doit les conduire à « protéger et valoriser » les personnes aidées et accompagnées (ici : accès réservé abonnés).
Autres ouvrages de Serge Paugam :
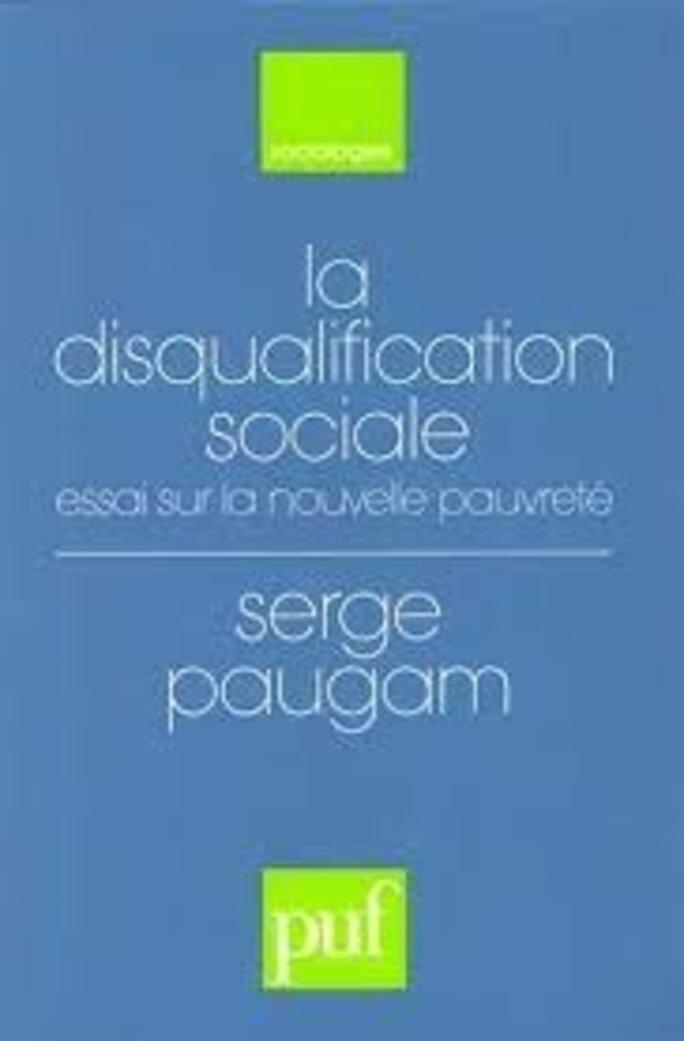
. La disqualification sociale, essai sur la nouvelle pauvreté, Puf, 1991. C’est son premier ouvrage, tiré de sa thèse de doctorat (soutenue en juin 1988), préfacé par sa directrice de thèse, Dominique Schnapper. Il a su, selon elle, échapper aux travers de tant de sociologues de la pauvreté qui tiennent souvent « un discours mi-descriptif, mi-militant, où le misérabilisme se mêle à la dénonciation ». S’il cite les auteurs qui ont montré que les pauvres sont celles et ceux qui sont pris dans le carcan de l’assistance (Georg Simmel, Jeannine Verdès-Leroux), il prend ses distances avec cette notion réductrice, car les pauvres réagissent et développent des stratégies afin de ne pas se laisser enfermer dans cette ségrégation. L’ouvrage est très documenté et l’écriture maîtrisée comme dans les publications suivantes. Il a, pour sa thèse, enquêté sur le terrain, auprès d’un service d’action sociale du Point-du-Jour à Saint-Brieuc. Dans mon exemplaire, je trouve un article jauni de Pierre Drouin paru dans Le Monde (12 février 1991) qui encense le « jeune sociologue », pour avoir « le courage d’analyser la pauvreté comme statut social ».
. La société française et ses pauvres, L’expérience du revenu minimum d’insertion, Puf, 1993. Le chercheur est né à la sociologie l’année du RMI. Il s’interroge sur le fait que la France ait tant attendu (d’autres pays d’Europe l’ont précédée) et constate que la croissance était forte (à 4,2 %) alors qu’au début des années 1980 (croissance à 1 %), François Mitterrand n’avait pas fait voter une telle loi, comme si on prenait acte que « la croissance économique ne faisiat pas disparaître le sous-prolétariat ». Ce livre, là encore avec enquête de terrain, comment la société française traite ses pauvres.
. L’exclusion, l’état des savoirs, éd. La Découverte, 1996, avec le soutien de la Fondation Abbé-Pierre. Ouvrage sous la direction de SP, avec les signatures de spécialistes tels que Robert Castel, Jacques Donzelot, Julien Damon, Didier Fassin, Loïc Wacquant, François Dubet. Cet ouvrage copieux (48 articles sur 580 pages) décline les exclusions dans tous les secteurs où elles apparaissent.
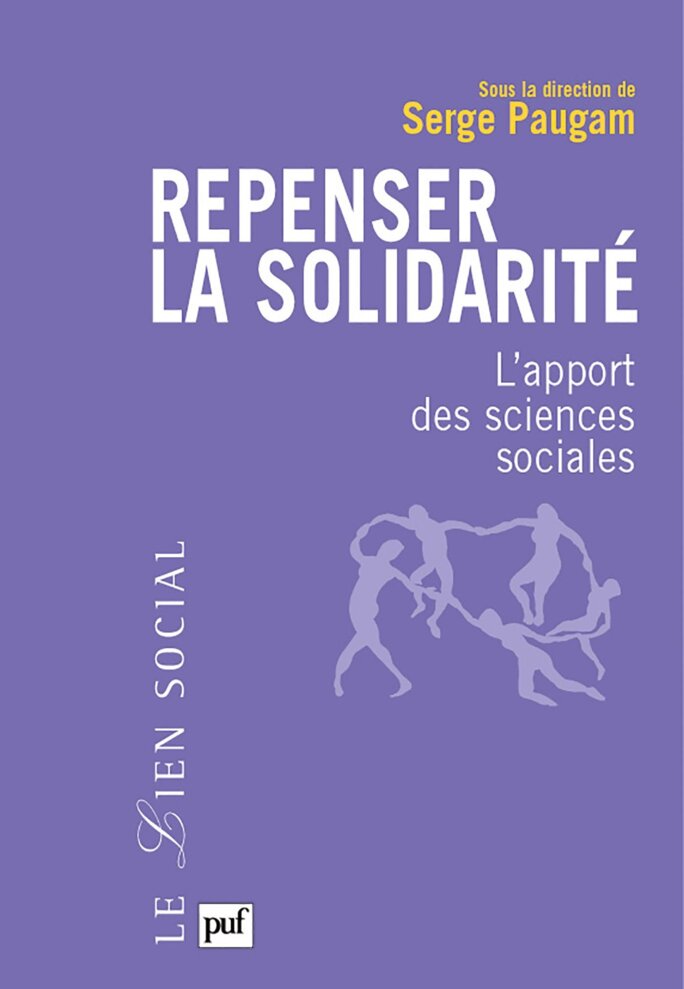
Agrandissement : Illustration 5
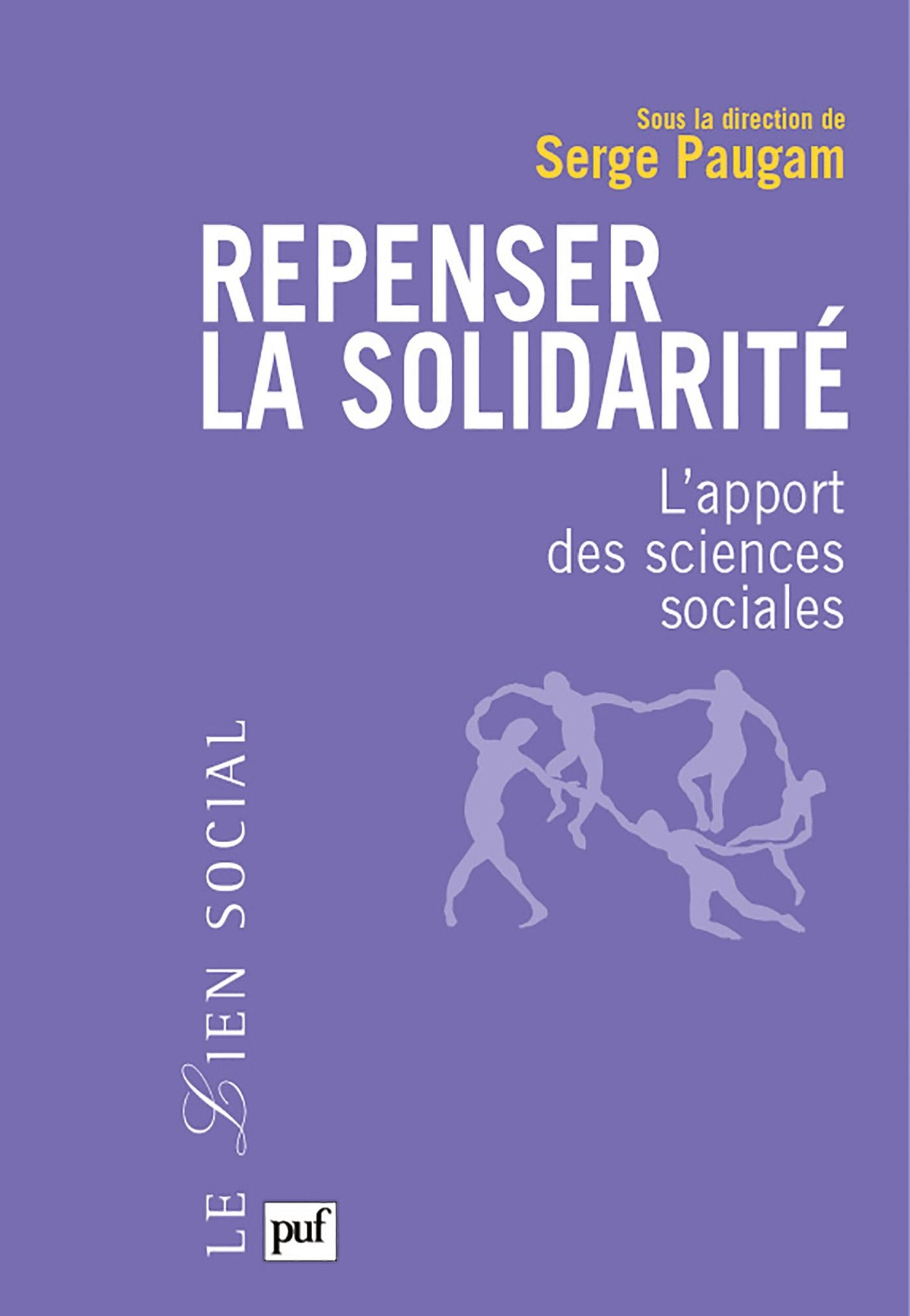
. Repenser la solidarité, L’apport des sciences sociales, Puf, 2007. Autre monument sous la direction de SP, réunissant certains auteurs de L’exclusion, et d’autres comme Éric Maurin, Rémi Lenoir, Thierry Pech Irène Théry, Nicolas Duvoux. Comme toujours, Serge Paugam rend hommage au maître, Émile Durkheim, et sa conception du lien intrinsèque entre sociologie et la notion de solidarité. Il s’agit (avec 48 article sur 980 pages), après avoir fait un état des lieux, de proposer des solutions, que ce soit dans le domaine des solidarités familiales, du monde salarial, contre le racisme et les ségrégations urbaines, de la santé, avec, au final, des réflexions sur ce que pourrait être l’État-providence.
. La régulation des pauvres, avec Nicolas Duvoux, autre grand spécialiste de la notion de la solidarité et de l’assistance, Puf, 2008. Petit livre (114 pages) qui se présente comme un dialogue entre deux sociologues, vingt ans après La disqualification sociale et alors que Nicolas Duvoux venait de soutenir, sous la direction de Serge Paugam, sa thèse titrée L’injonction à l’autonomie (publiée en 2010 sous le titre L’autonomie des assistés, Puf, 2009). À les relire, on mesure combien leurs analyses étaient pertinentes, toujours applicables, comme lorsqu’ils montrent comment le système encadre les pauvres, les maintenant à la périphérie de l’emploi quand il y a du chômage, et en incitant au travail, par diverses menaces et intimidations, quand le chômage baisse.
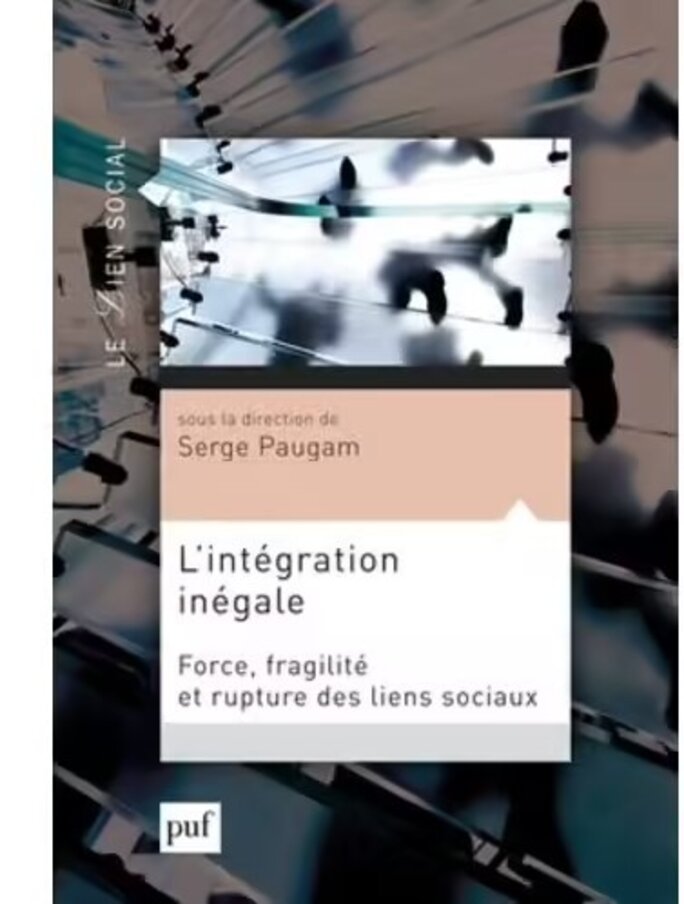
. L’intégration inégale, Force, fragilité et rupture des liens sociaux, Puf, coll. Le lien social (que dirige Paugam), 2014, sous la direction de SP. Ce livre est construit de telle sorte qu’il parcourt les quatre types de liens sociaux (décrits dans L’Attachement social), qui attachent les individus entre eux et à la société, avec parfois fragilité de ces liens et de leur entrecroissement. Chaque article (26 sur 512 pages) s’appuie sur une étude concrète dans le monde du travail, dans les banlieues, auprès des SDF, auprès des licenciés de Moulinex, en décrivant l’application du welfare américain.
. Ce que les riches pensent des pauvres, avec Bruno cousin, Camila Giogetti, Jules Naudet, au Seuil, 2017. Enquête internationale, dont le Brésil où Serge Paugam a des attaches. Il y a là la volonté de produire, à la différence de l’habitude, une étude qui mette en relation riches et pauvres. Les sociétés mettent à distance les pauvres (indésirables) et cela se retrouve même dans la façon de décrire la pauvreté
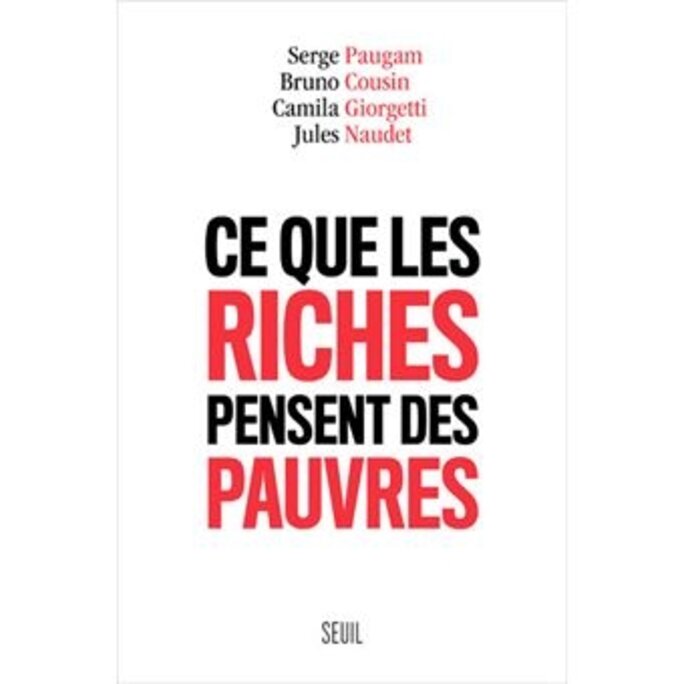
Billet n° 776
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



