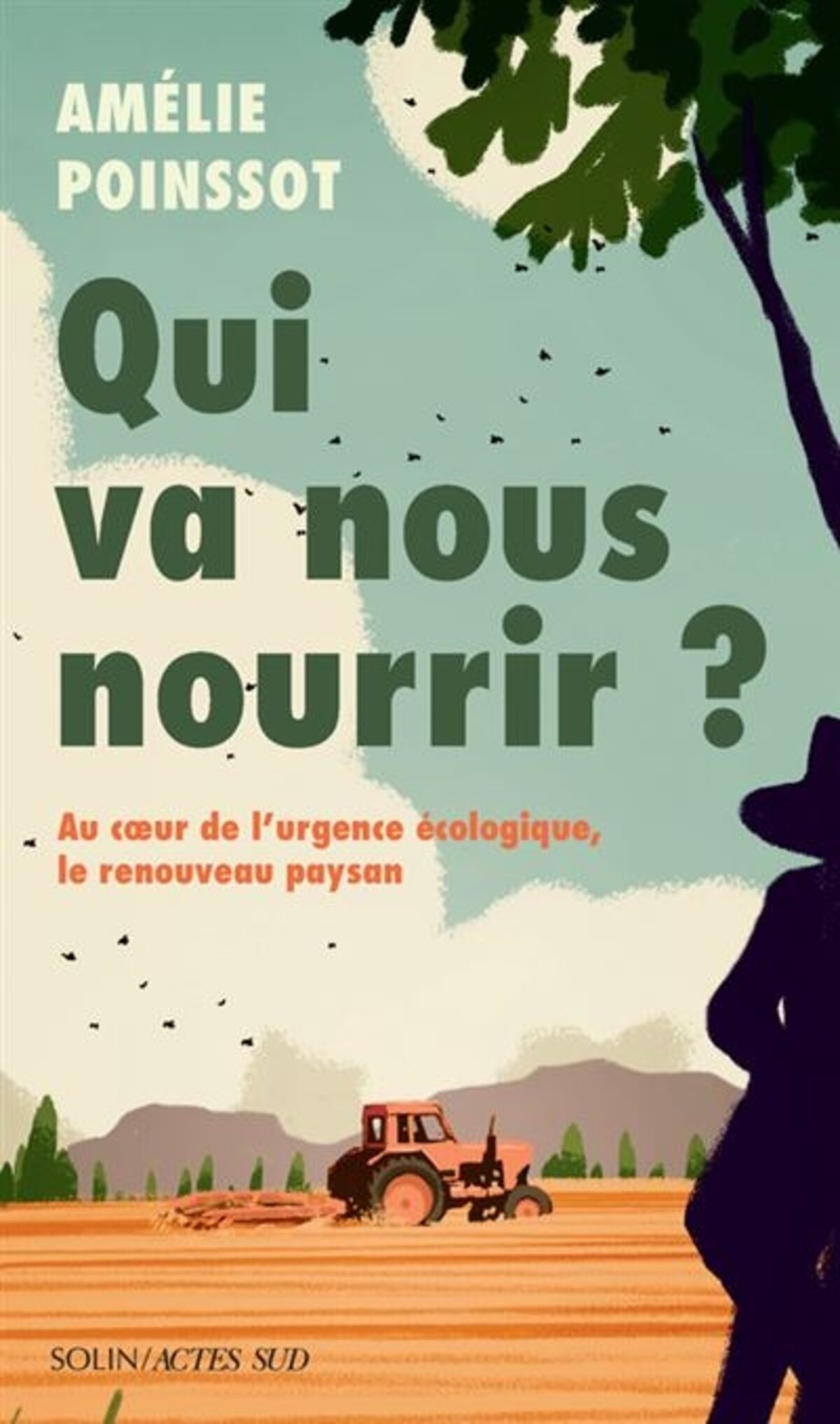
Agrandissement : Illustration 1
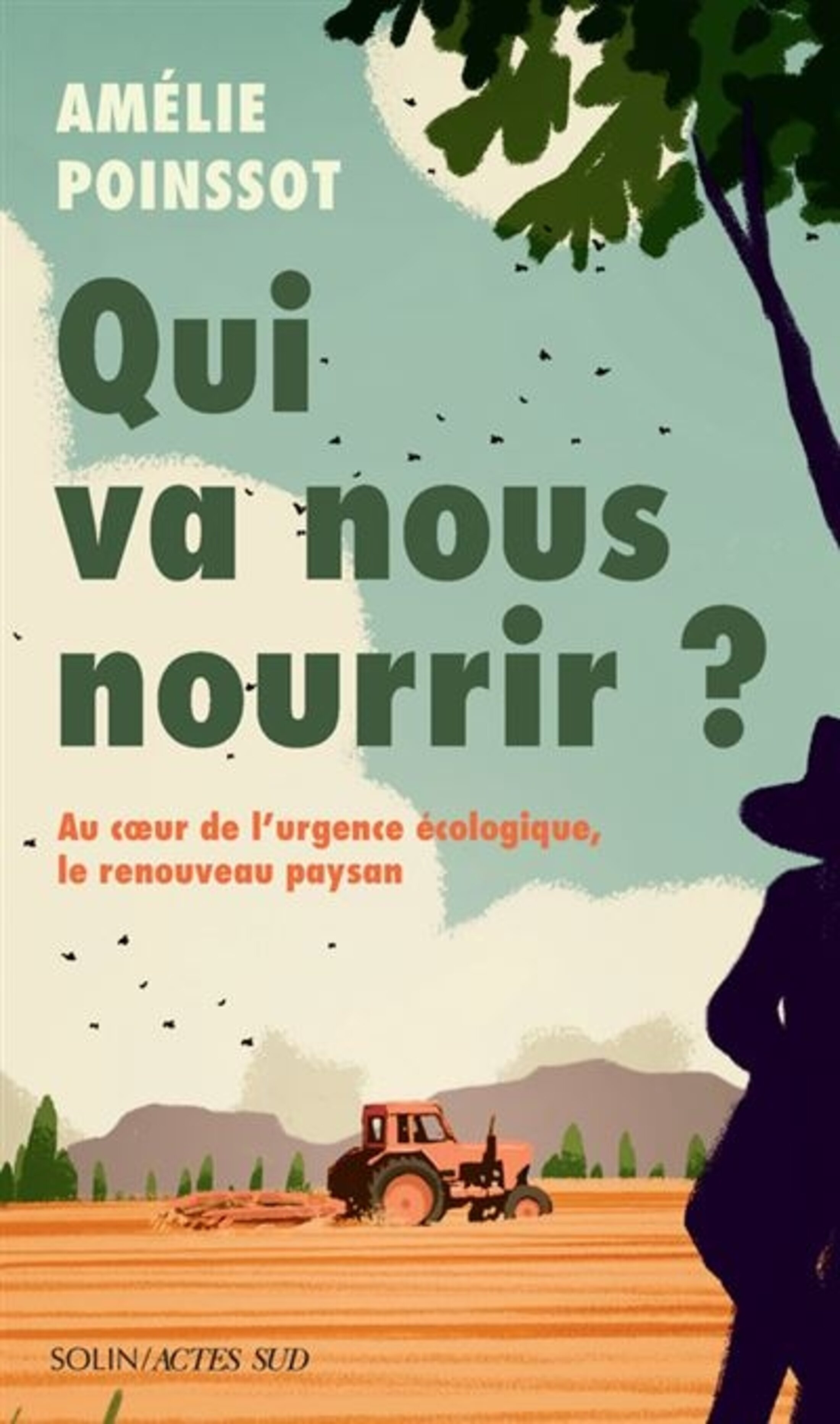
Amélie Poinssot est journaliste à Mediapart. Elle a publié en 2019 un ouvrage sur le premier ministre hongrois, actuel président du Conseil de l’Union Européenne, trumpiste invétéré, Dans la tête de Viktor Orban (chez Solin/Actes Sud). Cette année, elle a publié toujours chez Solin/Actes sud, Qui va nous nourrir ? (sous-titre : Au cœur de l’urgence écologique, le renouveau paysan). D’amblée, elle plante un décors terrible, une « saignée », à savoir la disparition progressive des agriculteurs (moins de 400 000 alors qu’ils étaient dix fois plus nombreux il y a un siècle). La moitié d’entre eux (car âgés de 55 ans et plus) devraient disparaître d’ici six ans ! Par ailleurs, 23 % des émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle mondiale proviennent de l’agriculture. Il y a urgence d’agir.
Les départs en retraite ne sont remplacés que pour moitié, la surface moyenne des fermes croit (69 ha contre 55 dix ans plus tôt). La politique agricole est responsable de cette situation car tout a été fait pour réduite de façon drastique le nombre des agriculteurs. En 1967, le sociologue Henri Mendras, avec son livre La Fin des paysans, annonçait ce qui allait advenir. Mais Amélie Pinssot fait le constat que l’agriculture paysanne n’a pas disparu, celle qui respecte les écosystèmes. Elle a justement rencontré, pour son enquête, celles et ceux qui ne se disent pas agriculteurs mais paysannes et paysans. Alors que l’agrobusiness est décrié, cette paysannerie à visage humain a le vent en poupe, en tout cas est appréciée, même si les citoyens ne la prennent qu’insuffisamment en compte.
Le problème est que les nouveaux (souvent jeunes) paysans ont du mal avec le foncier, difficile à acquérir car il reste cher. Les mesures publiques prises pour faciliter ces acquisitions sont nettement insuffisantes, heureusement qu’il y a de initiatives parallèles, comme Terre de liens qui acquièrent des terres pour permettre à des paysans de s’installer. La Confédération Paysanne avec les réseaux de l’Agriculture paysanne (ADEAR, association pour le développement de l’emploi agricole et rural) vient en aide à ces candidats qui ne sont pas tous issus du monde paysan.
L’urgence écologique et le renouveau paysan supposent de mener des luttes, comme dans le passé : l’autrice rappelle celles que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître (Plogoff, Larzac), mais aussi Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline, on pourrait ajouter l’A69. Est rappelé comment la marche de Sainte-Soline a été réprimée par les forces dites de l’ordre (200 manifestants blessés, dont deux dans le coma), alors même qu’une partie des médias décrivait les événements à partir des seuls mensonges outranciers du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin.

Agrandissement : Illustration 2

Le livre se décline en plusieurs chapitres aux titres de circonstance (la graine, la fourche, l’essaim, la racine, les ravageurs, le regain…) avec la présentation de plusieurs acteurs et actrices de terrain : Léna, qui après une année de maths en fac, veut être céréalière bio ; Onna, diplômée en droit et comédienne, qui milite à Extinction-Rébellion, sensible aux théories de l’effondrement de Pablo Servigne, sera maraîchère mais il faut trouver d’abord du foncier et se former (brevet professionnel responsable entreprise agricole, BPREA) ; Kévin, ingénieur, fils d’agriculteur, reprend la ferme familiale mais doit faire appel à Terre de Liens pour racheter les terres de ses oncles ; Ludivine, Romain, Camille, Morgane et bien d’autres. Par ailleurs, des paysans et paysannes installées sont interviewées, leur expérience étant précieuse pour alimenter l’état des lieux qu’établit cet ouvrage documenté. Les difficultés rencontrées pour acquérir ou louer des terres, le peu de souplesse des banques, l’insuffisance des formations (encore trop scolaires), le pinaillage des administrations (et leurs erreurs), les conflits, parfois, avec les générations précédentes, tout y passe, un vrai parcours du combattant ou de la combattante, à y perdre sa santé. Mais on a droit aussi à des récits de solidarité, d’entraide, on croise de belles personnes venues s’installer dans le monde rural pour expérimenter et y développer des valeurs de respect de la nature et des êtres humains. Plusieurs témoignages, passionnants, portent sur ce choix vital de se confronter à un métier qui subit ou bénéficie des aléas de la nature. L’insertion dans un territoire, les pieds dans la glaise, n’est en rien un "nationalisme" rural mais bien une ouverture aux autres. Les nouveaux venus n’ont pas grand-chose à voir avec les utopistes des années 1970 (les "néo"), ils sont plus diplômés, plus pragmatiques, et comptent davantage de femmes que dans l’ensemble des exploitations.

Agrandissement : Illustration 3

Les rachats de terre suite aux départs conduisent certains exploitations à atteindre des surface de 500 à 600 hectares, dirigées par des agri-managers qui ne travaillent même pas eux-mêmes leurs terres. Des montages permettent de contourner la loi sur la taille limite d’une exploitation, le coût de la terre augmente. Ces sociétés agricoles industrielles empêchent toute évolution vers une agriculture saine. Car le mot d’ordre de l’agriculture paysanne va à l’encontre de l’ « agrandissement », des exploitations gigantesques : le choix est la ferme « à taille humaine ». Le but n’est pas de dégager des revenus mirobolants, mais au moins un smic (ce que beaucoup parviennent à faire, si une menace, de grippe aviaire par exemple, ne vient pas perturber la vie de la ferme), mais c’est souvent au prix d’une charge de travail énorme (jusqu’à 70 heures par semaine).
Par ailleurs, certains étudiants des hautes écoles font leur conversion, contestant le rôle que la classe dominante leur fait jouer au détriment d’une agriculture paysanne. Ce fut le cas entre autres de ceux d’AgroParisTech et leur appel à déserter (Christiane Lambert, a répondu sans surprise que c’était un buzz organisé, elle qui fut présidente de la FNSEA, syndicat agricole qui, avec la Coordination Rurale, envoie la paysannerie dans le mur).

Agrandissement : Illustration 4

Amélie Poinssot a mis une citation de Marx en exergue, selon laquelle personne n’est propriétaire de la terre, mais seulement usufruitier, il faudra la rendre aux générations futures après l’avoir améliorée en bons pères de famille. En conclusion, elle émet le vœu que tous les moyens qui existent dans le champ de l’agriculture en France soient mis au service d’une conversion de même envergure que celle des années 1960 pour que soient financées des pratiques écologiques et favorisées les installations vertueuses. Afin de casser le « en même temps » de « deux agricultures parallèles, l’une dominante et destructrice, l’autre respectueuse du vivant et menée par des fermes audacieuses, mais dont les produits sont réservés aux ménages les plus aisés ». Il est temps d’abandonner le mode de production intensif, tout ne peut venir des initiatives locales si importantes soient-elles. Le pouvoir politique doit enfin tenir compte de la recherche scientifique sur l’agroécologie.
En attendant que les choses changent par des décisions d’envergure, il me semble qu’il y a deux vœux à formuler : que les citadins et toutes celles et ceux qui ne vivent pas de la terre, de l’élevage et de la transformation, veillent bien à se fournir au maximum chez les paysans du coin, mais aussi qu’ils et elles lisent les livres qui décrivent la réalité de ce monde paysan, alimentent la réflexion et sont porteurs de changements.

Agrandissement : Illustration 5

Amélie Poinssot et Noémie Calais aux Petits Papiers :
Le 5 novembre, à Auch, dans le Gers (en Occitanie), la librairie Les Petits Papiers, tenue par Chloé Tournebize assistée par Manon Dessort, recevait Amélie Poinssot.

Agrandissement : Illustration 6

C’est Noémie Calais, éleveuse de porcs noirs dans le Gers, à Montaigut, co-autrice de Plutôt nourrir (sous-titre : L’appel d’une éleveuse, chez Tana éditions) qui la présente et l’interroge. Elles ne partagent pas seulement le verbe "nourrir", mais aussi une conception de la question environnementale, de l’état du monde agricole et de la transmission des fermes. Amélie Poinssot indique qu’elle est allée sur le terrain, pour rencontrer de nombreux acteurs et actrices, considérant qu’il est de la première importance de rendre compte de cette énergie, de ce qui bouge, de ce qui s’invente, s’expérimente, dans le réel, loin des débats stériles. Elle relève que les obstacles que rencontrent les jeunes "paysans" (ce mot est préféré à agriculteurs par ceux-là même qui se confient à elle) viennent des institutions. Heureusement que des associations (ADEAR, Terre de Liens) sont actives depuis 15 ans au moins, car les Chambres d’Agriculture sont inefficientes, alors que la question du foncier est majeure et qu’il y aurait en la matière des dispositifs publics à monter. Dans certaines régions, apparaissent des régies municipales maraichères (comme à Mouans-Sartoux). En réponse aux questions de Noémie, est abordée la question de la réorientation de l’alimentation (comme la surconsommation de viande), mais de gros lobbys bloquent toute évolution positive.

Agrandissement : Illustration 7

Il faudrait doubler le nombre de paysans (une agriculture paysanne le permettrait), mais il a fallu un amendement pour que le projet de loi d’orientation de l’agriculture en parle, sinon cet objectif passait à la trappe. Bien d’autres sujets ont été débattus, sur ce qui explique le choix de ces nouveaux paysans (parfois ayant eu d’autres parcours professionnels au préalable) à venir à la terre, à l’élevage. L’ouvrage d’Amélie Poinssot parcourt, de façon compréhensible, tous les sujets actuellement vitaux. Une quarantaine de personnes ont assisté à ces échanges, de nombreuses questions ont été posées et propositions suggérées pour surmonter le pessimisme qui nous gagne quand on voit combien d’intérêts privés font obstacles à des solutions valorisant les communs et offrant une conception nouvelle de la société à laquelle nous aspirons.
. Amélie Poinssot sera à Périgueux (Dordogne) le samedi 16 novembre à 10 h dans le cadre du festival du livre gourmand, table ronde (Le modèle agro-alimentaire, on le tue ou il nous tue ?), avec Laure Ducos (autrice de Les frites viennent des patates, éd. Grasset) ; le jeudi 28 novembre au cinéma de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), débat sur les enjeux agricoles après la projection à 20 h du film de Nathanaël Coste La théorie du Boxeur.
. voir sur Social en question : Noémie Calais, éleveuse : ne pas trahir l'animal.
Billet n° 829
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).
Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



