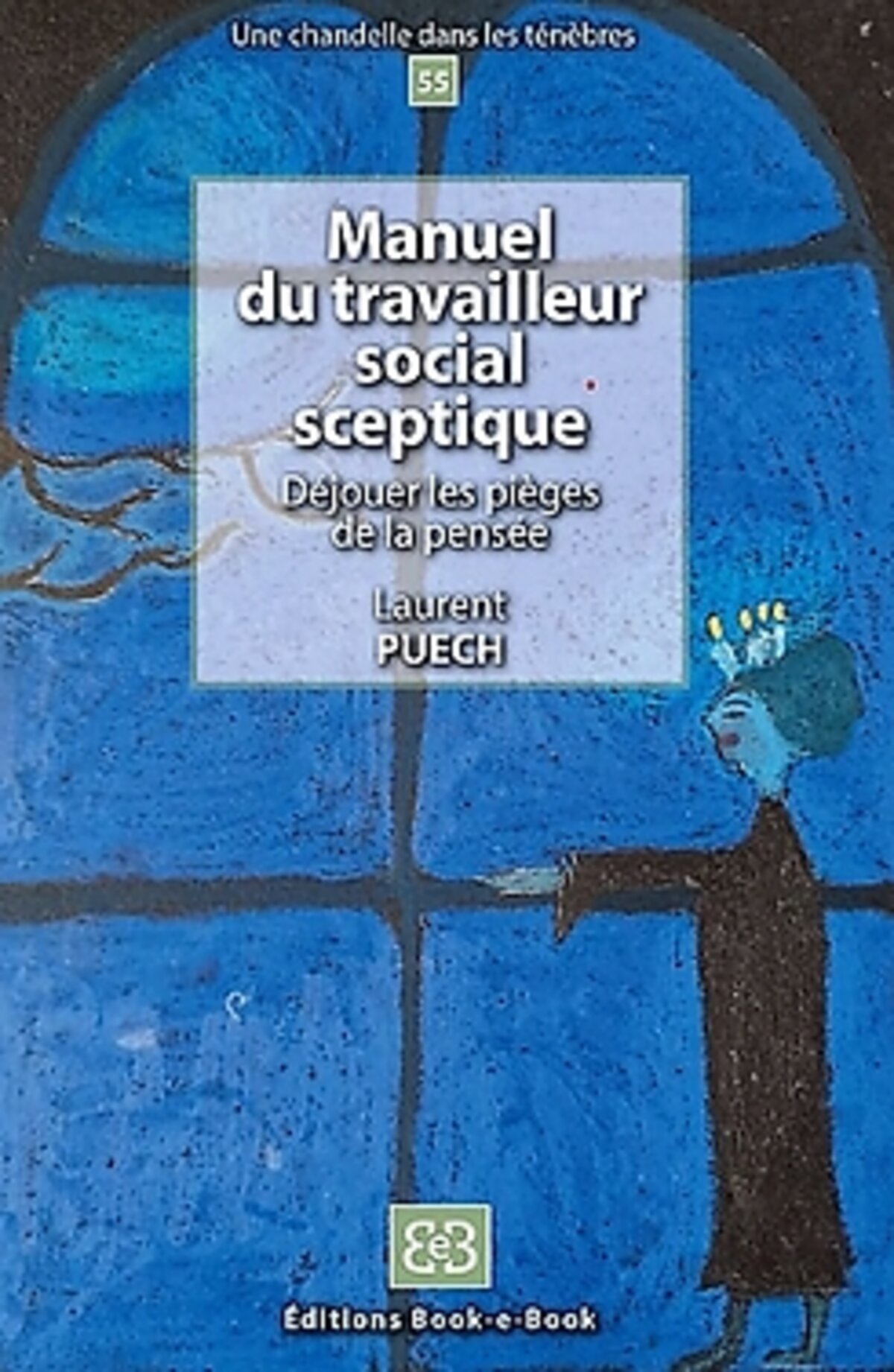
Dans Manuel du travailleur social sceptique, sous-titré Déjouer les pièges de la pensée, Laurent Puech rappelle tout d’abord ce qu’est le travail social : une intervention sociale auprès de personnes qui ont besoin d’aide ou de renseignements, qu’elles soient en difficulté ou non. Dans tous les cas, il restera traces de ce passage, traces qui peuvent durer dans le temps. C’est vrai dans beaucoup de domaines, en particulier dans le cadre de la protection de l’enfance, où il importe souvent de procéder à une enquête qui fera l’objet d’un écrit, qui non seulement circulera mais aura des conséquences sur la vie des gens. L’auteur veut à travers cet ouvrage prodiguer des conseils aux travailleurs sociaux afin que les éléments qu’ils fournissent dans leurs écrits soient probants et non fondés sur des impressions ou des jugements de valeur. C’est le B.A BA du travail social, mais abordé de façon méthodologique plutôt que selon les affirmations de principe habituelles. Être rigoureux dans un écrit social, cela va sans dire, mais cela ira encore mieux en le disant.
Le texte de l’ancien président de l’Association Nationale des Assistants Sociaux (ANAS) déroule des conseils qui tournent autour de la vigilance et de la compétence. La vigilance zététique (la zététique étant l’art du doute) consiste à détecter les failles dans nos raisonnements et d’en tirer conclusion, en argumentant. Pour ce faire, il décline un certain nombre de situations concrètes, mettant en exergue les erreurs possibles et les règles à respecter. Il incite à penser contre soi, montrant combien il est facile d’affirmer ce qui semble d’évidence ou qui fait consensus, mais qui n’est pas conforme à la réalité. Cela suppose donc une méthode, mais pas seulement : dans le domaine de l’action sociale et plus précisément de la protection de l’enfance, il importe d’avoir des connaissances, ainsi que des compétences, dans la façon de mener un entretien, dans la relation qui s’établit entre le professionnel et la personne aidée et rencontrée. Et il ne s’agit pas que de technique car technique et éthique sont étroitement imbriquées.
Zététique bien dosée
Laurent Puech n’incite pas à faire des surdoses de zététique : « la zététique sert à nourrir une confrontation professionnelle et non à générer des disputes interpersonnelles ». De même qu’il met en garde contre le fait que la répétition d’informations préoccupantes (IP) ne signifie pas forcément qu’il y ait danger, si à chaque fois on a conclu à l’absence de danger. Se méfier du : « il n’y a pas de fumée sans feu ». Le professionnel doit être en mesure de faire la part des choses : entre un comportement parental réellement maltraitant et un comportement certes problématique mais qui se retrouve dans toutes les familles (« je dis bien toutes »).
Cette façon de manier le doute pour atteindre au plus près la vérité de la situation n’est pas seulement une exigence que les équipes professionnelles doivent respecter au risque, sinon, d’être dans un à-peu-près qui n’a rien de professionnel, mais aussi pour l’efficacité de l’action : en effet, s’il y a nécessité de protéger un enfant, un juge des enfants, en bout de chaîne, va difficilement prendre une mesure si les éléments fournis ne sont pas probants. Une équipe capable de se remettre en question est « une solide équipe ». À la lecture, je pensais à ces ʺétudes de situationʺ, ces ʺsynthèsesʺ, que j’animais il y a bien longtemps, où, après une heure et demi d’échanges entre divers professionnels de divers services, avec des éléments peu probants avancés, il arrivait qu’au moment de clore la réunion, soudain une information de première importance était livrée au débotté, comme si sa gravité avait été négligée, ou qu’on avait craint de la révéler, alors même que cela nécessitait presque de tout recommencer l’évaluation faite jusqu’alors.
Rapporter un propos c’est une chose (les services d’enquête judiciaire pourront éventuellement le vérifier), valider ce propos alors que nous n’avons pas été témoin de ce qu’il affirme, c’est déraper. Se baser sur les écrits antérieurs est justifié mais le fait que ce soit écrit ne suffit pas, encore faut-il que ce soit argumenté, seule condition pour que ces écrits soient pris en compte. Inversement, l’absence de preuve ne prouve pas l’inexistence d’un problème.
Laurent Puech met également en garde contre les analogies : ce n’est pas parce que l’on a connu une situation apparemment identique qu’il faut en tirer les mêmes conclusions. Il importe de veiller à ce que les mots entendus soient correctement restitués, et non de façon approximative. Il préfère la citation exacte à la reformulation. Cela suppose que les questions posées ne soient pas directives, afin que les réponses ne soient pas adaptées mais la réelle expression de l’individu interrogé. Là encore cela paraît une évidence, mais on sait combien, pour aller vite, il peut être tentant d’aider à ce que la réponse advienne (il en est de même pour tant d’interviews journalistiques où la réponse est déjà dans la question). Il importe de se méfier des « biais de confirmation », comme des « biais de la solution parfaite », c’est-à-dire ne retenir que la solution qui nous convient ou rejeter celle qui n’est pas à 100 % garantie. Sans parler du « biais rétrospectif » (juger un événement actuel en croyant qu’on l’avait présupposé).
Quelle est la zone d’incertitude ?
Au-delà du factuel, on est invariablement amené à interpréter mais il importe de le faire avec prudence, en précisant la zone d’incertitude. Par ailleurs, « la charge de la preuve appartient à celui qui déclare », plus exactement « la charge de démonstration ». L’auteur donne l’exemple de la suspicion d’enfant secoué : la personne accusée, si elle était seule, ne pourra jamais prouver qu’elle n’a pas secoué le bébé. Ce seront les services d’enquête judiciaire qui doivent démontrer si la suspicion est fondée ou non.
Il a cette formule selon laquelle les professionnels sont celles et ceux qui ont la capacité de surmonter la frustration et à accepter une part d’incertitude. Son livre fourmille ainsi de petites formules, têtes de paragraphes qui facilitent grandement la lecture : « possible n’est pas toujours probable », « la bonne foi n’est pas un argument suffisant », « le comment est accessible, le pourquoi l’est peu ».
Spécialiste du secret professionnel, il invite le lecteur à bien connaître la loi en la matière, trop de travailleurs sociaux affirmant péremptoirement l’obligation de signaler sans connaître la complexité des textes en vigueur (même Service-public.fr contient des informations fausses sur le secret professionnel).

Agrandissement : Illustration 2

Laurent Puech invite à veiller à ne pas être un travailleur social militant (on peut être travailleur social et militant), en séparant deux espaces d’engagement, afin que nos choix de citoyen n’interfèrent pas dans notre appréciation d’une situation, ce qui nous conduirait à privilégier certaines données et à en exclure d’autres. J’approuve cette conception, même si j’ai défendu dans divers écrits la nécessité d’être un « travailleur social militant », dans le sens d’un professionnel pleinement engagé dans sa fonction, au service des publics accompagnés.
Contre le modèle sécuritaire
Ce livre n’est évidemment pas une invitation à ne plus agir, entravé par le doute, mais à mettre en place une protection raisonnée plutôt qu’une protection irrationnelle. En ce sens, cet ouvrage est salutaire, il va à l’encontre d’une approche médiatique qui, sur ces questions, préfère l’emporte-pièce, les gros sabots, les affirmations tonitruantes, en protection de l’enfance par exemple, au détriment des familles et des enfants. Prendre des mesures sévèrement restrictives du droit envers des parents par mesure de précaution c’est commettre un danger en prétendant en éviter un autre. L’auteur sait que c’est difficile, car « une bonne partie de la population pense sur un modèle sécuritaire et mettra en accusation ceux qui ne ʺsur-agissentʺ pas systématiquement ».
Démonstration implacable, méthodique, didactique, d’une grande clarté, indispensable pour les étudiants en travail social mais aussi pour les professionnels, car sont rappelées des notions qui parfois se perdent (certains se diront cependant qu’ils font de la zététique sans le savoir). Si ces principes fondamentaux étaient davantage en vigueur, les services sociaux au sens large seraient plus crédibles. Ils retrouveraient la confiance, en partie perdue à cause de la façon dont les autorités exigent d’eux d’être des auxiliaires (de la justice, de la police, de l’administration).
J’ajoute qu’au-delà de la technique professionnelle, cela suppose un combat ʺpolitiqueʺ pour que les règles d’intervention du travail social ne soient pas foulées au pied par des décideurs qui ont beaucoup de mal à reconnaître les principes qui le régissent (valeurs, techniques). Je pense aux hiérarchies administratives mais aussi à la façon dont la Justice a traité un temps les travailleurs sociaux, n’hésitant pas à les poursuivre devant les tribunaux, à une époque où il y avait une forte tension Justice-Administration décentralisée. Cela s’est calmé, mais perdure chez les travailleurs sociaux une crainte de se voir reprocher d’avoir révélé un danger trop tard, ce qui les conduit parfois à des pratiques de précaution, contraires à celles prônées par Laurent Puech.
Il va de soi que bien d’autres secteurs devraient respecter cette démarche méthodologique et pourraient donc tirer profit des valeurs contenues dans cet ouvrage.
. Manuel du travailleur sceptique, Déjouer les pièges de la pensée, par Laurent Puech, Éditions Book-e-Book, 91 pages, 11 € (à commander : ici)
. Pour élargir la portée de ce propos, alors que partout dans le monde, ainsi qu’en France (cf. les enfants de La Réunion, par exemple), on rappelle des abus collectifs commis par les États à l’encontre des familles et des enfants, il est vraisemblable que ces atteintes aux droits individuels n’auraient pu se produire si l’on avait été rigoureux dans l’évaluation de chaque situation.
-----
. Laurent Puech, qui est directeur de l’Association nationale d’intervention sociale en commissariat et gendarmerie (ANISCG), alimente à titre personnel trois sites :
. le site Zététique et Travail social.
. le site Secret Pro (textes, analyses et blog).
. le site Décrypter la ʺprotection ʺ en travail social (protections-critiques : « un regard critique sur les logiques de protection et les protecteurs à l’heure de l’aide bienveillante… »). Nombreux articles tous aussi passionnants les uns que les autres, toujours fouillés, avec nombreuses références (législatives, statistiques) et démonstrations limpides.
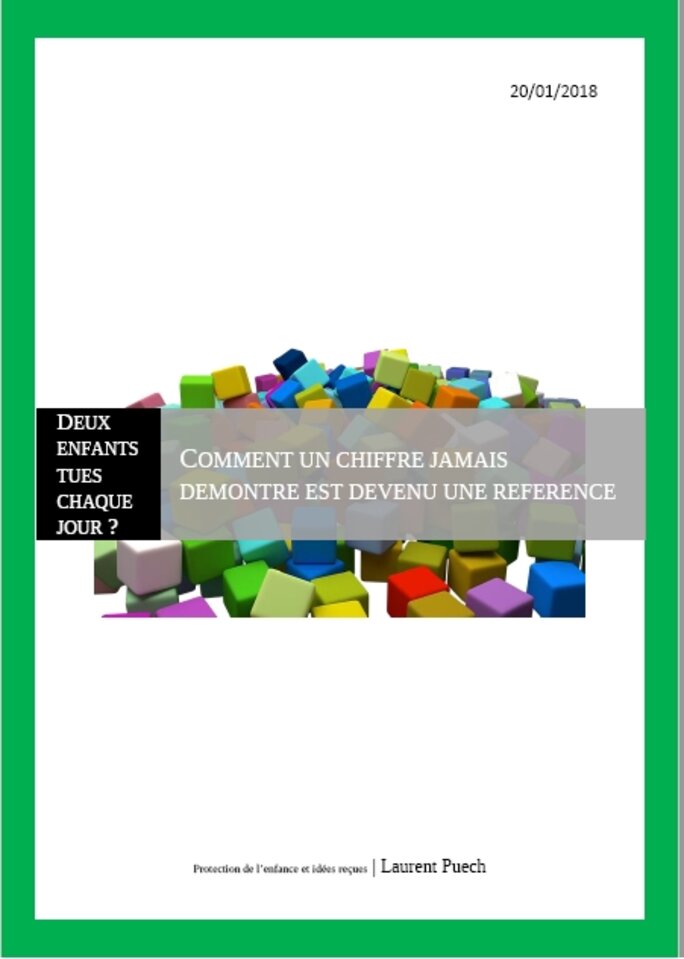
Agrandissement : Illustration 3

. Deux enfants tués chaque jour ? Comment un chiffre jamais démontré est devenu une référence, Laurent Puech, 20 janvier 2018.
. Morts violentes au sein du couple : derrière les discours alarmistes, une baisse de 25 % depuis 2006, Laurent Puech, 26 février 2019.
. Nombre d’enfants tués par leurs parents, YF, 10 février 2018.
. Meurtres conjugaux : en hausse ou en baisse ?, YF, 7 mars 2019.
Billet n° 723
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



