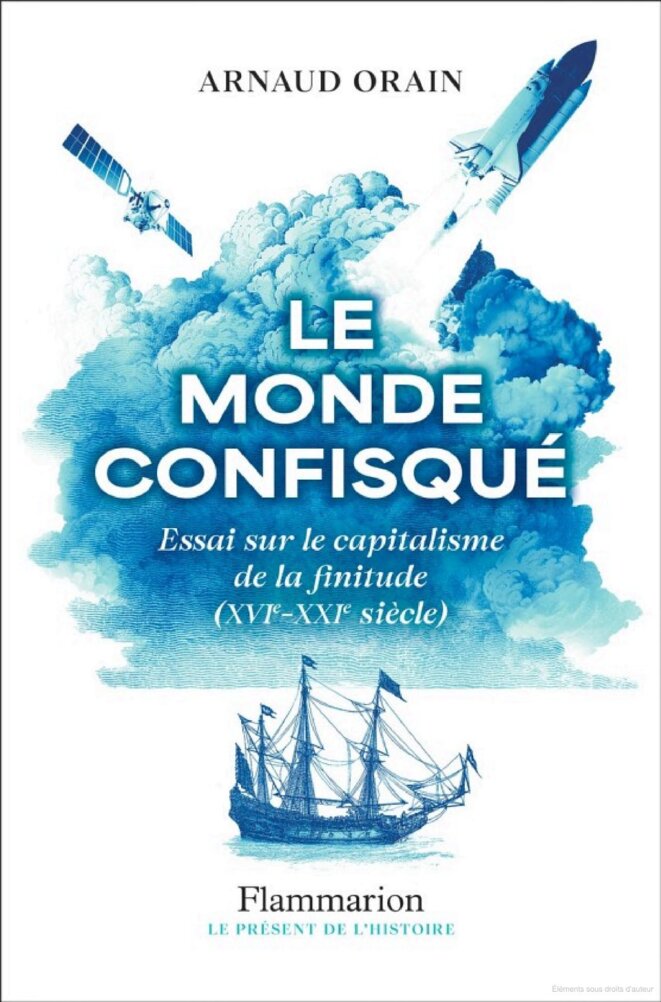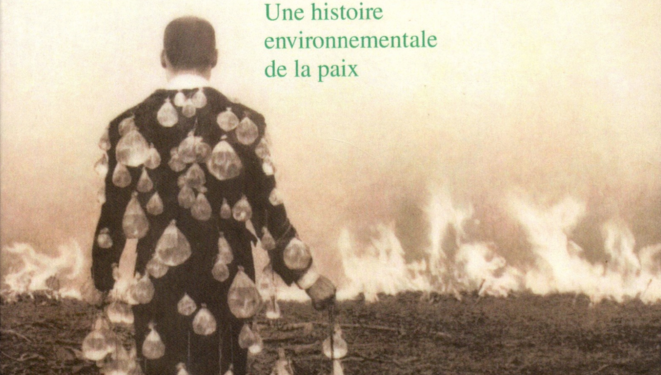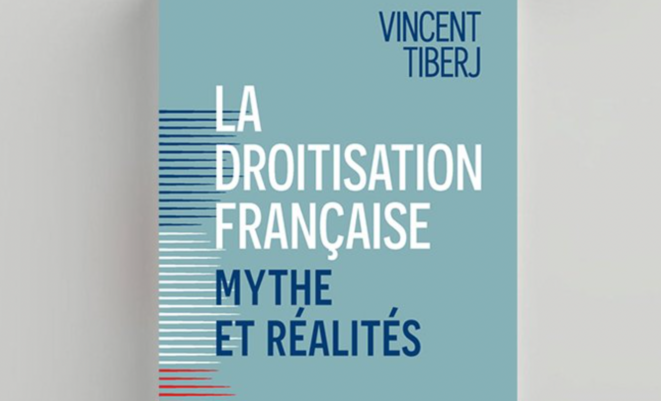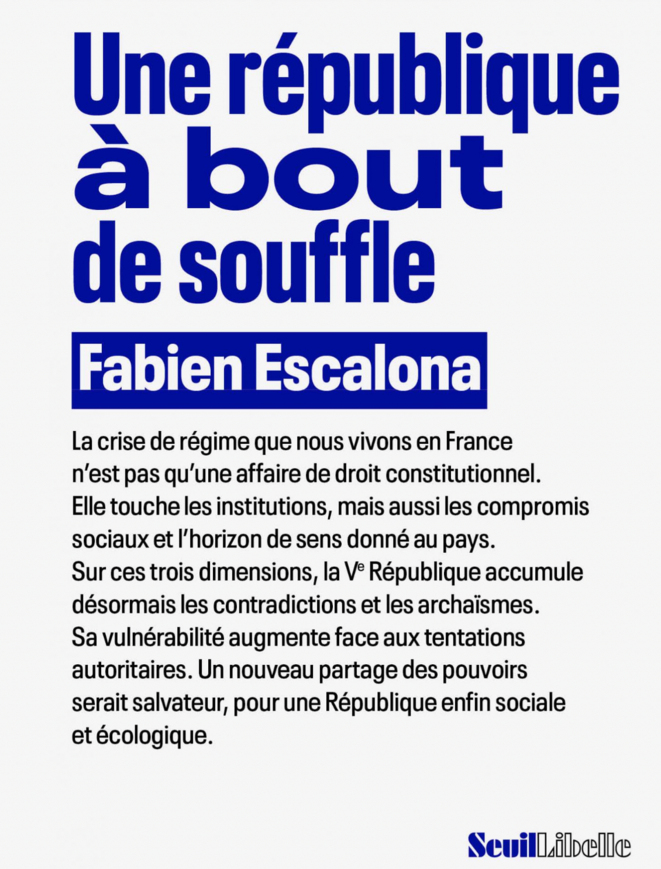-
Avec « La coalition climat. Travail, planète et politique au XXIème siècle », Pierre Charbonnier achève sa mutation d’historien de la philosophie en philosophe à la Marx. Camarades, le prolétariat est mort et enterré dans les poubelles de l’histoire. Au temps nouveau de l’anthropocène, que vive la coalition climat ! Mais l’auteur risque de voir ses espoirs déçus...
-
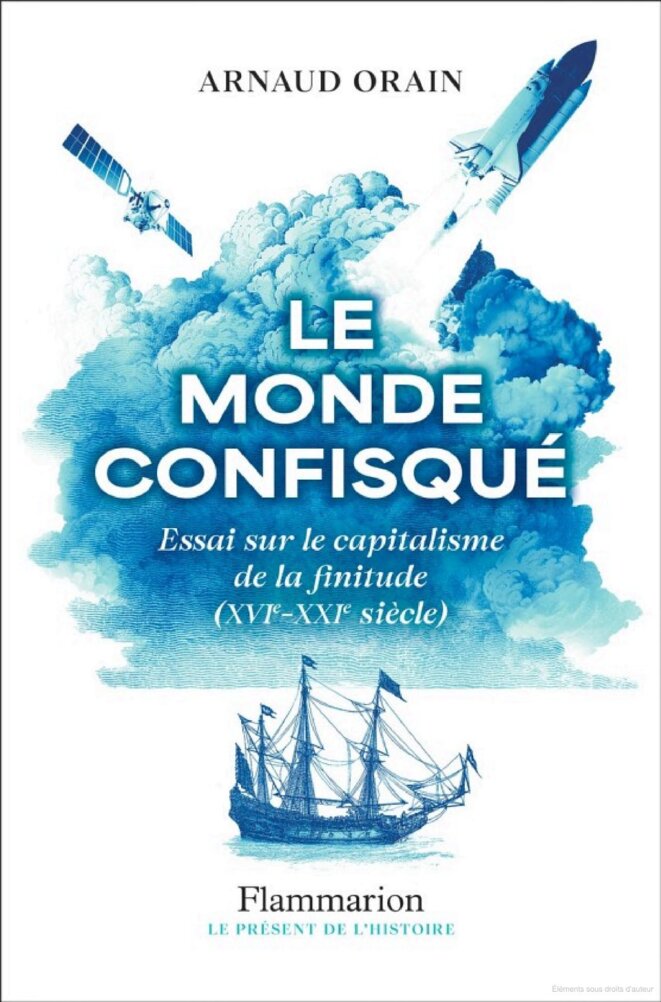
« Le néo-libéralisme est terminé », écrit l'historien Arnaud Orain dans « Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVI-XXIe siècle) ». Voilà qui ne manque pas d’audace. Pour l’auteur, nous sommes entrés depuis le début des années 2010 dans une nouvelle phase du capitalisme, ce qu’il appelle le « capitalisme de la finitude ».
-
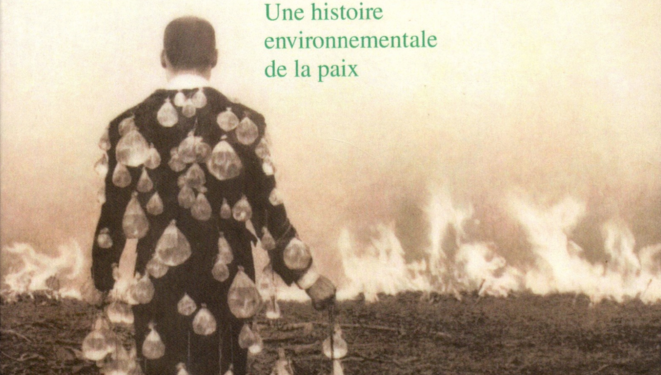
Dans « Vers l’écologie de guerre. Une histoire environnementale de la paix », Pierre Charbonnier se propose de faire une histoire des idées autour des conditions de la paix mondiale, vues par le prisme des contraintes écologiques, ignorées ou déniées, et une proposition politique réaliste pour sortir de la crise écologique. Mais la victoire de Trump, sa volonté de refaire des États-Unis une puissance dominante me semblent saper à la base la vision de Pierre Charbonnier.
-
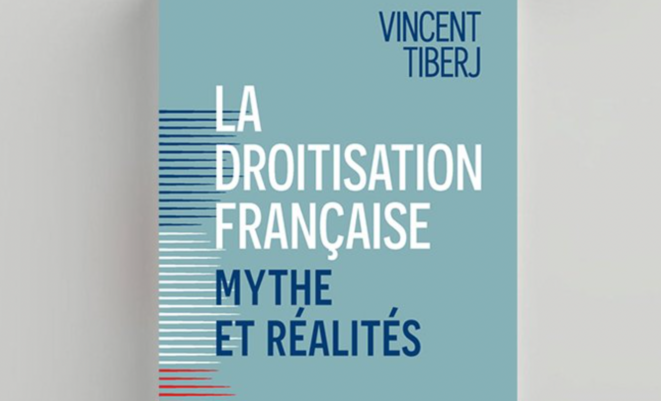
Je m’apprête à chroniquer un ouvrage dont j’espérais depuis longtemps l’apparition. Le livre de Vincent Tiberj, « La droitisation française. Mythe et réalités » propose une réponse à une question que je me pose depuis longtemps : comment se fait-il qu’alors que les Français sont (en moyenne) moins racistes, xénophobes, sexistes, homophobes, qu’en 1974, ils votent massivement pour des partis d’extrême droite ?
-
L’expression « J’assume » est en principe l’expression d’une prise de responsabilité qui suppose que celui qui dit « J’assume » accepte aux yeux du monde d’être tenu ensuite comptable de ses actes. C’est donc une expression positive dans le cadre de la morale commune. Or, dans l’usage qui en est fait actuellement par nos gouvernants, le terme a fini par prendre deux sens bien moins recommandables. Le premier, le plus évident, correspond à un bras d’honneur langagier.
-
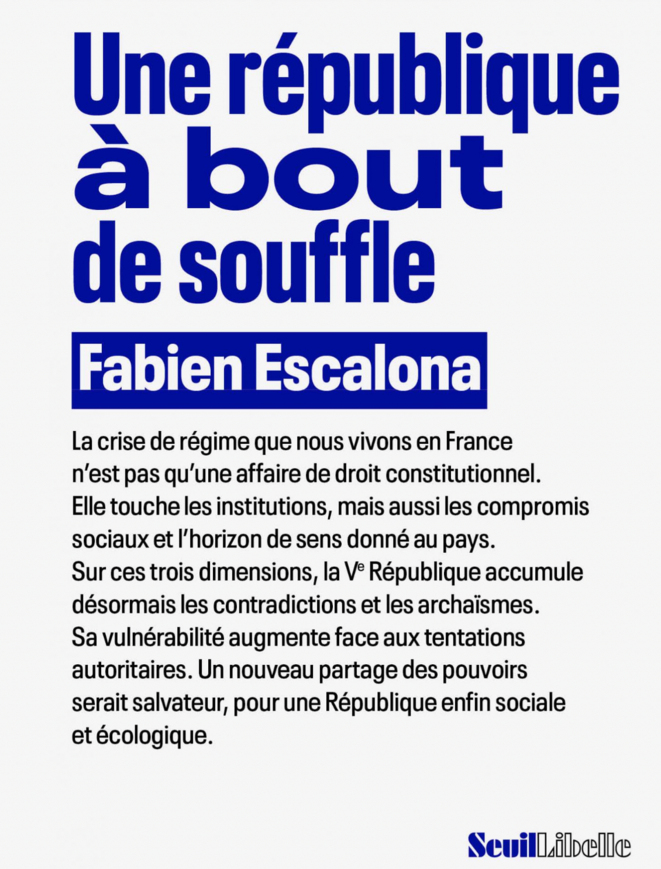
Emmanuel Macron va rester dans l’histoire comme l’homme qui, par son incapacité foncière à être un Prince démocrate, aura achevé la Vème République. Le parfait anti-De Gaulle. Le père Ubu, version Énarque. L'ouvrage de Fabien Escalona, « Une république à bout de souffle », ne saurait mieux s’inscrire dans l’actualité. La situation autour de la réforme des retraites est en tout point paradigmatique de ce qu’il entend démontrer. Recension.
-
À ce stade de la pré-campagne de l’élection présidentielle 2022, ma rationalité de politiste me dit qu’il n’y a aucune chance de voir un candidat de gauche (écologiste compris) gagner la présidentielle. Il ne me reste que ma fréquentation de l’histoire où, parfois, les événements déjouent les attentes les plus solidement ancrées pour me donner quelque espoir de me tromper.
-
Pendant que les médias et les réseaux sociaux se remplissent de bruit et de fureur autour d’une prétendue invasion de nos belles Universités par la «peste intersectionnelle», l’«islamo-gauchisme», la très redoutée «écriture inclusive» (j’en oublie, n’étant pas chroniqueur au Figaro), revenons pour se reposer de tant de bêtise satisfaite et d’acrimonie sous testostérone à des temps politiquement plus sérieux. C’est ce à quoi invite le manuel de J. Weisbein et S. Hayat, Introduction à la sociohistoire des idées politiques.
-
Le second confinement semble accumuler les défauts par rapport au premier et témoigne que le pouvoir n’a pas du tout les capacités d’apprentissage requises à ce niveau de responsabilité.
-
Les amalgames, ni faits, ni à faire, d’un Ministre préemptant sans retenue les thèmes de l’extrême-droite pour mettre dans le même sac toute personne ayant une vision un tant soit peu instruite par les sciences sociales de la réalité sociale du pays, j’ai bien peur que ce soient les valeurs républicaines qui finissent par disparaître.