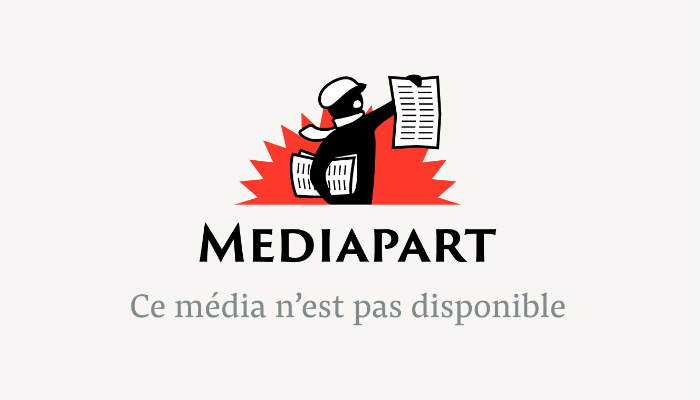-
A l'occasion de la tribune de Pierre Serna sur le lien entre lèse-humanité et esclavage, il convenait d'éclairer la naissance et les premiers usages de cette notion "lèse-humanité" qu'il est tentant d'utiliser pour comprendre notre actualité. La méthode historique, qui vérifie les sources, rappelle la complexité qui a présidé à l'émergence de la lèse-humanité.
-
Alors que se diffuse l'idée que la politique doit se rénover en prenant en compte le conflit, les passions et les émotions, il est nécessaire de revenir sur les expériences vécues pendant les guerres civiles et les moments pendant lesquels la "justice" populaire était réclamée. Deux livres récents nous apportent leur éclairage.
-
Quand arrêtera-t-on de parler de la terreur de cette façon ? Quand arrêtera-t-on de donner de l’histoire de la Révolution une image inversée de la réalité en transformant Robespierre en monstre et la Terreur en système totalitaire? Quand considérera-t-on la politique avec ses luttes, ses manoeuvres et ses rivalités indissociables de ses élans, de ses espoirs et de ses exigences ?
-
A propos de la notion de génocide et du livre de Jacques Villemain, Vendée 1793-1794, il n’y a pas lieu d’accepter une mise en cause des méthodes historiques mais à en retenir les injonctions à maîtriser les sources, les arguments et les qualifications, pour que la vérité historique et la vérité judiciaire puissent continuer leur dialogue et que l'on évite de relancer une polémique idéologique.
-
Parmi les querelles franco-françaises qui structurent notre pays, l’une des plus récurrentes tourne autour du rapport que la « province » entretient avec Paris ou, si on le dit autrement, à propos de l’opposition entre centralisation étatique et autonomie régionale. Le détour par la Révolution française, moment de cristallisation de nos passions, s’impose.
-
Parmi les querelles franco-françaises qui structurent notre pays, l’une des plus récurrentes tourne autour du rapport que la « province » entretient avec Paris ou, si on le dit autrement, à propos de l’opposition entre centralisation étatique et autonomie régionale. Le détour par la Révolution française, moment de cristallisation de nos passions, s’impose.
-
Parmi les querelles franco-françaises qui structurent notre pays, l’une des plus récurrentes tourne autour du rapport que la « province » entretient avec Paris ou, si on le dit autrement, à propos de l’opposition entre centralisation étatique et autonomie régionale. Le détour par la Révolution française, moment de cristallisation de nos passions, s’impose.
-
Le populisme n’est pas une chose neuve. Il est important d’en comprendre l’établissement et le développement en le traquant dans les épisodes de notre histoire, et ici dans le cours même de la Révolution française. Il s'agit bien d'explorer les facettes de ce "roman national" dont nous sommes accablés pour mettre à jour ce qui s'est effectivement passé. D'autres textes suivront.
-
comment comprendre l'exception de Robespierre, bouc émissaire utile pour tous ses adversaires mais aussi pour les royalistes et même les républicains du XIXe siècle ? Voir la Révolution française dans sa complexité politique, la voir comme toute autre période, permet de suivre un itinéraire et des luttes qui échappent au prêt à penser que les "thermidoriens" ont su si bien vendre.
-
Grave question, la Révolution a-t-elle empêché de manger la galette des rois ? Contre la légende qui l'assure, le passage dans les textes de la Convention, de la Gazette des Tribunaux et de l'Histoire parlementaire montre qu'il n'en est rien et que les fantasmes courent encore et toujours !