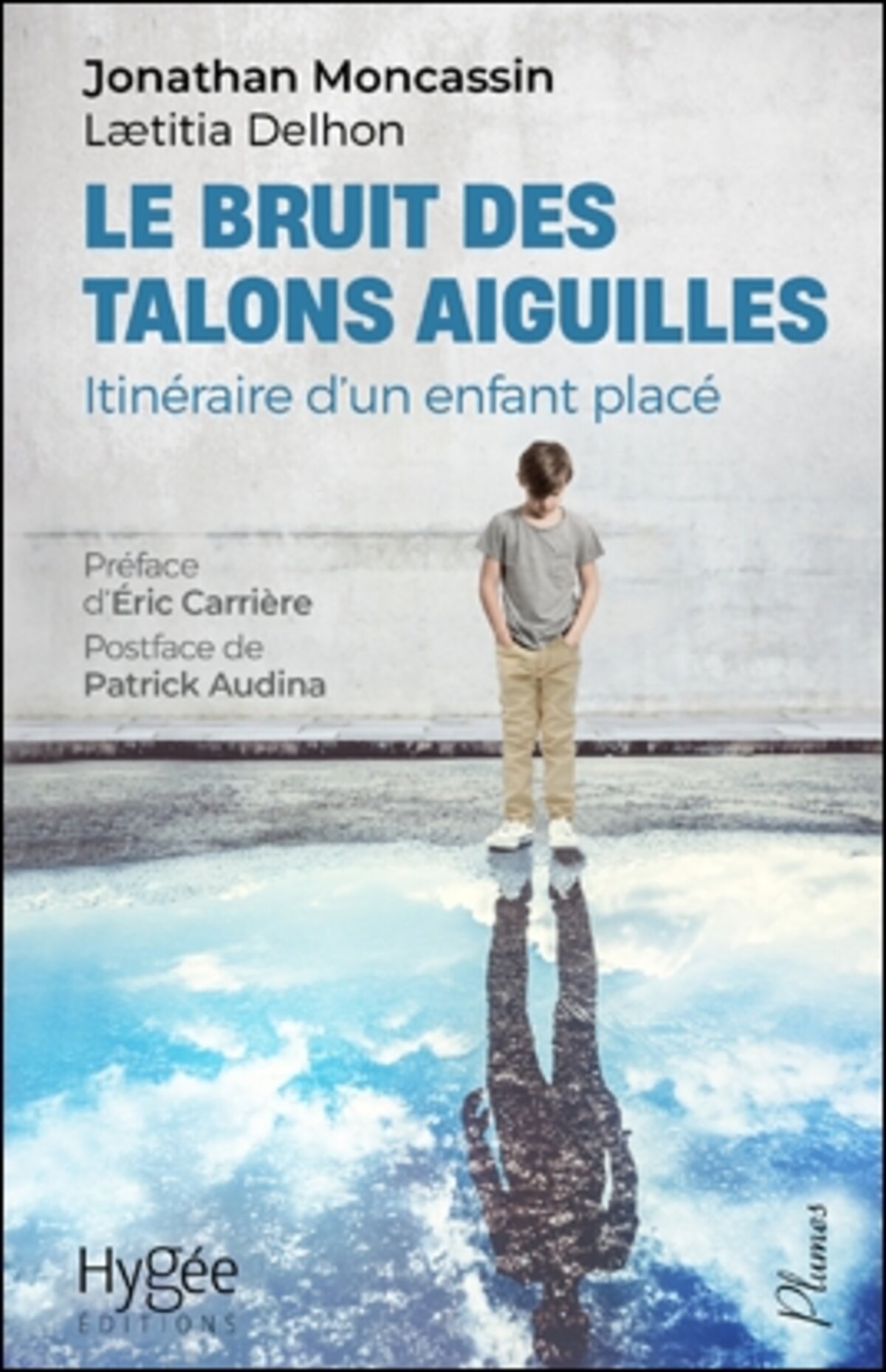
Les récits sur le passé d’un enfant placé ne sont pas rares. Souvent, ils sont sincères c’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas à régler des comptes avec la société et la méchante DDASS, mais décrivent la réalité vécue : une situation familiale perturbée, une séparation douloureuse, un placement, en foyer ou en famille d’accueil, parfois serein, parfois compliqué, souvent les deux à la fois. Les adultes rencontrés ont été soit des bouées de sauvetage, soit des individus qui ont alourdi la charge. Ce sujet est particulièrement sensible car il touche chacun, même s’il n’a pas été placé : il renvoie à l’enfance, à sa propre enfance, à celle de nos enfants. C’est pourquoi chacun est persuadé qu’il a un avis d’expert à donner sur le sujet, c’est pourquoi ce sujet brûlant est bien souvent mis en pâture dans le débat public par des médias peu scrupuleux cherchant d’abord et avant tout à faire de l’audimat. Se moquant du tiers comme du quart de la réalité humaine que recouvre la question de l’"enfant placé". Dans des salles de rédaction, dans des maisons d’édition, on lance à la cantonade : c’est bon Coco, il y a un sujet à faire, à condition que l’histoire soit bien saignante pour que l’on fasse pleurer dans les chaumières. Des associations lilliputiennes se proclament défenseuses de l’enfance en danger, il arrive même que des tribunaux les habilitent pour ester en justice ! Plus souvent préoccupées d’accabler les professionnels éducatifs et sociaux qu’à chercher à comprendre, lors d’un drame, ce qui s’est réellement passé.
C’est pourquoi lorsqu’un ancien enfant placé prend la plume pour raconter son parcours et qu’il le fait avec honnêteté, le témoignage est précieux et mérite d’être connu. C’est le cas de Jonathan Moncassin, qui publie, avec l’aide d’une journaliste, Lætitia Delhon, Le bruit des talons aiguilles (sous-titré, pour que ce soit moins abscons, Itinéraire d’un enfant placé), ouvrage court, bien écrit, pétri d’humanité, abordant beaucoup de questions, sans jamais sacrifier au jargon ou au misérabilisme. Sa lecture sera utile aux professionnels éducatifs et sociaux.
Jonathan décrit sa petite enfance, dans un contexte familial de cris, de coups, de violence verbale de la mère (syndrome bipolaire, diront les psychiatres plus tard), de violence physique et alcoolisée du père, gifles si fortes que l’enfant est projeté au sol. Un enfant doit bien vite trouver des stratégies d’évitement ou des explications pour tenir : qu’on lui parle durement valait mieux, finalement, que d’être ignoré. Il s’inventait des vies pour s’évader. Espoir sans fin d’être aimé tout de même par cet homme qui s’avère être un beau-père, refus de rencontrer le vrai père qui ne représente rien mais surtout par crainte de décevoir l’autre. Culpabilité permanente : suis-je responsable de cette violence, comment protéger mes frères et sœurs ? Mobilisation incessante afin de protéger une mère aimée, parfois aimante, et maltraitée par son conjoint. Situation étrange : la grand-mère maternelle est famille d’accueil, mais elle ne joue pas de rôle particulier dans la protection de Jonathan et de sa fratrie.
Après le départ du beau-père, après un court séjour chez un oncle violent, la mère quitte le nord et part avec ses enfants dans le Gers où elle a un cousin éloigné. Découverte d’une région verdoyante et d’un accent chantant qui amuse le futur « Ch’ti gascon ». Pour des raisons financières, la famille change plusieurs fois de maison, de village et donc Jonathan d’école (cinq en six mois). Quand la stabilité finit par s’installer, au grand bonheur des enfants, c’est alors que la mère sombre dans la déprime. Car il en est ainsi : des êtres humains ont connu tant de malheurs dans leur enfance qu’ils ont le sentiment que le bonheur leur est interdit et s’emploient à le saboter quand, par chance, il se présente. Jonathan témoigne de cet extrême bonheur qu’il éprouvait quand sa mère sortait de la dépression, il redevenait enfant, n’ayant plus les charges de l’homme de la famille à assumer, sauf que cette accalmie était de courte durée.
Comme sa scolarité pâtissait de toutes ces incertitudes, à dix ans, il est orienté dans un IR (institut de rééducation, futur ITEP, institut thérapeutique éducatif et pédagogique). Sa mère l’a accompagné, il se souvient encore du bruit de ses talons aiguilles sur le parquet alors qu’elle s’éloignait (il saura par sa fratrie qu’elle avait alors pleuré toute la nuit). Il racontera le foyer à sa fratrie en le dépeignant de façon idyllique, en taisant sa tristesse. Il décrit le personnel de l’établissement : l’une douce et patiente, l’autre juste et tolérante, l’un amoureux des forêts, une autre ayant une autorité naturelle. Il admire certains éducateurs, il apprécie leur « bienveillance » et le « réconfort » qu’ils lui procurent. L’un lui fournit « une image masculine sereine et non violente » et l’aide à préparer un diplôme d’éducateur sportif. Il relève dans le détail la différence entre sa vie au foyer et ses séjours à la maison. Il décrit des violences au sein du foyer, des bagarres, des « intimidations sexuelles » mais au lieu de chercher à exploiter cette réalité en se présentant comme victime, il indique qu’il en fut épargné.
On comprend que l’Aide sociale à l’enfance (ASE) a eu son mot à dire, mais ce type de placement médico-social relève d’une prise en charge sécurité sociale. L’ASE n’apparaît presque plus dans le récit : on sait simplement que des visites à domicile ont lieu mais que tout est fait pour dissimuler la tyrannie de la mère imposant des corvées permanentes aux enfants, menaces et coups. Jonathan a pris son parti d’avoir payé (en étant placé) tout en évitant cette séparation aux autres. D’autres enfants naissent car un animateur de centre aéré, de dix ans son cadet, compagnon de la mère, vit à la maison et devient de plus en plus violent.
Quand au bout de quatre années, il doit partir dans un autre établissement, il est malheureux de quitter cet encadrement éducatif. Dans son nouveau foyer, il a une chambre pour lui tout seul, sauf que cela l’angoisse (ça ne lui était jamais arrivé jusqu’alors). Déception : il espérait rejoindre une scolarité classique mais on l’oriente vers une formation en alternance, avec stages en entreprise. Son nouvel éducateur, Jean, est « un homme pondéré et bienveillant ». Le monde est petit, Jean est depuis longtemps l’un de mes amis : je ne l’ai pas connu dans l’exercice de ses fonctions, mais la description me parait très bien lui correspondre. Puis à 15 ans, devenu apprenti menuisier, il rentre « chez [sa] mère », regrettant l’ambiance du foyer. Son pécule lui étant chouravé par sa mère, il fait des extras chez des agriculteurs sans l’en informer. Le jeune compagnon de la mère a des comportements délictueux (trafic de piratage de jeux sur Internet, ainsi que des photos pédophiles dans son ordi), ce qui lui vaut la prison. Jonathan n’en peut plus de cette famille, mais il doit assurer pour protéger ses petits frères et sœurs. Il intervient deux fois pour empêcher que sa mère ne se suicide.
Jonathan se coltine des emplois pénibles (comme l’abattoir d’Auch). Il a manifestement des qualités relationnelles qui font qu’il a des amis et que des parents d’amis ont envie de le soutenir. Il sait qu’il ne peut compter sur personne dans sa famille. Des adultes l’aident à passer des concours, des diplômes, et lui s’accroche et obtient le diplôme d’éducateur sportif puis d’éducateur spécialisé dans le cadre de la VAE (validation des acquis d’expérience). Il considère qu’il s’en est sorti parce que le compagnon de sa mère l’a mis à la porte : il a fallu alors qu’il construise lui-même son propre avenir. Avec tout de même la culpabilité d’avoir abandonné sa fratrie. Le sport a été aussi un élément puissant de son intégration : le livre est préfacé par Éric Carrière, un footballeur professionnel renommé qui venait jouer avec les enfants de l’IR sollicité par son beau-père qui était éducateur spécialisé dans cet établissement. Où, une fois diplômé, Jonathan a été embauché quinze ans après y avoir été pensionnaire, dans un étonnant « retour vers le futur » comme il l’écrit lui-même. Dès son arrivée, il a prévenu : j’étais enfant placé jadis ici, est-ce que ça va poser problème ? Apparemment non, mais lui n’oubliait pas et voyait dans chaque enfant un peu son histoire, bien que l’état psychique des pensionnaires lui semblait bien plus troublé qu’à son époque. Il y reste sept ans jusqu’à ce que l’association gestionnaire vive une crise qui conduit à la fermeture de l’institut. Le travail d’accompagnement des enfants n’était plus ce qu’il avait connu : « le soin, l’éducatif et la hiérarchie posaient problème ». Il critique les managers mal formés, faisant « de la gestion de portefeuille comme des commerciaux » : « les conditions de travail régressent et deviennent maltraitantes ».
Jonathan, au détour d’une phrase, évoquant ses amis adolescents, se souvient de l’un d’entre eux , Paul, qui avait subi des attouchements de la part de son père. Il lui avait conseillé d’en parler à une professionnelle qui lança un signalement : alors « tout explosa dans la famille », il fut placé, ils ne pouvaient plus jouer au foot ensemble, « mais surtout, il était démoli ». C’est un des aspects de ce livre : une expression tout en sincérité, refusant les lieux communs (bon nombre d’ouvrages sur les enfants placés, mis en avant par certains éditeurs, auraient préféré taire cette réflexion "incorrecte").
Par ailleurs, il exprime des réserves sur l’inclusion : les institutions ne proposent plus des lieux d’accueil et d’accompagnement adaptés, il faut inclure dans le système général sans mettre en place le soutien intense nécessaire et le partenariat indispensable. Il regrette le temps « des éducateurs passionnés ». Il ne croit plus au travail en établissement, et est tenté par le travail social en libéral, sans plus de précision.
. Le bruits des talons aiguilles, Itinéraire d’un enfant placé, éditions Hygée, 2023, 130 pages.
***
Rencontre à Ombres Blanches
Dans les locaux de la librairie Ombres Blanches à Toulouse, le 26 février, une rencontre est organisée avec Jonathan Moncassin et Lætitia Delhon. Des membres du Collectif Enfance 31 présentent les intervenants. Ce collectif, qui existe depuis 2015, a organisé plusieurs journées de réflexion sur la protection de l’enfance (voir en annexe).

Agrandissement : Illustration 2

Lætitia Delhon est journaliste à Toulouse, spécialisée dans le secteur social (protection de l’enfance, petite enfance, handicap). Elle écrit pour Le Média social et pour Mediapart et a mené des entretiens dans divers ouvrages. A l’origine, elle a vu le nom de Jonathan Moncassin et son témoignage dans un texte de l’AIRe (association qui réunit les ITEP, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, anciennement IR, instituts de rééducation).
Elle a rencontré Jonathan en 2019 en vue d’un portrait pour Le Média Social. Il a alors raconté son histoire d’où il ressortait que son placement en établissement l’avait aidé à se construire. L’intérêt était que cela s’inscrivait autour des violences intra-familiales, sujet en débat aujourd’hui. Son placement s’est globalement bien passé, il a rencontré des éducateurs qui l’ont tiré vers le haut. Si chaque histoire est unique, il y avait là quelque chose à transmettre. D’où l’idée de lui proposer d’écrire. Ce qu’il a fait, manuscrit retravaillé pour aboutir au texte publié.
Jonathan précise qu’il est originaire du Pas-de-Calais, venu avec sa famille car ils avaient des cousins éloignés à Seissan, dans le Gers. Il se souvient combien lui et sa fratrie paraissait bizarre avec leur accent chti : « ce n’était pas le même français ». Suite aux déménagements répétés, ils ont fait plusieurs écoles en peu de temps. Il fallait chaque fois s’adapter. Les débuts ont été chaotiques. Sa mère allait mal, il a essayé de la sauver.
En 1994, il se retrouve en établissement et y reste durant 7 années.
Depuis six ans, il est amené à s’exprimer en public sur son passé, il a rencontré beaucoup de gens ayant vécu la même chose et venant se confier à lui. Son placement a été douloureux car il laissait de ce fait ses frères et ses sœurs, mais aussi sa mère. Il voulait témoigner car il en avait marre que l’on stigmatise sans cesse dans le débat public les mauvaises pratiques, sans aller voir sur le terrain celles qui ont cours. Même si à son arrivée au château de Lescout (à Jégun, dans le Gers), il prend assez vite « un coup de tatane », il a de bons souvenirs d’éducateurs qui l’ont marqué. La rencontre change notre posture, dit-il, ce qui permet d’investir la vie différemment, et de dépasser la dépression infantile et le stress. Il assumait d’avoir été en somme sacrifié : la sanction tombait sur lui ce qui avait protégé les autres d’un placement.
Ensuite, il s’est retrouvé dans un autre établissement de la même association où il a tout fait exploser car il ne s’y plaisait pas. Il a fait une formation de menuisier, plus tard a obtenu un diplôme de natation, a travaillé dans des établissements sans pouvoir devenir éducateur spécialisé comme il le souhaitait. Puis il a pu enfin faire cette formation dans le cadre de la VAE. Il a été embauché dans l’établissement où il avait été pensionnaire, sans le cacher au directeur et à l’équipe. Pendant dix ans, son passé enfant dans cette institution n’a pas eu d’importance, mais quand elle a commencé à dysfonctionner, il a rappelé ce qu’il avait connu jadis ici, des relations éducatives de qualité, alors on le lui a fait payer. Il a rencontré beaucoup d’éducateurs qui, sans avoir été placés dans leur enfance, ont été maltraités et ont pu choisir ce métier pour cette raison. Lors de colloques, ils lui ont livré cette confidence discrètement de crainte qu’on leur en tienne rigueur.
Aujourd’hui, il est médiateur au CFAA (centre de formation des apprentis agricoles) du Gers, éducateur sportif et éducateur spécialisé en libéral. Si tout va bien pour lui, il sait qu’il a dû assumer sa part de fragilité et qu’il ne guérira peut-être jamais de ce qu’il a vécu.
Lætitia Delhon constate que beaucoup d’enfants placés sont devenus éducateur et 15 % des assistants familiaux ont été placés. Le dispositif d’accueil de la protection de l’enfance est géré à 95 % par des associations financées par le Conseil Départemental (pouponnières, familles d’accueil, établissements). Beaucoup d’associations, qui emploient trop souvent des intérimaires, peu ou pas formés, vont mal, les enfants sont ballotés entre plusieurs dispositifs. Jadis, les enfants placés on ne les entendait jamais. Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux racontent ce qu’ils ont vécu. L’un d’eux, Lyes Louffok, décrit le mauvais côté de la protection de l’enfance et il est suivi par beaucoup d’enfants encore placés. Les travailleurs sociaux ne savent pas parler de leur travail, alors que la protection de l’enfance va très mal, l’État et les Départements se renvoient la balle. Par ailleurs, il y a une instabilité ministérielle, avec une succession rapide de titulaires du poste pour l’Enfance.
Lors de l’échange avec la salle, il est noté que le placement de Jonathan dans cet ITEP relevait d’une prise en charge sécurité sociale. On ignore s’il y avait un référent ASE désigné, mais ce qui est sûr c’est que, malgré la description préoccupante qui est faite, le reste de la famille ne semblait pas bénéficier d’un suivi social et éducatif soutenu. Jonathan précise qu’il y a eu beaucoup d’enquête mais que les enfants se sont concertés, avec lui, pour que les éléments d’inquiétude soient bien cachés. Il aurait fallu être aguerri pour déceler le contexte réel. Il note cependant qu’il a… une sœur assistante sociale et une autre psychologue.
Dans la famille, certains, à la lecture du livre ont été surpris. Une sœur a dit qu’elle n’avait pas vécu ça, mais admettait ce qui est dit quant à la violence. Jonathan Moncassin considère que sur cette même histoire il peut très bien y avoir plusieurs versions. Par ailleurs, l’état de santé de sa mère ne permet pas de l’informer de l’existence de cet ouvrage. C’était important pour lui de produire ce récit après la naissance de son propre fils, coucher sur le papier c’était aussi essayer de comprendre. Ses grands-parents, aimants, ont admis qu’ils n’avaient pas su le protéger.
Les militants du Collectif Enfance 31 annoncent qu’une démarche a lieu auprès du président du Conseil Départemental de Haute-Garonne en vue d’États Généraux de la Protection de l’Enfance. Pour Lætitia Delhon, il y a une grande nécessité de coopérer, dans un système français en ciseaux, entre soin et travail social, entre social et santé mentale (beaucoup d’enfants abimés psychiquement), entre Agence Régionale de Santé, Conseils Départementaux et Associations. Tout le monde cherche des réponses. Il faudrait moins de décisions descendantes et davantage de participation sur le terrain.
----
Être de l’autre côté
Jonathan Moncassin, témoignant au cours des journées de l’AIRe à Montpellier, est l’auteur d’un article paru dans la revue Empan, 2022/1 (n° 125) sous le titre Être de l’autre côté. Extraits :
« Parfois dans mon parcours de « soin », j’ai vécu des violences. Mon histoire contient aussi ces moments-là qui font partie de moi. Cependant la rencontre d’éducateurs m’a permis de penser ma personne différemment, d’apprendre à tenter la rencontre. En particulier avec un éducateur sur des temps d’échanges et sous toute forme de support relationnel.
Cet apprentissage de la relation à l’autre s’est poursuivi par la suite dans la rencontre de personnes ressources dans le post-établissement, avec des sportifs me permettant d’intégrer une pratique de compétition en natation, triathlon, vélo et course à pied. Des rencontres plus culturelles avec deux personnes qui m’ont aidé, dont une à me sortir de mon analphabétisme. Quant à l’autre, elle a accepté de continuer à m’apprendre des savoirs scientifiques sous forme littéraire malgré une dyslexie envahissante. Ces rencontres m’ont permis d’être bien dans mon corps et ma tête. C’est capital qu’il y ait des rencontres qui permettent de reprendre espoir ».
----
Le Collectif Enfance 31 sur Social en question :
. La protection de l’enfance un parcours d’obstacles (2018).
. Les droits de l’enfant avec le Collectif Enfance 31 (2020).
. La justice des mineurs : des réformes pour quelles pratiques (2021).
Autres récits d’enfants placés :
. Témoignage lucide d’un enfant placé, "n° 53".
. "Mon doux foyer", témoignage d’un enfant placé.
----
Billet n° 793
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600.
Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



