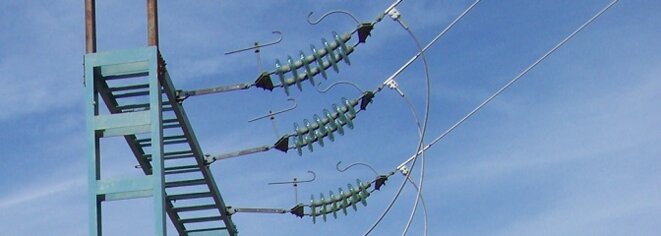-

Outre-Rhin, le « monde d’après » s’ouvre avec la mise en service d’une des centrales électriques les plus polluantes d’Europe occidentale : le 30 mai dernier, l’Allemagne a inauguré la centrale à charbon de Datteln 4. D’une puissance de 1100 MW, elle va bruler chaque année quelques 3 millions de tonnes de charbon et rejeter près de 5 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère [1]. Jusqu’en 2038.
-
Les dix plaies d’Égypte, appliquées au nouveau monde. En pleine épidémie de coronavirus, les habitants du comté de Midland, aux Etats-Unis ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu’en raison des négligences répétées de leur propriétaire, deux barrages hydrauliques ne résisteraient pas aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région mi-mai, causant d’impressionnantes inondations.
-
En matière d’électricité, on ne peut pas vraiment dire que l’herbe est plus verte ailleurs. Si la balance commerciale française est systématiquement négative depuis vingt ans [1], l’industrie électrique, elle, a chaque année un solde largement excédentaire. Car oui, à l’image des voitures ou des bouteilles de vin, les électrons aussi s’exportent et s’importent quotidiennement.
-
Il y a quelques semaines, une fronde s’est déclarée de la part de plusieurs fournisseurs alternatifs d’électricité à l’encontre du fournisseur historique EDF. Pour comprendre les rapports de force à l’origine de ce conflit, revenons sur une étape structurante de l’histoire de l’électricité, en filant une analogie boulangère.
-
Le stockage de l’énergie est un défi incontournable de la transition énergétique. Or, aujourd’hui, en France, il est possible d’emmagasiner de grandes quantités d’énergie, et de la restituer au moment opportun. Panorama d’une technique certes modeste, mais éprouvée.
-
Est-il pertinent de comparer la puissance du parc éolien avec la puissance du parc nucléaire ? La quantité d'énergie produite par une éolienne équivaut-elle à la même quantité d'énergie produite par une bonne vieille centrale à charbon ? La réponse à ces questions n'est peut-être pas aussi évidente qu'elle en a l'air.
-
Le dimanche 29 mars dernier, la production d’énergies renouvelables a établi un nouveau record : sur cette journée, elle a contribué à fournir 35 % de l’énergie électrique produite (le précédent record, 34 %, datait de juin 2019) [1]. C’est beaucoup, mais est-ce tant que ça ?
-
Saviez-vous que le discours présidentiel du lundi 13 mars a généré une baisse de la consommation électrique de près de 5 % ? Que l’énergie exportée par la France a battu un record ces dernières semaines ? Dans cette période extra-ordinaire, la demande et la production d’électricité ont aussi, à l’instar du médiatique pétrole [1], été bouleversées. Petit bilan non exhaustif.
-
En ces temps de confinement, le prix de l'énergie électrique sur les marchés de gros a chuté, à l'instar de celui, plus médiatisé, du pétrole. Il a atteint, le 22 mars dernier, un prix négatif de -25 euros pour un MWh électrique (l'unité qui permet de mesurer la quantité d'énergie). Qu'est-ce que cela signifie ? Et, finalement, est-ce une situation si inhabituelle ?