
Agrandissement : Illustration 1

Ciné 32 est une association engagée pour l’intérêt public, disposant de 7 salles de cinéma à Auch et coordonnant 15 cinémas dans le Gers, gérés par des associations locales (soit au total 26 salles, avec programmation forte en Art et Essai). Le dimanche 15 décembre, étaient organisées une après-midi et une soirée paysannes, en lien avec l’ADEAR (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural), CCFD Terre Solidaire, l’Association française d’agro-foresterie, la Confédération Paysanne du Gers, les Amis de la Conf ‘ et Solidarité Paysans. Trois films ont été projetés : The Forest Maker, du grand Volker Schlöndorff (sur Tony Rinaudo, australien, qui a développé en Afrique la culture des arbres à partir de racines souterraines existantes), Anaïs, 2 chapitres (documentaire sur une cultivatrice de plantes aromatiques, qui a un sacré culot et s’exprime sans filtre sur l’administration et son activité de paysanne : on assiste à deux périodes de sa vie, à dix ans d’intervalle), et Vingt Dieux qui, depuis quelques jours, cartonne en salle (un jeune paysan orphelin, en charge de sa petite sœur, prend le risque de se lancer dans la fabrication du comté dans le Jura).
Devant une centaine de personnes, l’opération a été présentée par Sylvie Buscail, directrice de Ciné 32, et par Denis Asfaux, qui oscille entre cinéma (il a travaillé jadis deux ans à Ciné 32) et agroforesterie (animateur national de l’Association française d’agroforesterie).
En cours d’après-midi, un débat, animé par Ludivine Tatieu-Bilhère (ingénieure agronome) pour l’ADEAR du Gers, a rassemblé Christian Trouche (ingénieur, ESAP Purpan) pour le CCFD-Terre Solidaire (il a passé quatre ans en Afrique et milite aussi à Paysans sans frontières, association membre de l’AFDI, agriculteurs français et développement international) et Romain Florent (ingénieur agronome, Paris), paysan, pour la Confédération Paysanne (fils de paysan, il ne voulait pas prendre un jour la succession sur la ferme familiale, mais après un séjour au Niger et avoir travaillé dans le développement agricole, il a fini par se décider de s’installer sur l’exploitation de 35 ha de ses parents, en GAEC avec quatre associés).
Beaucoup de questions sont abordées, sur l’alimentation, le réchauffement climatique, l’agriculture industrielle, les cultures bio, les dispositifs tendant à sauver l’agriculture : non pas avec des combats rétrogrades visant à favoriser une agriculture intensive avec d’innombrables intrants qui polluent terres et aliments (modèle au service de la mondialisation, du libre-échange et de l’accaparement des terres), mais en promouvant l’agriculture paysanne (respectueuse des paysans, des consommateurs, des cultures et élevages et assurant la souveraineté alimentaire).

Agrandissement : Illustration 2

Christian et Romain ont tenté de répondre à la question de savoir s’il faut installer davantage de paysan·nes dans les campagnes. Christian constate tout d’abord que deux milliards d’humains souffrent de l’insécurité alimentaire (dont 800 000 gravement). Après une légère baisse, ces chiffres sont repartis à la hausse avec le Covid et stagnent actuellement. Alors que chaque être humain a besoin de 2500 kilocalories par jour, on est en mesure d’en assurer 3000, il y a donc une marge (sous réserve que le changement climatique ne porte pas atteinte à ces capacités).
Romain évoque la forte insécurité alimentaire en France : 11 % selon l’Anses (l’Agence nationale de sécurité alimentaire), soit 8 millions de personnes. Il n’y a pas de réelle politique alimentaire de l’État, c’est la société civile qui y palie. Les familles consacrent 15 % de leur budget à se nourrir (c’était 25 % il y a un siècle, alors même qu’à l’époque il y avait beaucoup d’autoconsommation, puisque la population était majoritairement rurale). Les coûts réels de production ne sont pas pris en compte et l’agriculture est fortement subventionnée (PAC, aides indirectes fiscales, pour le monde agricole et pour les industriels), ce qui entraîne des prix plus bas : cela n’empêche pas une insécurité alimentaire. Cette question ne concerne pas seulement le sud mais aussi le nord. Les rendements stagnent au nord, voire diminuent : avec le réchauffement climatique, il ne faut pas envisager qu’ils augmentent.
Un paysan du nord peut cultiver jusqu’à 100, 200 hectares, au sud, 100 fois moins. Romain témoigne avoir vu en Ouzbékistan, trois étages de culture : arbres fruitiers, en dessous maïs, et sous le maïs des fraises. Mais pour cela il faut de la main d’œuvre : alors sur la même surface, on produira davantage. Il dit l’essayer sur sa ferme. L’agriculture paysanne c’est un circuit pertinent, valorisant les produits : chèvres, fromage, petit lait qui engraisse les cochons, et dans les pâturages les vaches derrière les chèvres pour manger ce qu’elles ont délaissé.
Christian confirme qu’on ne va pas gagner en surface (emprise des villes, des routes, érosion des sols). L’agronome Marc Dufumier a publié il y a quelques années un rapport dans lequel il évaluait à 20 millions le nombre de tracteurs dans le monde, 350 millions de traction animale et 1,5 million de travail de la terre à la main. Ces chiffres restent aujourd’hui valables : le nombre de paysans n’a pas diminué tandis que la population augmentait. Mais au nord, comme l’indique Romain, les paysans disparaissent : ils étaient encore en France 8 millions au sortir de la dernière guerre, 1,6 million en 1982, 400 000 aujourd’hui, avec environ 100 000 départs chaque année, tandis que la taille des fermes augmente : le nombre des petites fermes a été divisé par deux, celui de mégafermes multiplié par deux. La moitié des agriculteurs actuels seront à la retraite dans 8 ans. Le capital d’une ferme augmente, il est en moyenne d'un million d’euros, ce qui accroît le problème de l’avenir de l’agriculture, car un jeune ne peut pas se lancer (ce sont les voisins qui rachètent ou un fils de paysan).

Agrandissement : Illustration 3

Selon Christian, dans le monde des ruraux du sud, la solution pour sortir de l’appauvrissement, afin qu’ils n’aillent pas engorger les villes, c’est de partir de leurs réalités et de jouer la carte du développement local.
Selon Romain, la solution ce ne sont pas les drones ou les robots dans l’agriculture du nord (il cite cet exemple en chine où 650 000 cochons sont installés dans un bloc de béton de 26 étages, ou des laitues cultivées dans des bâtiments artificiels au Danemark : la moindre bactérie, et c’est la catastrophe). C’est ce qui se passe avec la grippe aviaire, l’agriculture intensive est beaucoup trop sensible aux aléas, pas du tout résiliente. La guerre en Ukraine a impacté durement les fermes qui étaient ultra-spécialisées, automatisées et non pas les fermes diversifiées. Contrairement à l’agrobusiness industriel, l’agriculture paysanne va à l’encontre de l’artificialisation des sols.
La Confédération Paysanne milite pour que l’agriculture française soit exercée par un million de paysannes et paysans (« il vaut mieux 1000 paysans sur trois hectares que trois paysans sur 1000 hectares »). La Conf’ veut redéfinir la souveraineté alimentaire, c’est le droit de la population de définir la politique alimentaire et agricole. Ça remet en cause le système actuel qui découle de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) et des accords de libre-échange : c’est la seule possibilité d’assurer un revenu. Il faut bien comprendre que l’agriculteur qui est sur 3000 hectares n’est pas propriétaire de ses terres, cela suppose des investisseurs. Il y a de gros achats de terres, entre autres par la Chine : on est dans une logique de balance commerciale, et non pas de souveraineté alimentaire.
Un agronome a montré qu’au sud ce n’est pas seulement une question de pauvreté mais aussi d’exclusion : l’accaparement des terres, y compris pour compenser le CO², provoque l’expulsion de paysans. La mise en concurrence des paysans c’est le contraire de ce qu’il faut faire. Le problème est qu’il manque une volonté politique. Mais la profession agricole a sa part de responsabilité avec ce modèle de la co-gestion entre l’État et la FNSEA, dont le président actuel n’est pas un paysan mais un agro-industriel qui dicte ses desiderata au pouvoir politique, selon un modèle au service de la mondialisation et du libre-échange. Est posée la question cruciale du foncier dont le prix a doublé, par exemple, dans le Gers, en 15 ans. L’installation de nouveaux agriculteurs est orientée par la Chambre d’Agriculture, heureusement qu’il y a l’ADEAR pour conseiller les jeunes avec une autre vision de l’agriculture. Le travail de Terre de liens est évoqué, association, fondation et entreprise d’investissement solidaire, avec portage du foncier ce qui évite pour le paysan l’achat ruineux de terres (nombreuses fermes existent aujourd’hui grâce au financement de Terre de liens). C’est autre chose que les baux précaires d’un an qui mettent l’agriculteur dans une situation catastrophique quand il perd sa terre l’année suivante. Une question de la salle porte sur les cotisants solidaires, statut particulier de la MSA (Mutualité sociale agricole) qui ne votent pas à la Chambre d’agriculture où seuls les chefs d’exploitation ont droit de vote. La Conf’ milite contre cet état de fait.

Agrandissement : Illustration 4

Sylvie Colas, porte-parole nationale de la confédération Paysanne, éleveuse de volailles dans le Gers, dénonce l’envahissement de la finance dans notre société, y compris dans le vivant. Elle témoigne du combat mené par la Compesina en Colombie (elle a assisté à la COP16 sur la biodiversité qui s’est tenue à Cali cette année du 21 octobre au 1er novembre). Sa collègue colombienne doit être en permanence accompagnée par deux gardes du corps, car les gros propriétaires s’accaparent les terres, engrangent les primes-carbone, poursuivent leur entreprise de pollution et répriment les peuples autochtones. La préservation de la biodiversité c’est aussi un rempart contre les épidémies majeures. Christian précise que le CCFD de Midi-Pyrénées travaille avec le Rwanda et le Burundi.
Une "consommatrice", dans la salle, considère qu’il faut s’appuyer sur les consommateurs pour faire évoluer les choses, il faut passer par l’opinion publique pour porter le plaidoyer. Les intervenants approuvent mais il y a aussi une responsabilité politique, tout ne peut reposer sur les consommateurs : ils citent les Projets alimentaires territoriaux (PAT) qui ont l'ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire (prévoyant, entre autres, d’attribuer des produits locaux de qualité dans les cantines et les Ehpad).
Puis, un repas paysan a été servi par le Ciné Bistrot. La librairie de Sarrant tenait une table avec des ouvrages sur le sujet.
Vingt dieux : Le Jura conté en profondeur
Bien que Stéphanois, j’ai vécu longtemps en Franche-Comté où j’ai même participé à une publication, L’Estocade, qui avait pour sous-titre Journal franc-comtois : la Comté et le comté, j’aime bien (forêts et affinage 18 mois). Quand un film porte sur cette région, je suis tenté d’aller le découvrir, a fortiori s’il traite de l’agriculture, que j’approche de plus en plus en vivant dans le Gers. Enfin, Vingt dieux promet de traiter de la précarité, d’une classe sociale populaire dont les membres doivent se battre pour s’en sortir. C’est pourquoi je suis allé le voir en avant-première au Festival Indépendance(s) & Création de Ciné 32 à Auch début octobre.

Agrandissement : Illustration 5

Totone se retrouve seul tout juste majeur, en charge de sa petite sœur, Claire, 7 ans. A fleur de peau, souvent renfrogné, il n’est pas prêt à se laisser abattre (« Comtois rends-toi, nenni ma foi »), se fixe des défis, prend des risques, jusqu’à imaginer qu’il peut sans soutien se lancer dans la production de comté et gagner la médaille d’or d’un concours agricole (on suit toute l’opération de fabrication). Il va bien galérer, mais ce qui compte ce n’est même pas tant l’histoire que la façon dont sont campés les différents personnages, tous rugueux mais avec une force de caractère indéniable. La réalisatrice, Louise Courvoisier (originaire du Jura, 30 ans, premier film), a voulu montrer sa façon de voir le monde rural et filmer cette jeunesse qui apparait peu au cinéma, bière, bals et p’tites pépées, mais aussi situations familiales difficiles, galères, accidents, débrouillardise, amitiés, vitalité. Elle cherche à leur donner une autre image, à gratter la première impression : Totone (Clément Faveau), excessif mais volontaire, Marie-Lise (Maïwène Barthélemy, 22 ans, étudiante en BTS production animale à Vesoul, nommée pour le César de la révélation), jeune agricultrice seule sur sa ferme, carrée mais sensuelle, Claire (Luna Garret), discrète mais décidée (on aurait aimé que cette enfant énigmatique ait un rôle plus important). Et une fromagère chaleureuse (gardienne de prison dans la vraie vie).
Réalisé sans doute avec de petits moyens (plusieurs membres de la famille Courvoisier sont au générique), Vingt dieux a été tourné en partie à la Fruitière de Fontain, dans le Doubs. Malgré une histoire qui n’est pas un long fleuve tranquille, il n’empêche qu’il respire la gaité, l’humour, la bienveillance. Et les acteurs sont vraiment épatants. Ce film (prix Jean-Vigo 2024) devrait recueillir un franc succès, il le mérite.
[chronique publiée sur mon compte Facebook le 10 décembre, la veille de la sortie du film en salle]
. bande-annonce :
. occasion de rappeler le beau film de Samuel Collardey, L'Apprenti (2008) qui met en scène Mathieu (Mathieu Bulle), 15 ans, élève dans un lycée agricole, apprenti en alternance dans la ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux du haut Doubs.

The Forest Maker, ou l’homme qui ressuscite les arbres
Ce film de Volker Schlöndorff fait le portrait de Tony Rinaudo qui a inventé une technique de régénération naturelle permettant de faire pousser des arbres (il en aurait fait pousser deux cents millions). C’est le premier film agroforestier de l’histoire du cinéma, précise Denis Asfaux, alors que l’agroforesterie a 10 000 ans ! Cette technique est confinée sur Youtube, là un film en rend compte. Sauf que ce film, s’il a été diffusé en Allemagne, ça n’a pas été le cas en France, excepté sur Arte en novembre 2022, sous le titre L’Homme qui ressuscite les arbres. On pourrait voir dans le regard de Tony celui d’un colon qui assène ses connaissances. Mais en réalité, c’est en débarquant au Niger en 1981, que le jeune agronome australien découvre une légende africaine sur « l’enfantement des graines » et le réseau de racines souterrain, permettant de faire surgir des forêts entières sans planter un seul arbre. Venu pour six mois, il y restera 19 ans.
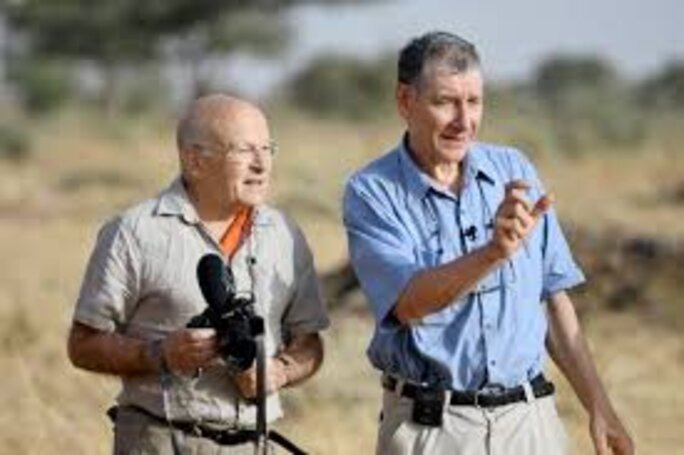
Dans le film, Tony revient sur les lieux en 2018 et rencontre des personnages qu’il a connu en ces lieux quarante ans plus tôt, qui l’accueillent chaleureusement, il parle leur langue. Il va à l’encontre de l’esprit colonial qui avait importé l’agriculture intensive et ses effets dévastateurs, avec dégradation des sols. Le film rappele la famine dramatique de 1984-1985 en Ethiopie : un million de morts. Un proverbe africain dit : « Qui soigne ses arbres, jamais ne mourra de faim ». L’agroforesterie, la culture sous les arbres, permet un rendement deux à trois fois supérieur. Par ailleurs, les arbres sont des nids pour de nombreuses espèces. Par contre, le projet tentaculaire de plantation d’une "grande muraille verte" au Sahel sur 15 kilomètres de large a été en partie un échec, peu d’arbres ont poussé (45 000 ha reboisés au lieu des 100 millions prévus), les fonds alloués ont été engloutis. Schlöndorff inclut dans son film de nombreux documents et des animations mélangées aux images, il livre des extraits du film d’Alassane Diago, Les larmes de l’émigration, dans lequel la mère du réalisateur raconte l’absence du mari parti depuis vingt-cinq ans.
. bande-annonce : "The Forest Maker" :
Anaïs, 2 chapitres
Ce titre étrange renvoie au fait qu’il y a eu un premier film Anaïs s’en va-t-en guerre sur l’histoire d’Anaïs Kerhoas, 24 ans, en Bretagne, qui se lance dans sa passion : cultivée des plantes aromatiques. Elle a un sacré culot et s’exprime sans filtre sur l’administration, sur les profs, sur les intempéries et son activité de paysanne. Certains passages sont truculents, car on la sent déterminée mais elle a un fichu caractère, rouspète sans cesse car les obstacles sont permanents. Mais elle aime son métier, elle est inventive et a un certain succès (un grand cuisinier, Olivier Roellinger, lui achète ses productions). Ce documentaire réalisé par Marion Gervais n’a pas été diffusé en salle mais sur France télévision, et vendu en DVD. Un deuxième film, Anaïs s’en va aimer, a également été diffusé à la télévision, tourné dix ans plus tard par la même réalisatrice : Anaïs, qui a bourlingué entre temps (elle est allée vivre un temps au Sénégal, ce que le film ne dit pas), est amoureuse d’un homme qu’elle veut faire venir en France. Elle n’a pas perdu de sa faconde, on est toujours plongé dans une question agricole (la paysanne reste active dans la production de ses plantes) mais elle doit batailler également pour faire venir son amoureux, Seydou, qui vit au Sénégal (là encore, l’administration, ou plutôt la loi sur les titres de séjour est rigoureuse). Le film bascule quasiment dans le portrait intimiste : l’arrivée du jeune homme, costaud, quelque peu désemparé face au caractère bien trempé de son épouse, et les tensions qui naissent, mais finalement le registre "paysan" subsiste. Il faut planter, désherber, récolter, faire sécher. Des deux films, on arrive à un seul : Anaïs, 2 chapitres. C’est étrange, mais plaisant à voir.
Anaïs, 2 chapitres :
_____

. Anaïs Kerhoas, à 33 ans, a publié un livre qui raconte son histoire, de sa naissance à son entreprise de plantes aromatiques et médicinales et le premier film, en passant par un séjour en Inde. « Héroïne balzacienne », a commenté Le Figaro. Elle raconte de façon moins truculente qu’à l’oral mais avec un art certain de l’écriture son parcours, sans fard, y compris ses relations problématiques avec son compagnon, pas seulement de route, au Rajasthan. Mais le but est surtout de montrer combien il est compliqué de vouloir monter une entreprise de simples. La jeune femme voudrait vivre de et dans la terre nourricière, cultiver aubépine, guimauve, marjolaine, sauge, sureau, mais elle se confronte aux épines d’une paperasse qui la dépasse (éd. des Équateurs/Humensis, 2020).
_____
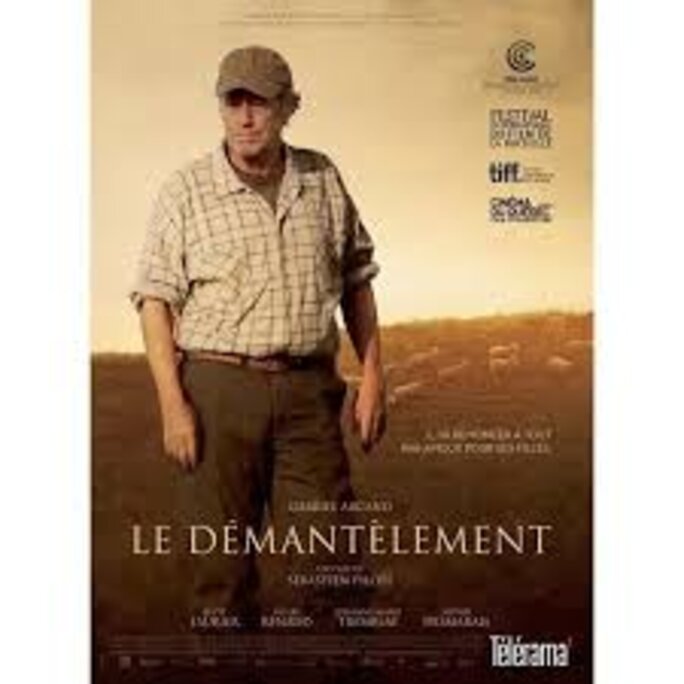
. Rappel : dans Le Démantèlement (2013), le réalisateur québécois Sébastien Pilote (avec Gabriel Arcand) raconte de façon magistrale le drame de Gaby, éleveur de moutons, contraint de vendre sa ferme pour se retrouver dans un logement HLM.
. voir sur Social en question :
Qui va nous nourrir, l’agro-industrie ou les paysans ?
Le « Salon des fermes paysannes »
Parole à l’agriculture paysanne
La Ferme des Bertrand, agriculture et transmission
Sainte-Soline, à visage découvert
La face cachée de la méthanisation
Noémie Calais, éleveuse : ne pas trahir l'animal
Des paysans agressés par l’État et les industriels
Nature et culture, terre et liberté
Billet n° 837
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).
Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



