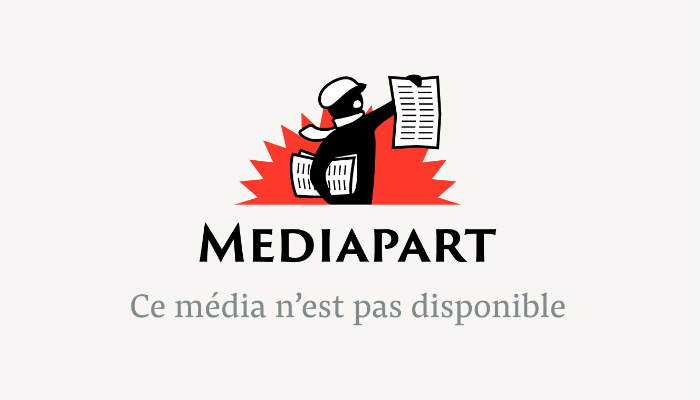-
Le 30 septembre 1965 reste une date d’horreur pour l’Indonésie : derrière la version officielle d’un complot communiste, un massacre de masse a coûté plus d’un demi-million de vies. Six décennies plus tard, les responsables n’ont jamais été jugés et les victimes attendent toujours justice et réhabilitation.
-
Jean-Paul Laborde, ancien sous-secrétaire général de l’ONU, encense le leadership de Prabowo Subianto à l’ONU. Charmant… si l’on oublie que des millions de paysans indonésiens survivent dans la pauvreté, que des enfants souffrent de malnutrition, et que le passé militaire du général au Timor oriental reste maculé par le massacre de Kraras.
-
Prabowo a été reçu aux Pays-Bas avec promesse de restitution d’artefacts. Mais derrière les sourires, l’hypocrisie demeure : La Haye n’a jamais reconnu juridiquement l’indépendance proclamée en 1945, préférant 1949 pour se décharger des crimes coloniaux et faire payer à l’Indonésie sa propre répression.
-
Certaines personnes, se drapant d’intelligence et d’autorité, imposent silence aux autres en répétant : « si tu ne sais pas tout, ne parle pas ». Mais exiger une expertise parfaite revient à étouffer le débat et à confisquer la parole. Face à cette intimidation, il est urgent de défendre le droit au questionnement.
-
En trois décennies, la rupiah indonésienne a perdu une grande partie de sa valeur, passant d’environ 2 000 pour un dollar à plus de 16 000 aujourd’hui. À l’inverse du bitcoin qui s’est envolé grâce à sa rareté, la monnaie nationale illustre les fragilités d’un système soumis à l’inflation et à la dépendance au dollar.
-
À Ketapang, le programme Makan Bergizi Gratis (MBG), censé nourrir sainement les élèves, a provoqué un scandale : vingt-quatre enfants et une institutrice ont été intoxiquées après avoir mangé du requin, une espèce largement protégée. Ce menu « exotique » met en lumière les failles sanitaires et éthiques du dispositif.
-
Oey Tamba Sia, héritier chinois de Batavia, fascinait et terrifiait. Séducteur des femmes des autres, manipulateur et meurtrier, il semait chaos et scandales dans toute la ville. Entre passions interdites et intrigues cruelles, sa vie devint un théâtre de débauche et de rumeurs sulfureuses.
-
Chaque année, des milliers de chrétiens indonésiens de la classe moyenne voyagent en Israël pour marcher sur les pas des saints. Discrets mais réguliers, leurs séjours modérés — hôtels, restaurants, transports — créent un flux économique invisible mais puissant. La foi humble devient ainsi un moteur financier silencieux.
-
Le 22 septembre 2025, à Sihaporas (Sumatra), des autochtones Tano Batak se sont heurtés violemment aux employés de Toba Pulp Lestari. Trente-trois villageois ont été battus, dix hospitalisés. Au cœur du conflit : 1 500 hectares de terres ancestrales convoitées par l’entreprise, symbole de tensions foncières persistantes en Indonésie.
-
Le monde n’offre rien : le bonheur et le progrès ne tombent pas du ciel, ils se prennent dans la révolte et la lutte. Face aux injustices, aux inégalités et à la corruption, chaque geste compte. Sans chef ni centre, l’action collective devient une flamme capable de transformer le monde.