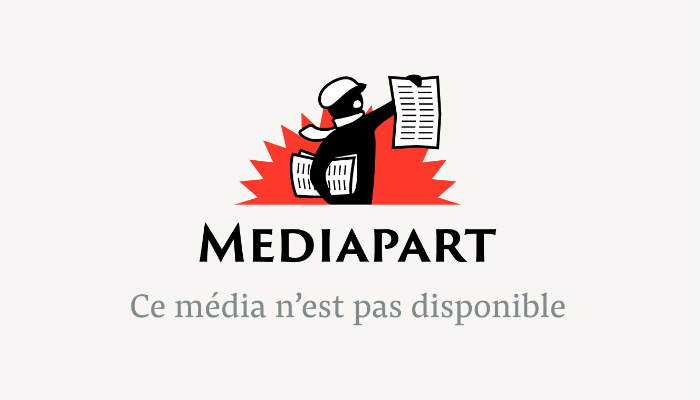-
Dans l’Indonésie contemporaine, l’expression « antek asing » sert à désigner des individus ou groupes accusés de trahison au nom d’intérêts étrangers. Cette rhétorique politique divise profondément la société, exacerbant les tensions identitaires et freinant le dialogue démocratique, notamment dans les régions comme la Papouasie, où les enjeux de souveraineté et de justice sociale restent vifs.
-
En Indonésie, les médias sociaux sont devenus un refuge face à la censure étatique des médias traditionnels. Ils permettent aux mouvements sociaux, comme Kamisan, de mobiliser et faire entendre leurs voix. Mais cette liberté numérique fragile fait face à la répression, la surveillance et la désinformation, posant un défi majeur à la démocratie et à la liberté d’expression.
-
Le nouveau Code pénal indonésien, présenté comme une décolonisation, instaure en réalité un autoritarisme moraliste. En criminalisant vie privée, dissidence et diversité, il fait de l’État un gendarme de la vertu, menaçant libertés et tourisme. Cette mascarade juridique trahit la démocratie et risque d’isoler l’Indonésie sur la scène internationale.
-
Les Samin, par leur sobriété et leur fidélité aux valeurs ancestrales, offrent une résistance pacifique face à un monde en crise. Refusant l’argent, la consommation et les normes imposées, ils incarnent un modèle alternatif, fondé sur l’équilibre avec la nature et la paix intérieure — une leçon puissante pour notre époque de surconsommation et d’urgence écologique.
-
On croit l’Indonésien irrationnel, le Français éclairé. Pourtant, esprits, porte-bonheurs et signes invisibles peuplent les deux quotidiens. Superstition ou sagesse masquée ? Et si croire aux fantômes n’était pas plus absurde que croire au progrès ? Un voyage au cœur des logiques secrètes qui gouvernent nos vies.
-
Français et Indonésiens vivent dans deux mondes parallèles, où sourire peut être une arme ou un mystère, où le « non » se cache derrière des mots doux, et où le temps se plie ou s’impose. Ces différences troublantes révèlent bien plus qu’une simple culture : elles questionnent notre rapport au réel, à l’autre et à soi-même.
-
En 1955, l’Indonésie offrait au monde le spectacle rare d’une démocratie foisonnante où même le marchand de brochettes avait son parti. Tandis que d'autres craignent la cacophonie, elle célébrait la polyphonie. Chaos ? Peut-être. Mais quelle audace ! Une leçon oubliée sur la beauté du désordre démocratique.
-
Et si la femme n’avait jamais été faible ? Dans plusieurs sociétés traditionnelles, les femmes détiennent un pouvoir fondamental, incarnant la continuité sociale et spirituelle. Ce modèle matrilinéaire, souvent ignoré ou déformé, invite à repenser le féminisme en valorisant des formes de puissance féminine non occidentales, basées sur la complémentarité et la transmission.
-
De nombreux États se dotent de ministères des droits humains pour afficher leur engagement en matière de justice et de dignité. Mais ces institutions, bien que symboliques, peinent souvent à transformer les discours en actions, surtout dans les contextes marqués par des tensions politiques ou sociales.
-
Dans nos sociétés, la légitimité de la parole semble réservée aux détenteurs de diplômes ou de titres officiels. Cette hiérarchisation silencieuse marginalise les voix populaires, pourtant riches d’expériences et de savoirs. Cet article interroge la confiscation symbolique de la parole et plaide pour une véritable démocratie des savoirs.