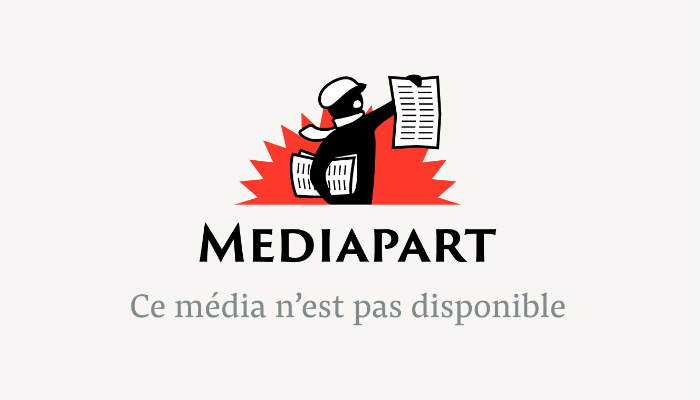-
Dans nos sociétés, la légitimité de la parole semble réservée aux détenteurs de diplômes ou de titres officiels. Cette hiérarchisation silencieuse marginalise les voix populaires, pourtant riches d’expériences et de savoirs. Cet article interroge la confiscation symbolique de la parole et plaide pour une véritable démocratie des savoirs.
-
Ils ont dit non au silence, aux compromissions, aux honneurs faciles. Munir, Marsinah, Muchtar Pakpahan, Mochtar Lubis : figures lumineuses et marginalisées d’une autre Indonésie, réprimée mais debout. L’histoire officielle les ignore. La mémoire populaire les chérit. Et la justice les attend.
-
Dans l’Indonésie post-pandémique, la foi devient industrie : Jakarta rêve de faire du halal un levier de puissance globale. Derrière les promesses de croissance éthique se dessine une normalisation religieuse, mêlant bureaucratie, soft power et exclusion silencieuse. Quand le sacré devient stratégie.
-
La présidence française, symbole d’une démocratie moderne fondée sur la légalité et la contestation, contraste fortement avec les figures d’autorité en Indonésie, souvent sacralisées et ancrées dans la tradition. Cette tension interroge les formes de légitimité politique et les défis de concilier modernité démocratique et héritages culturels.
-
L’Indonésie de Prabowo vient de lancer un programme de repas gratuits pour 80 millions d’enfants. Une promesse sociale d’ampleur historique… ou un mirage populiste aux relents clientélistes ? Et si la France imitait Jakarta ? Entre bonne intention et piège budgétaire, cette idée généreuse mérite d’être passée à la moulinette critique.
-
Alors que le monde occidental se concentre sur l’Ukraine et la crise climatique, l’Indonésie choisit de serrer la main de Poutine. Pragmatique ou complice ? Ce rapprochement troublant interroge la véritable nature de la multipolarité indonésienne : simple jeu d’équilibre stratégique, ou dangereuse ouverture à l’autoritarisme au nom d’intérêts purement étatiques ?
-
Né sur l’île de Java, Raden Saleh fut un peintre princier mêlant influences européennes et identité javanaise. Dans ses œuvres, il subvertit les codes coloniaux en exprimant la résistance silencieuse de son peuple. Son retour à Java marque une réappropriation politique et culturelle, faisant de lui un pionnier de l’art moderne indonésien et un symbole postcolonial.
-
L’Indonésie multiplie les achats d’armes et affirme une puissance militaire croissante. Mais derrière ces contrats et discours sécuritaires, se dessine peut-être une autre réalité : celle d’un pays qui, en misant sur la force, pourrait s’éloigner du dialogue social, fragiliser sa cohésion et compromettre, à terme, paix, justice et développement.
-
Derrière l’image d’une démocratie pluraliste, l’Indonésie porte les traces d’influences fascistes venues du Japon impérial et de l’Europe nazie. De l’Ordre Nouveau aux dérives néonationalistes actuelles, une culture autoritaire persiste. Ce texte interroge les héritages oubliés qui hantent toujours la République.
-
Nyai moderne, femmes indonésiennes : esclaves sexuelles d’hier et d’aujourd’hui, toujours marchandisées et sacrifiées au pouvoir patriarcal. Du harem colonial aux écrans d’OnlyFans, l’illusion de liberté masque une domination persistante. Derrière le voile, la prostitution prospère, révélant l’ombre d’un empire sexuel qui refuse de mourir.