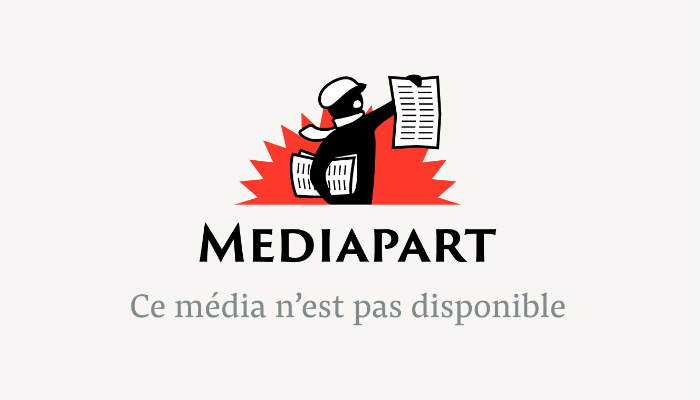-
En Indonésie, la démocratie est minée par une crise profonde : si les politiciens abondent, les véritables hommes d’État se font rares. Entre luttes d’intérêts, clientélisme et vision à court terme, la classe politique sombre dans un naufrage moral. Face à l’urgence nationale, un leadership éthique et visionnaire devient indispensable.
-
En Indonésie, une frange évangélique radicale affiche un soutien fervent à Israël, souvent alimenté par des réseaux internationaux, notamment américains. Ce phénomène, au même titre que l’islamisme radical, soulève des enjeux géopolitiques et sociaux qui menacent la cohésion d’un pays profondément pluriel.
-
Chez les Minangkabau, l’islam se mêle à une société matrilinéaire unique au monde. Ici, la maison appartient aux femmes, les hommes dirigent la prière, et coutume et religion cohabitent dans un équilibre fragile mais durable. Ce modèle surprenant défie les idées reçues sur l’islam patriarcal et invite à repenser la diversité des pratiques musulmanes.
-
Le 24 juillet 2025, la France a officiellement reconnu l’État de Palestine, un geste salué par le gouvernement indonésien, fervent soutien de la cause palestinienne. Cependant, une partie des musulmans conservateurs en Indonésie reste méfiante, en raison de la réputation controversée du président Macron et des doutes sur les véritables intentions de Paris.
-
La guerre des Padris (1803-1837), conflit complexe entre réformateurs musulmans et chefs coutumiers à Sumatra, a profondément marqué les sociétés locales. Ce conflit religieux et politique a aussi provoqué d’importantes conversions des populations Batak, jusqu’alors animistes, au christianisme protestant, redéfinissant durablement la région.
-
L’attaque d’une école du dimanche à Padang révèle une tendance inquiétante en Indonésie : la montée d’une intolérance religieuse enracinée, banalisée et parfois tolérée par les autorités. Dans certaines régions, la situation des minorités religieuses rappelle de plus en plus les dérives observées au Pakistan.
-
Contesté depuis son ascension éclair à la vice-présidence, Gibran Rakabuming Raka fait face à une fronde inédite : d’anciens généraux réclament sa destitution. Entre népotisme présumé, fragilité institutionnelle et inertie parlementaire, l’affaire expose les premières fissures dans l’héritage politique de Joko Widodo, dit Jokowi.
-
Le lien entre le califat ottoman et l’Indonésie fait rêver certains et intrigue d’autres. Entre faits historiques avérés et récits embellis, cet article explore comment ce passé lointain est parfois réinventé aujourd’hui, au croisement de la mémoire, de l’identité et de la politique.
-
L’Indonésie, archipel stratégique, reste largement dépendante des armements étrangers malgré ses ambitions d’autonomie. Le récent accord militaire avec la Turquie, héritière des liens historiques ottomans, illustre cette quête d’indépendance progressive face à une industrie locale encore fragile.
-
Dans les campagnes indonésiennes, les tengkulak jouent un rôle central en achetant les récoltes des petits paysans, leur fournissant crédits et accès au marché. Héritage du système colonial, ce réseau d’intermédiaires crée une dépendance économique durable, tandis que les coopératives, malgré leur nombre, peinent à offrir une alternative efficace.