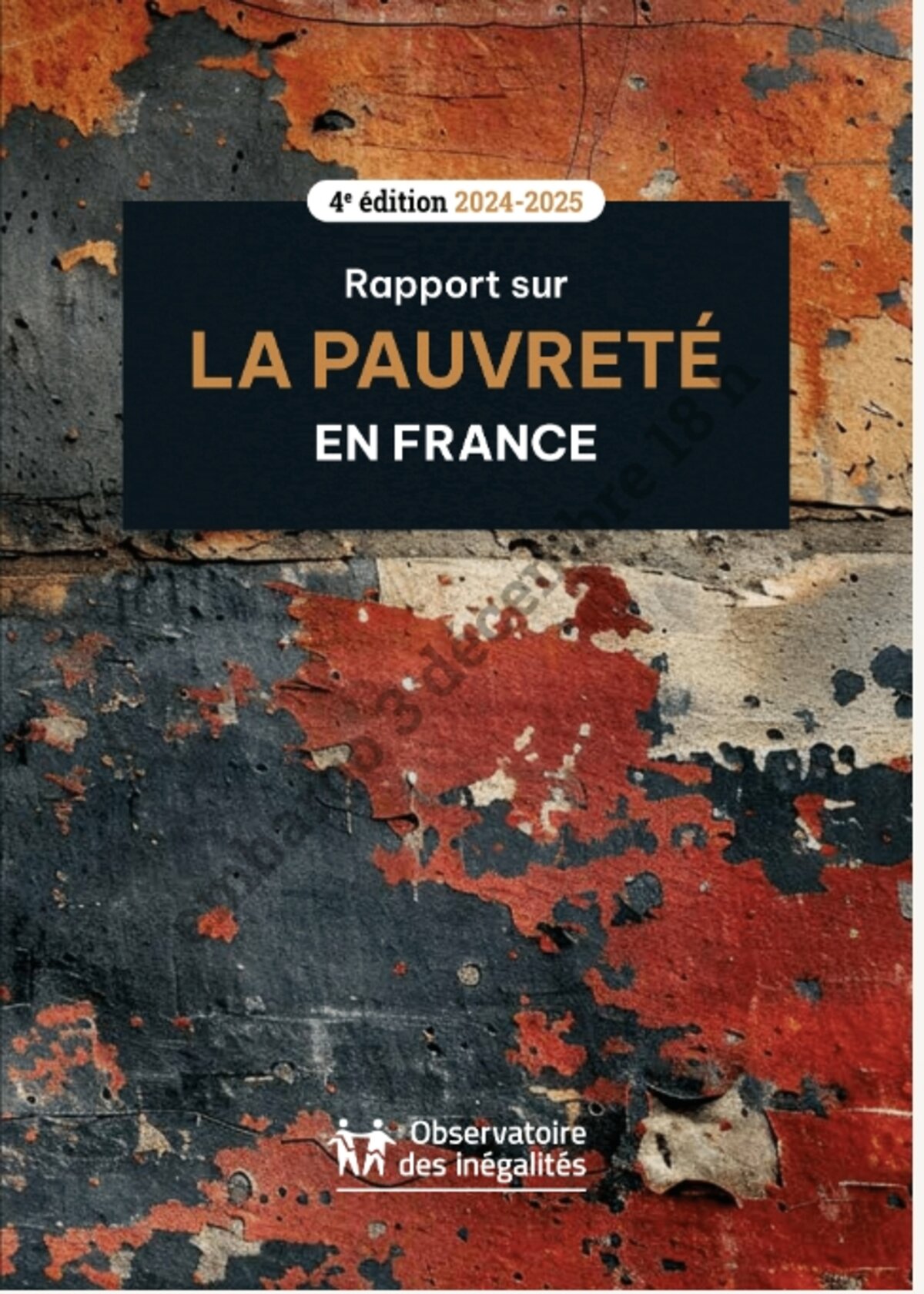
Agrandissement : Illustration 1
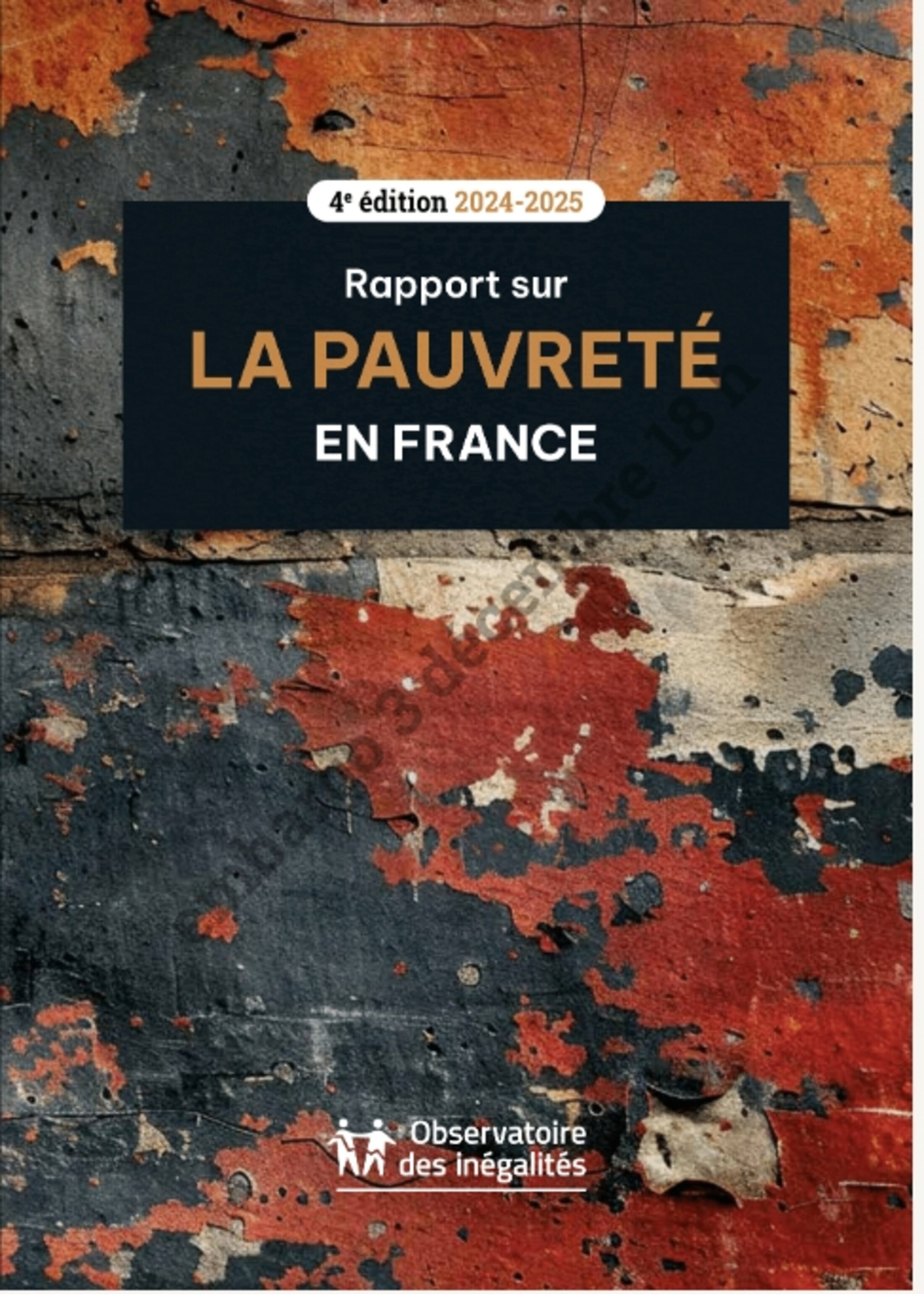
Dans l’avant-propos, Louis Maurin, directeur, pose la question cruciale : comment vivre avec moins de 1000 euros par mois ? 5 millions de personnes, adultes et enfants, sous le seuil de pauvreté (50 % du revenu médian) sont douloureusement confrontées à cette situation, qui, sans être la misère, contraint à une vie extrêmement difficile.
La France n’est pas la plus mal placée au regard du classement de la pauvreté, car elle a un modèle social qui protège grandement, mais insuffisamment pour la partie la moins fortunée du pays.
Je rends compte de ce rapport car la préoccupation de l’Observatoire recoupe exactement ce qui me motive depuis longtemps, et en particulier depuis que je publie ce blog : il y a une façon excessive dans le débat public à parler de la pauvreté des Français.
À entendre certains, à part le 1 % des plus riches, tous les autres souffriraient de revenus insuffisants. Si j’ai axé en partie mon travail sur le RSA (et tout le discours indigne sur l’assistanat) c’est non seulement parce que professionnellement j’ai eu à connaître ce sujet mais aussi parce qu’il y a un culte de la "valeur travail" qui conduit à négliger celles et ceux condamnés à vivre des minima sociaux. Il ne s’agit pas d’ignorer toute la palette des inégalités mais de dire que le débat public devrait être bien plus attentif à ce que vivent les plus démunis.
Les propos sur les classes moyennes entretiennent cette confusion, comme si cette catégorie existait réellement, alors qu’entre les classes moyennes inférieures et les classes moyennes supérieures il n’y a pas seulement les classes moyennes moyennes mais tout un monde.

Agrandissement : Illustration 2

Louis Maurin reproche à la puissance publique non seulement de ne pas tenir ses promesses mais de ne pas respecter la Constitution qui enjoint la collectivité à assurer « des moyens convenables d’existence » aux citoyens dans l’incapacité physique ou mental de travailler, ou du fait de la situation économique. Il condamne le durcissement des politiques migratoires empêchant aux étrangers de travailler. Il précise que le but de l’Observatoire, qui publie des études depuis 20 ans, est de fournir des éléments documentés pour que le débat public soit fondé sur une connaissance de la réalité sociale.
Par ailleurs, l’Observatoire fait des propositions comme celle d’un revenu minimum à 1000 euros mensuels (si l’allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse sont à ce niveau, le RSA reste actuellement à la moitié du seuil de pauvreté). Par ailleurs, il faut mettre le paquet sur le logement social, insuffisant soutenu, et sur l’éducation pour que les enfants des classes populaires ne soient plus si souvent écartés de l’emploi.

Agrandissement : Illustration 3

De façon originale, le rapport donne la parole au sociologue Julien Damon, qui loue le travail sérieux produit par l’Observatoire, tout en lui reprochant d’être sévère à l’encontre des stats de l’Insee (qui se sont nettement améliorées au fil du temps) et sur le fait que son seuil de pauvreté est fixé à 50 % du revenu médian (au lieu de 60 % comme presque partout ailleurs) ce qui crée des confusions.
Pourtant, ce que Julien Damon apprécie c’est l’objectivité du positionnement des chercheurs de l’Observatoire, lui-même, auteur de nombreux ouvrages, entre autres sur les sans-abris, s’est souvent montré critique face à des discours sur la pauvreté sacrifiant à la facilité, pas toujours fondé sur de réelles observations.
Julien Damon a poussé la provocation jusqu’à devenir chroniqueur au Point, ce qui n’est pas rien quand on sait comment ce média, bien aidé en cela par Franz-Olivier Giesbert, a régulièrement manifesté son mépris envers les plus démunis.
Un tel rapport s’appuie sur un certain nombre de statistiques qu’il faut connaître : niveau de vie médian (2028 €), Smic net (1399 €), seuil de pauvreté à 50 % (1014 €, à 60 % : 1216 €), RSA (559 €). Le niveau de vie médian des personnes pauvres (ayant moins de 1014 €) est de 832 €. 24,5 % des chômeurs sont pauvres, 19,2 % des familles monoparentales.
En 20 ans, la pauvreté a progressé considérablement : 3,8 millions en 2002 (6,6 % de la population), 5,1 millions en 2022 (8,1 %). La mesure de la pauvreté se détermine à partir des revenus mais peut l’être aussi à partir des minima sociaux distribués (on parle alors de pauvreté "légale"), ou des conditions de vie (avec mesure des privations, l’Insee ayant établi une liste de 13 critères). On peut enfin mesurer une pauvreté "absolue", en se référant à un budget nécessaire pour vivre à peu près décemment (certains pays procèdent ainsi, sans se fonder sur le niveau de vie médian, c’est le cas de Etats-Unis).

Agrandissement : Illustration 4

Le rapport décrit ensuite les privations et les conditions de vie de la grande pauvreté, les caractéristiques des 200 000 personnes accueillies en centre d’hébergement (81 % d’origine immigrée), à la rue, et en hébergement d’urgence.
L’Unicef et la Fas ont évalué (à partir du 115 donc incomplet) que 2000 enfants étaient à la rue dont 500 de moins de trois ans. Par contre, aucune stat n’existe sur les bidonvilles (certainement plus de 20 000 personnes vivant dans des campements).
L’évaluation du nombre de pauvres à partir du seuil de pauvreté donne donc 5,1 millions de pauvres mais en oublie environ deux millions, sans parler des étudiants sans le sou. Quatre millions de personnes relèvent des minima sociaux (6 millions si l’on compte les ayants-droit). Une comparaison internationale met en évidence que « la France fait mieux que ses voisins » (taux de pauvreté à 9,1 % alors que l’Italie est à 13 %, l’Espagne à 13,7 %, mais l’Allemagne à 8,5 %).
Les Français, selon un baromètre du ministère des solidarités (2023), sont préoccupés du sort des plus démunis (8 sur 10), mais les chiffres laissent paraître une baisse de l’inquiétude des Français envers la pauvreté alors même qu’ils mesurent que celle-ci va augmenter à l’avenir. Contrairement à ce qui se dit souvent, les Français ne redoutent pas de devenir pauvres mais ils expriment une certaine solidarité envers les plus pauvres.
Les discours sur l’assistanat n’auraient pas un si grand impact sur eux car une immense majorité des Français approuvent que le RSA soit versé à celles et ceux qui sont dans une situation difficile : « la stigmatisation des pauvres, médiatiquement très présente, ne prend pas sur le long terme dans l’opinion publique, sauf pour une fraction minoritaire ». Constat plutôt rassurant.

Agrandissement : Illustration 5

Il va de soi qu’il n’y a pas de meilleur moyen de connaître les constats de l’Observatoire des inégalités et de soutenir cet organisme indispensable que d’acquérir son rapport.
. Rapport sur la pauvreté en France, 4ème édition 2024-2025, commande sur le site de l’Observatoire : ici.
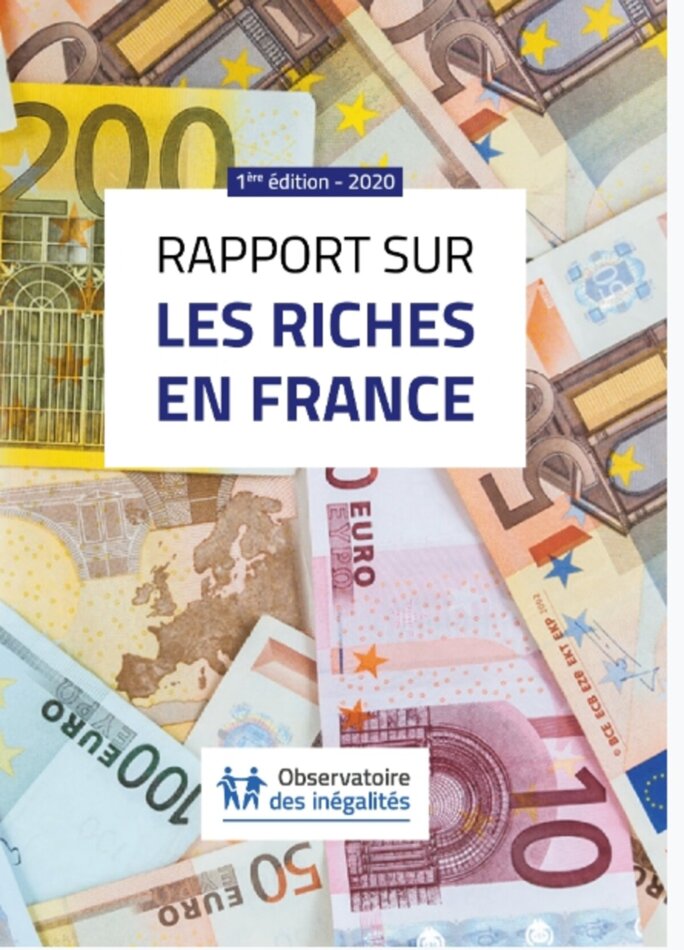
Agrandissement : Illustration 6

L’Observatoire des inégalités sur Social en question :
Inégalités : la crise enrichit les plus riches, 2015.
Les inégalités, des données pour agir, 2017.
Rapport sur la pauvreté en France, 2018.
« Comprendre les inégalités », par Louis Maurin (juin 2018).
Les inégalités en France, 2019.
Rapport sur les riches, 2020.
La pauvreté observée de près, 2020.
Fortunes et infortunes de France, 2021.
Qui est riches en France ?, 2022.
Et aussi :
La pauvreté comme les feuilles mortes, 2020 : rapport du Secours Catholique-Caritas.
Sans-abri : tous des immigrés ?, 2017 : rapport de la fondation Abbé-Pierre.
La lutte contre la pauvreté en ordre dispersé, 2017
. Ces liens ne renvoient pas à tous les billets de Social en question sur le sujet de la pauvreté, de la richesse, des inégalités, mais seulement aux articles qui ont traité des rapports sur le sujet.

Agrandissement : Illustration 7

Billet n° 832
Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Parcours et démarche : ici et là. "Chroniqueur militant". Et bilan au n° 700 et au n° 600. Le plaisir d'écrire et de faire lien (n° 800).
Contact : yves.faucoup.mediapart@free.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup



